
Parents
- Paul Testard du Cosquer (1790 - 1851), aspirant de marine sous le 1er Empire, prisonnier en Angleterre de 1810 à 1814 (prise de la frégate corsaire l'Éléonore)
- Émilie de Saint-Pezran (1800 - 1879), rentière
Family
- Married on May 29, 1877 in Lesneven, with Marie Collin (1844 - 1929), propriétaire demeurant à Lesneven, issuing
Dwellings
- Guangzhou (in garrison 1858 - 1860)
- Saint-Denis, Division navale de la côte orientale d'Afrique (in garrison 1861 - 1864)
- Ho Chi Minh City, Saïgon (in garrison 1868 - 1870, in garrison 1875 - 1877)
- Le Kremlin-Bicêtre, Fort de Bicêtre (in garrison 1870 - 1871)
- Fort de Montrouge (in garrison 1871)
- Libreville, Station locale française du Gabon (in garrison 1872 - 1873)
- Brignogan-Plages, Ker Tréas (secondary residence and ownership 1872 - 1929)
- Lesneven (primary residence and ownership 1877 - 1929)
Occupations
- lieutenant de vaisseau- Siège de Paris, défense des forts de Bicêtre et de Montrouge (1870) - Gabon (1872) - Cochinchine (1875) (1869 - 1877)
- aspirant de marine- Océan Indien (1861). Enseigne de vaisseau - Nouvelle-Calédonie et Tahiti (1865) - Cochinchine (1868) (1861 - 1869)
- volontaire de la marine - Guerre de Crimée, prise du Fort de Bomarsund (1854) - Canada (1855) - Mer de Chine, capture de pirates et prise de Canton (1857) (1854 - 1861)
Distinctions
- médaille militaire (1858)
- chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur (1875)
- ordre royal du Cambodge (1869)
Links
- Witness at the marriage of Louis Fauque (1847 - ) and Alphonsine Collin (1846 - 1902)
- Witness to the death of Julie Comdamain (1818 - 1886)
Notes
Bomarsund
Paul s'engage le 22 mai 1854 comme volontaire de seconde classe sur la corvette à roue Le Laborieux. Il n'y reste pas longtemps puisque le lendemain on l'envoie sur le vaisseau Le Saint Louis, un vaisseau tout récemment armé stationné en rade de Brest où il ne reste que 8 jours. Il rejoint alors le 1er juin le navire de transport de troupes à voile La Licorne, envoyé dans le cadre de la guerre franco-anglaise contre la Russie pour participer à l'opération de la Baltique. Cette expédition militaire est conçue comme une action de diversion du théâtre principal qui se trouve en mer Noire. Elle vise initialement à s'attaquer aux défenses de Saint-Pétersbourg, capitale de l'Empire russe. Au cours des mois de mars et d'avril 1854, l'escadre française de la Baltique est formée à l'Arsenal de Brest sous le commandement du vice-amiral Parseval-Deschênes. Cette escadre met 50 jours pour atteindre l'embouchure du golfe de Finlande. À la fin juin, les navires britanniques et français font une reconnaissance vers Kronstadt sans parvenir à engager le combat avec la Flotte de la Baltique russe. Les chefs de l'expédition décident alors de la mener vers les îles Åland protégées par l'imposante forteresse de Bomarsund qui, bien qu'inachevée, ne peut pas être vaincue par les forces navales seules. Le 10 juillet, Paul change de batiment et passe sur le Darien, une frégate de transport de troupes à roue commandée par le baron Didelot appartenant à la même escadre. À la fin du mois juillet, une flotte britannique de 25 navires vient entourer la forteresse en attendant l'arrivée des troupes françaises de débarquement. Le contingent français débarque dans l'île le 8 aout.

Le 15 août à 11 heures, les bâtiments français le Trident, le Duperré, le Phlégéton, le Darien et l'Asmodée, ainsi que 8 bâtiments anglais commencent un pilonnage lent, mais précis, à très longue portée de la façade extérieure et de la toiture de l'édifice. L'amiral Parseval-Deschênes se rend successivement à bord de chacun des vaisseaux pour stimuler l'ardeur des bâtiments engagés au feu. Le feu continue toute la journée durant. Au soir, la toiture du fort effondrée en plusieurs points et les brèches dans les murailles, montraient la puissance de l'artillerie des vaisseaux, même sur des murs de granit.

Le lendemain, dès la pointe du jour, le feu recommence du côté de la terre avec une énergie nouvelle. Les mortiers causent des ravages terribles dans la place et déciment la garnison. Bien qu'il soit à l'agonie depuis les tirs de la veille, l'ennemi réplique vigoureusement. De leur côté, les bâtiments des escadres étaient revenus devant la forteresse et renouvellent les désastres du jour précédent. Vers midi, le feu était dans toute son intensité, lorsque, du côté de la mer, un pavillon parlementaire flotta pendant quelques instants à une embrasure, puis disparu tout d'un coup et reparut peu de temps après.

Immédiatement, au grand mât des vaisseaux amiraux, est levé le signal de : Cesser le feu, qui continue néanmoins du côté terre, d'où il est impossible d'apercevoir le pavillon de la forteresse. Bomarsund se rend le 16 août 1854.

La place de Bomarsund, avec les trois tours qui en formaient les avant postes contenaient une garnison de 2400 hommes. Elle était armée de 180 pièces de canons et munie d'approvisionnements considérables. Au soir, les prisonniers quittèrent le fort en ordre de bataille pour être embarqués sur les bâtiments anglais. Ce fut un spectacle triste et grave. Quand le général russe, accompagné de son état major, monta à bord du Tilsitt, vaisseau français devant le conduire en France, les troupes lui rendirent les honneurs militaires dûs à son rang, ce qui ému au larmes le vieil homme qui remercia l'amiral.
La prise de Bomarsund n'était pas seulement un échec matériel considérable pour les Russes, elle avait aussi une portée politique incontestable. Dans la pensée du Tsar Nicolas 1er, Bomarsund était indubitablement destinée à devenir une place de guerre et un arsenal maritime de haute importance.
La forteresse ne présentant pas d'intérêt pour les forces britanniques et françaises, il est décidé de la démolir avec les explosifs qui se trouvent sur place. La 2 septembre à 7 heures du soir, tandis que les troupes à terres s'étaient retirées dans les collines alentours et que les marins avaient rejoints leurs bâtiments en mer, une immense détonation se fait entendre, suivie de plusieurs explosions successives. Cette destruction du fort, dont les magnifiques travaux avaient coûté tant de temps et de millions, est un rude coup porté dans la Baltique à l'influence de la Russie.
Pendant les jours qui s'étaient écoulés depuis la prise de Bomarsund, les opérations relatives au rembarquement des troupes s'étaient faites avec activité, car la saison déjà avancée, et quelques coups de vents qui s'étaient déjà déclarés, faisaient craindre de réelles difficultés de navigation. Pour éviter les dangers de la navigation en escadre, les bâtiments français rentrent en France seuls ou par petits groupes. Le Darien, un des deux seuls navires à vapeur de l'escadre, est chargé de remorquer l'Inflexible, endommagé pendant les combats. Il est escorté par l'Austerlitz et La Reine-Hortense. Sur le retour, une épidémie de choléra se propagera parmi les troupes de débarquement et les escadres. Elle causera plus de victimes que les combats.
Paul, bien que simple novice, se fait remarquer pour ses capacités. Le 11 octobre 1854, le capitaine de vaisseau Didelot, commandant le Darien, écrira une note sur lui à destination du ministère de la Marine : « Conduite, moralité, santé très bonnes. C'est de tous les jeunes volontaires de seconde classe celui qui promet le plus. Intelligent et de bonne volonté, tenue convenable, paraît avoir de l'aptitude au métier. »
Le 1er décembre 1854, Paul rejoint le vaisseau Duquesne. L'escadre est revenue à Brest et sur les côtes françaises, attendant que les conditions climatiques lui permettent à nouveau de remonter dans la Baltique. Les alliés ont pour projet de détruire les forteresses de Sveaborg et de Kronstadt aux portes de Saint-Petersbourg. Quelques jours avant le départ, Paul est envoyé sur la frégate Isis qui s'apprête à rejoindre elle aussi la Baltique en qualité de navire hôpital. Peut-être Paul est il malade ? Il ne restera que 3 jours sur l'Isis et ne partira pas dans la Baltique.
Canada
On l'envoie alors le 27 avril 1855 sur la Capricieuse, corvette de 32 canons, qui revient d'une mission scientifique de plusieurs années en Chine, dans le Pacifique et dans l'Océan Indien. La Capricieuse est envoyée à la fin du printemps par le gouvernement impérial au Canada, pour une mission diplomatique. Elle rejoint Sydney, en Nouvelle-Ecosse, un port situé sur l'île du Cap-Breton à l'Est du Canada. Elle est alors sous le commandement du capitaine de vaisseau Paul-Henri Belvèze qui commande la division navale de Terre-Neuve. Au cours des dernières années, Belvèze, qui était chargé de la surveillance des opérations des pêcheurs français, avait remarqué qu'un grand nombre de navires européens amenaient par le Saint-Laurent des marchandises au Canada et en repartaient chargés de bois. Il avait vu là une possibilité pour la force navale française de s'approvisionner en bois peu coûteux et en charbon de la Nouvelle-Ecosse, ainsi que l'opportunité pour la marine marchande de pénétrer sur un marché ouvert à tous les pays sans restriction. Il était parvenu à convaincre le gouvernement impérial de le suivre mais, pour ne pas entraîner de tensions diplomatiques avec son nouvel allié, Napoléon III avait tenu à ce que cette mission soit essentiellement commerciale et non politique. Les relations avec l'Angleterre étaient alors au plus haut car les deux nations avaient compris qu'ils ne pourraient contrer l'expansion russe que s'ils acceptaient de se battre côte à côte. Napoléon III et l'impératrice Eugénie revenaient d'une visite officielle à Londres où on leur avait réservé une grande réception au Crystal Palace. A l'été, c'est au tour de la reine Victoria, accompagnée du jeune prince Albert, de rendre visite à son tour aux Français, qui l'accueillent au Palais de l'Industrie. On choisit donc de ne pas prévenir le gouvernement britannique, pour éviter que cette mission ne prenne un caractère trop solennel, et l'on envoie Belvèze, un simple capitaine, dans le Saint-Laurent. Il faut que ce voyage apparaisse aux yeux des anglais et des canadiens comme une initiative locale.

La Capricieuse partit donc de Sydney le 5 juillet 1855. Bien qu'il n'en ait pas passé l'examen, Paul, excellent marin, y sert en qualité d'aspirant auxiliaire, et Belvèze le compte dans son rapport parmi les membres de son état major. Il découvre le golfe du Saint-Laurent et les côtes abruptes, inhabitées et inhospitalières de la grande île d'Anticosti. Puis, à partir de Gaspé, Paul voit apparaître les premières cultures, et enfin des maisons, des granges, des villages de plus en plus nombreux, qui donnent à ce pays un aspect ravissant.
L'arrivée de la Capricieuse était connue d'avance et partout les populations accouraient à la côte la saluant de ses hourras, et de salves de mousquerie. Le long de la magnifique île Orléans, malgré une pluie battante, les habitants, tous d'origine française saluaient de l'intérieur des maisons, ou bravaient le mauvais temps en courant le long du rivage pour suivre plus longtemps le mouvement de la corvette. La Capricieuse arrive à Québec le 13 juillet, sous une pluie battante. L'équipage est accueilli par une grande foule sur les quais et par le maire de la ville. S'en suiveront pendant tout l'été d'une succession d'invitations, d'inaugurations, de réceptions et de bals donnés pour le capitaine Belvèze et les officiers de la Capricieuse dans toutes les villes où ils passeront: Québec, Trois-Rivières, Montréal, Kingston, Toronto, Ottawa, etc.
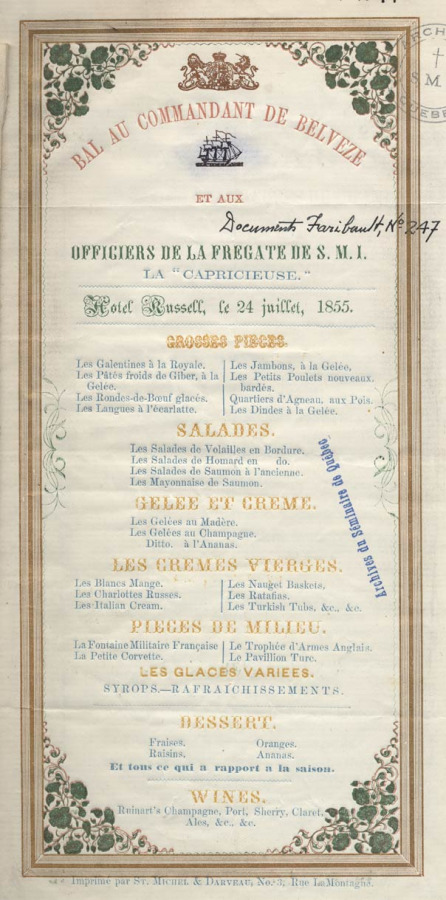
Une lettre du capitaine Belvèze adressée à un ami résume en quelques mots le séjour des marins de la Capricieuse au Canada, dont il semble parfaitement satisfait : « Sydney, le 29 août 1855. [...] J'arrive du Canada où j'ai fait la course la plus mirobolante qui puisse être racontée. Figurez-vous le pavillon de la France reparaissant après cent ans d'absence dans notre ancienne colonie et y retrouvant endormi au fond des cœurs le souvenir et l'amour de la vieille mère-patrie, et l'explosion de ce sentiment éclatant partout, même parmi les populations anglaises, lesquelles, grâce à l'alliance, ont du célébrer elles aussi, par de frénétiques hourras, l'arrivée du représentant du puissant allié de leur gracieuse souveraine (c'est ainsi qu'ils s'expriment à l'endroit de votre humble ami). Aussi ai-je fait à travers 800 lieues de fleuves, de lacs, de chemins de fer un voyage princier, passant sous je ne sais combien d'arcs-de-triomphe, trouvant la nuit et le jour la population, les municipalités m'attendant à l'entrée des villes une adresse à la main, et moi, pauvre hère, obligé de répondre à tout cela par de beaux et bons discours qu'il fallait plus tard paraphraser à merci dans des banquets, des toasts, etc. etc. Quelle dépense exorbitante d'éloquence j'ai faite dans ces trois semaines ! ! ! Une vingtaine d'adresses à répondre, plus de cinquante speech à prononcer, l'un d'eux sur le Champ-de-Mars, devant 10,000 personnes, monté sur une voiture, [...]et le tout avec accompagnement de canons, feux d'artifice, etc. Si je ne suis pas mort d'indigestion, j'aurais dû mourir de vanité ; heureusement que mon estomac et mon bon sens m'ont défendu de l'un et de l'autre trépas. [...] Je suis allé de Québec aux chutes du Niagara, en suivant toujours les voies de navigation; j'en suis revenu par le fleuve en descendant les rapides, merveilleux spectacle dont on n'aura jamais l'idée en Europe. J'ai même descendu un des grands rapides du Saint-Maurice dans un canot d'écorce comme un Iroquois. Il faudrait un livre pour vous dire les détails de cette course merveilleuse et j'ai là de quoi vous raconter pendant bien des soirées. [...] Au point de vue politique et commercial j'ai eu un succès inespéré et je reviens de ce pays où toujours les antagonismes se touchent, sans avoir indisposé personne, chose dont la difficulté était telle que personne n'en croyait la solution possible. »

Les poètes canadiens Octave Crémazie et Louis-Honoré Fréchette écriront des poèmes sur le passage de la Capricieuse. Ces quelques vers témoignent de l'émotion profonde qu'on ressentit les québécois, qui quelque part se sentaient abandonnés par la France depuis un siècle, en voyant arriver le vaisseau français.
Le chant du vieux soldat canadien (extrait), Octave Crémazie
Au sommet de nos murs, voyez dans la nue
Son noble pavillon dérouler sa splendeur ?
Ah! Ce jour glorieux où les français, nos frères,
Son venus, pour nous voir, du pays de nos pères,
Sera le plus aimé de nos jours de bonheur...
La légende d'un peuple, la Capricieuse, Louis-Honoré Fréchette
Je ne suis pas très vieux ; pourtant j’ai souvenance
Du jour où notre fleuve, après un siècle entier,
Pour la première fois vit un vaisseau de France
Mirer dans ses flots clairs son étendard altier.
Ce jour-là, de nos bords ― bonheur trop éphémère ―
Montait un cri de joie immense et triomphant :
C’était l’enfant perdu qui retrouvait sa mère ;
C’était la mère en pleurs embrassant son enfant !
La France nous avait laissés grandir loin d’elle,
Nous léguant son nom seul avec son souvenir ;
Et le pauvre orphelin, à tous les deux fidèle,
N’avait su, dans son cœur, qu’absoudre et que bénir.
Il avait tout gardé, ses antiques franchises,
Et son culte et sa langue, et ― peuple adolescent ―
Montrait avec orgueil ses libertés conquises,
A coté de ses droits scellés avec son sang.
Ce beau jour fut pour nous presque la délivrance ;
L’embrassement fut long ; on pleurait à genoux ;
Car, si nous étions fiers de notre belle France,
Notre France, elle aussi, pouvait l’être de nous !
Saintes émotions ! ― quand villes et banlieues
Illuminaient leurs tours, pavoisaient leurs maisons,
Au loin, sur un rayon de plus de trente lieues,
On voyait accourir, de tous les horizons,
Des vieillards, des enfants et des femmes timides,
Qui, sac au dos, à pied sur les chemins rugueux,
Venaient, en essuyant leurs paupières humides,
Revoir flotter au vent le drapeau des aïeux.
Nos poètes chantaient la France revenue ;
Et le père, à l’enfant qu’étonnait tout cela,
Disait : ― Ce pavillon qui brille dans la nue,
― Incline-toi, mon fils ! ― c’est à nous celui-là !
Et, lorsque la frégate avec la forteresse
Échangeaient des saluts de leurs tonnantes voix,
Tous ces cœurs délirants tressaillaient d’allégresse
En croyant retrouver les échos d’autrefois.
Oh ! c’est que ce vaisseau, c’était la France même
― Aigle immense un instant repliant son essor ―
Qui revenait à nous, disant : ― J’aime qui m’aime ;
Vous êtes mes enfants, et je vous aime encor !
Elle nous l’a prouvé ; ni la Capricieuse
Ni ces nobles marins n’ont revu nos clochers ;
Mais la France, depuis, fut pour nous soucieuse,
Et son cœur et sa main nous ont toujours cherchés.
Et nous, quand elle allait, au fronton de l’histoire,
Inscrire avec son sang quelque éclatant succès,
Nous sonnions triomphants nos clairons de victoire,
Car c’étaient nos soldats que les soldats français.
Et puis, quand le malheur vint fondre sur ses armes,
Quand le noble vaisseau sombra sur un écueil,
La France plus que nous n’a pas versé de larmes ;
La France mieux que nous n’a point porté le deuil !
Salut donc à vous tous, ô Français, ô nos frères !
Nous vous serrons la main avec un doux émoi
Nos rives ne sont plus à la France étrangères ;
Et qui vient de chez elle est parmi nous chez soi
Le 25 août 1855, La Capricieuse dit un dernier adieu au Canada et rejoint Terre-Neuve, puis Toulon. L'espace de quelques semaines, le canada britannique était redevenu la Nouvelle-France.
Négociations de Tourane
Le 16 janvier 1856, la Capricieuse appareille de Toulon pour voyage d'un an à destination de la Chine, sous les ordres du capitaine Collier. Elle part renforcer l'escadre de l'amiral Rigault de Genouilly car la France, occupée depuis par la guerre de Crimée depuis deux ans, a négligé l'Extrême Orient.
La Capricieuse rejoint Teneriffe aux Canaries, touche la côte du Brésil, atteint Rio de Janeiro le 6 mars, traverse de nouveau l'Altlantique, par le sud cette fois, pour arriver le 22 avril à Simon’s bay, à l'extrême sud de l'Afrique. Elle y reste 10 jours puis se rend dans l'Océan Indien et gagne l'Indonésie. Le 9 juin, elle franchit le détroit de la Sonde, entre Sumatra de Java, pénètre dans la mer de Java, remonte vers le nord et traverse le 12 juin le détroit de Banca. La Capricieuse mouille le 15 juin à Singapour. Elle appareille le 29 du mois pour le golfe du Siam, près de Bangkok, où elle passera l'été. A l'automne, le 21 septembre, elle part explorer les côtes du Cambodge jusqu’au 7 octobre.
La Capricieuse remonte ensuite vers Tourane, port de la capitale impériale de l'Annam, dans l'actuel Vietnam, où l’attend la corvette à roues le Catinat, commandée par le capitaine Lelieur qui était lui même sous les ordres du capitaine Collier. Ce dernier avait chargé Lelieur de porter des lettres et des présents, à l'empereur Tu-Duc en attendant l’arrivée de Charles de Montigny, plénipotentiaire chargé d’une mission diplomatique. A son arrivée, on refuse de le recevoir. L’attitude de l’empereur d’Annam à l’égard des Occidentaux s’était alors considérablement durcie, allant jusqu’à interdire formellement tout contact avec eux. En butte à la mauvaise volonté des mandarins, et à des mouvements suspects des troupes annamites, le commandant du Catinat avait fait bombarder les forts de Tourane, afin d’obtenir que les lettres soient portées à Hué et que l’on ravitaille son navire. Lelieur avait de loin outrepassé les ordres de son supérieur. Montigny ne paraissant pas, et la Capricieuse, retardé par un typhon dans l'archipel des Paracels, n'arrivant pas, le navire français était repartit pour Hongkong. Cette décision avait été interprètée comme un aveu de faiblesse par l'empereur Tu Duc. La Capricieuse arrive le 24 octobre à Tourane, quelques jours après le départ du Catinat. Le commandant Collier entame alors les négociations, en l’absence de Montigny. Au nom du gouvernement français, il demande la liberté de commerce, la résidence d’un consul à Hué, le droit d’établir un comptoir à Tourane (droit accordé autrefois par Gia Long), et la liberté religieuse pour les missionnaires et les chrétiens. Alors même que se déroulent ces pourparlers, Tu Duc met ses armées sur le pied de guerre. Le 1er janvier 1857, officiellement toujours novice volontaire, Paul est nommé par le capitaine Collier Aspirant volontaire de 1ère classe, grade inscrit dans son registre militaire mais qui n'est pas enregistré officiellement au ministère de la Marine. La Capricieuse est ralliée le 23 janvier par l'aviso Marceau avec Montigny à son bord mais, les négociations n'aboutissant pas, la Capricieuse lève l’ancre le 7 février, suivie du Marceau le 13, et regagne Macao et Hongkong.
Le missionnaire Louvet, présent à Tourane lors du séjour de la Capricieuse racontera cet épisode dans son ouvrage « La mission de Cochinchine occidentale » :
« Un mois après le départ du Catinat, la corvette la Capricieuse arriva à son tour à Tourane. On reprit les négociations, mais M. de Montigny n'étant pas encore là, on ne pouvait traiter sérieusement; toujours même imprévoyance de notre côté, même perfidie de la part des Annamites. Le capitaine Collier fut invité avec son équipage à un grand festin; bien leur prit de n'y pas toucher, les mets étaient empoisonnés. Pendant que nous perdions le temps en négociations stériles, le roi concentrait ses meilleures troupes sur Tourane; des batteries s'élevaient de chaque côté de la rivière de Huê; des barrages en coupaient le cours, tout se préparait pour une résistance acharnée.
Que faisait pendant ce temps le plénipotentiaire français, M. de Montigny, que l'on attendait à Tourane depuis plusieurs mois et dont l'absence compromettait tout le succès des négociations ?... Ce long retard ne pouvait lui être imputé.
En sortant de Siam, un de ces typhons, si fréquents dans les mers de Chine, l'avait forcé de relâcher à Syngapore. De là, il s'était rendu à Bornéo, puis à Manille, d'où il était enfin parti pour la Cochinchine. Le 23 janvier 1857, il arriva en rade de Tourane, sur un petit vapeur, remorqué par une jonque chinoise. Il était trop tard, depuis quatre mois le Catinat et la Capricieuse étaient repartis successivement pour Hong-kong, et le roi d'Annam, ravenu de sa première frayeur, avait eu le temps d'organiser la défense, afin de résister à outrance à ces Barbares d'Occident, qui n'étaient pas, après tout, si terribles, puisqu'ils ne savaient pas même combiner une expédition, et qu'ils arrivaient les uns après les autres, au lieu de concentrer toutes leurs forces et de frapper un coup. Après quelques essais de négociations qui ne pouvaient aboutir, le plénipotentiaire français n'ayant ni vaisseaux, ni soldats pour appuyer ses demandes, M. de Montigny fut forcé, à son tour, de quitter Tourane et de se réfugier à Hong-kong (13 février 1857).
Mais avant de partir, il eut, dans sa générosité chevaleresque, la pensée d'écrire à Tu-duc, pour lui recommander les chrétiens et les missionnaires, le menaçant de la colère de la France, s'il osait encore les persécuter. Malheureusement M. de Montigay n'avait rien pour appuyer sa démarche, et ses menaces, devant être sans effet, ne pouvaient qu'aggraver la situation. C'est ce qui arriva. En voyant l'intérêt que le plénipotentiaire portait aux chrétiens, le roi en conclut que c'étaient eux qui l'avaient appelé. Dès lors, la persécution cessa d'être une guerre purement religieuse pour devenir un intérêt national. Ce fut une lutte à mort, sans trêve, sans merci et l'Eglise d'Annam eût été infailliblement noyée dans le sang de ses enfants, si Dieu, dans sa miséricorde, n'avait abrégé les jours d'épreuve. Hélas ! ils ne durèrent encore que trop !
Cette guerre d'extermination commença immédiatement après le départ de M. de Montigny. Cachés au fond des retraites les plus obscures, les vicaires apostoliques, chefs infortunés de ces malheureuses Eglises, apprenaient coup sur coup les nouvelles les plus désastreuses, et, comme au patriarche des anciens jours, chaque courrier qui parvenait jusqu'à eux, leur apportait l'annonce d'un nouveau désastre: pillage des églises et des établissements de la mission, sac et destruction des plus belles chrétientés, arrestation et martyre de leurs prêtres, emprisonnement des catéchistes et des notables, dispersion générale enfin des chrétiens placés sous la surveillance des villages païens, les hommes, les femmes, les enfants séparés violemment et bannis au loin. Le 21 mai 1857, Mgr Diaz, dominicain espagnol, vicaire apostolique du Tong-king central, tombait aux mains des satellites. Un aviso à vapeur, envoyé au Tong-king pour le protéger, ne fit qu'accélérer sa perte, en redoublant la rage des persécuteurs. Le 20 juillet, il était décapité, et, pour bien montrer à l'Europe civilisée le cas que l'on faisait de ses recommandations et de ses menaces, un an après, le 28 juillet 1858, Mgr Melchior Garcia, son successeur, était coupé en morceaux et sa tête était fendue en quatre.
C'en était trop. Mgr Pellerin, vicaire apostolique de la Cochinchine septentrionale, avait pu, au mois d'octobre 1856, se réfugier sur la corvette la Capricieuse, pendant qu'elle était en rade de Tourane. A la vue de l'orage effroyable qui se déchaînait sur l'Église annamite, il crut devoir, sur le conseil même de M. de Montigny, s'embarquer pour la France, afin d'exposer à l'Empereur la situation déplorable des chrétiens d'Annam et de lui demander un secours sérieux, capable d'obtenir enfin aux missionnaires et à leurs néophytes la liberté religieuse. »
La Capricieuse jette l'ancre à Hongkong, territoire britannique depuis 1842, et y reste pour le printemps. Les relations entre occidentaux et chinois sont au plus bas, notamment depuis que les britanniques ont investi Canton à l'automne 1856 dans le contexte de la seconde guerre de l'opium.
Paul, bien que simple novice volontaire, fait toujours office d'aspirant à bord de la Capricieuse, mais il n'a toujours pas pu passer l'examen puisque, qu'il n'a pas passé suffisamment de temps en mer. Le 10 juin, alors que la Capricieuse s'apprète à quitter Hong-Kong, le capitaine Collier écrit une note sur Paul, à destination du ministère de la marine : "Conduite, moralité, santé, très bonnes. Très grande aptitude au métier de la mer. Ce volontaire réunit toutes les qualités qui forment l'excellent marin et, s'il n'a pas toute l'instruction des autres aspirants, comme marin, il leur est infiniment supérieur. Je ne puis m'empêcher de regretter qu'il ne puisse prendre rang avec les autres aspirants pour l'avancement"
Le 11 juin, La Capricieuse, chargée d'intercepter des pirates portugais, fait route avec le Marceau vers Ning-Po, au sud de Shangai.
Toute la côte chinoise était à tel point infestée par les pirates, qu'une simple flottille de bateaux pêcheurs ne pouvait appareiller sans navires armés pour la protéger.
Dans un premier temps, les pêcheurs et marchands chinois firent le choix de lorchas portugaises, bien armées et bien équipées, pour assurer leur protection. Elles devinrent maitresses de la côte. Mais bientôt on accusa les Portugais d'avoir opéré des désastres sur le littoral, tué des hommes, enlevé des femmes, brûlé des maisons; ils se rendaient plus funestes que les pirates eux-mêmes. On accusait aussi leur consul de fermer les yeux sur de pareils excès et d'assurer l'impunité de si grands coupables.
Pour se délivrer de la protection des Portugais, devenue si désastreuse, les Chinois traitèrent avec l'ancien chef des pirates, A'Pack; il fut nommé, sans examen, mandarin de troisième classe. Sa flottille de marins cantonais, naguère pirates et se donnant pour honnêtes, fit concurrence aux lorchas de Macao dans la mission de convoyer les jonques marchandes. Cette flottille recrutait également un bon nombre de déserteurs anglais, américains et français. Telle était la situation depuis trois ans.
Les nouveaux convoyeurs l'emportaient chaque jour davantage. Les Portugais, furieux, affamés, devenaient encore plus pillards; ils attaquaient les protecteurs cantonais dès que l'occasion s'en présentait.
Dans le même temps, quelques Français (pour certains peu honnêtes) qui avaient fondé un bureau de convoi maritime s'allièrent aux pirates cantonnais. Ces Français avaient eu la bonne fortune d'obtenir la garde, c'est-à-dire plus ou moins la dilapidation, des pêcheries dans l'île de Chousan. Comme ils étaient très peu nombreux, les pirates Portugais les expulsèrent aisément, démolirent leurs maisons, détruisirent leurs barques et dispersèrent les associés. Les Français se joignirent donc aux Cantonnais, et dans un premier conflit furent battus avec ceux-ci... La plainte de ces Français maltraités fut transmise à Macao, et c'est pour cette raison que la Capricieuse fut envoyé pour remonter vers Ning-po et s'emparer des délinquants portugais.
Entre temps, pour se venger, A’Pack entreprit la destruction de ses antagonistes. Des divers points de la côte, il appela ses bateaux serpents et ses jonques de convoi. Il réunit une vingtaine de navires montés par cinq cents de ses marins les plus déterminés. Les Portugais, frappés de terreur, se sauvèrent. Avec sept de leurs lorchas ils remontèrent le Ta-tsie jusqu'à Ning-po. Ils se réfugièrent en face du consulat portugais, débarquèrent aussitôt leurs plus gros canons et les mirent en batterie devant le consulat. Cependant la flotte cantonaise remonta la rivière, et le consul pris la fuite. Les lorchas portugaises, mouillées devant le consulat de leur nation, font feu d'un de leurs bords. Leurs équipages, portugais et manillais, se jettent à terre. Les Cantonais forcent la maison du consul, poursuivent les fugitifs, non seulement à travers les rues de Ning-po, mais dans la campagne et jusque dans l'asile des tombeaux. Les vainqueurs massacrent tous les fuyards qu'ils peuvent atteindre.
La Capricieuse eut l'honneur de mettre un terme à ces horreurs. Elle sauva le consul puis conduisit à Macao les Portugais qui purent être soustraits à cette boucherie, afin qu'ils fussent jugés sur les crimes de piraterie dont ils étaient accusés.
Le capitaine Collier, sait que Paul est un bon marin, il lui confie le commandement d'un lorcha et le jeune homme se lance à la poursuite des Portugais. Le 22 septembre, le capitaine Collier écrira une note à destination du ministère de la marine : « Monsieur Testard possède à un haut degré toutes les qualités qui forment l'excellent marin, il commandait un lorcha à la poursuite des pirates Portugais de Ning Bo. Il s'y est parfaitement conduit, et avec beaucoup d'intelligence.» Sur cette même note, l'amiral Rigault de Genouilly, commandant la division des mers de Chine, ajoute: « Jeune homme dévoué et zélé qui montre d'heureuses dispositions »

Le 2 septembre, la Capricieuse repart de Hong-Kong avec la Durance, un transport, pour aller à Shang-Hai où elle passe au bassin. Le 26 novembre, toujours avec la Durance, elle fait route de nouveau pour Hong-Kong.
Prise de Canton
Vers la fin de l'année 1857, Anglais et Français se préparaient à mener une expédition punitive contre la Chine sur Canton, car le Céleste Empire était accusé d'avoir violé le traiter de Nankin de 1842 ; en refusant de réviser ce traité au bout de dix ans, comme cela était prévu, et en ayant continué de persécuter les missionnaires chrétiens. Quatorze ans auparavant, faisant suite à la première guerre de l'opium, le traité de Nankin obligeait les chinois à laisser cinq ports à disposition des Occidentaux pour le commerce. Malgré cet accord, les puissances européennes, désiraient étendre leur commerce vers le Nord et vers l’intérieur de la Chine car les revenus du commerce de drogue étaient considérables pour la couronne britannique ; ils servaient notamment à maintenir à flot l’appareil étatique en Inde, où la plus grande partie de l’opium était produite. Le commerce de l'opium était toujours illégal en Chine, ce qui n'empêchait pas le vice-roi de la ville de Canton de le pratiquer, tout en faisant condamner à mort les étrangers accusés de ce commerce.
La France et les États-Unis demandèrent, en 1854, comme cela était prévu, la révision du traité de Nankin dans le traité de Huangpu et le traité de Wanghia. Le Royaume-Uni fit la même demande, citant les articles sur le « traitement égalitaire » dans les statuts des nations les plus favorisées. En 1854, les ministres européens et américains contactèrent de nouveau les autorités chinoises et demandèrent des révisions des traités : 1 ) Pouvoir pénétrer sans réaction d'hostilité dans Canton ; 2) Pouvoir étendre le commerce à la Chine du Nord et le long du fleuve Yangzi ; 3) Légaliser le commerce de l’opium, qui était toujours illicite ; 4) Traiter directement avec la cour à Pékin.
Les occcidentaux n'avaient rien obtenu des Chinois, la cour impériale de la dynastie Qing rejeta alors les demandes de révision du Royaume-Uni, de la France et des États-Unis. les griefs des deux nations restaient les mêmes. L'Angleterre, en réalité, demandait de nouvelles facilités pour son commerce ; la France avait à venger la mort de ses missionnaires. En 1857, des pourparlers eurent lieu entre les deux gouvernements; ces pourparlers aboutirent à un arrangement en suite duquel chacune des deux nations prépara une expédition contre la Chine. Vers la fin de 1857, l'insurrection de l'Inde domptée enfin permettait aux Anglais d'augmenter les forces de leur corps d'expédition dans le Céleste Empirg. De son côté, l'escadre française entretenue sur les côtes chinoises s'était notablement accrue par des arrivages successifs. Le moment approchait donc où un énergique appui pourrait être donné aux représentations des ambassadeurs. Un diplomate, M. le baron Gros, chargé de négocier au nom du gouvernement français, venait d'ailleurs de débarquer à Hong-kong.

Dès lors, les puissances occidentales attendirent un événement qui pouvait servir de prétexte au conflit. Cet événement arriva le 8 octobre 1856, quand des officiers chinois de Ye Mingchen, vice roi de Canton, chargé des relations dîplomatiques avec les occidentaux au nom de l'Empereur de Chine, abordèrent l’Arrow. Ce navire préalablement pirate, avait été revendu puis enregistré à Hong Kong sous pavillon britannique. Cet enregistrement avait expiré et les cantonnais s'étaient saisis de l'occasion pour confisquer la cargaison d'opium. Ils capturèrent douze des quatorze hommes d’équipage et les emprisonnèrent. Les Britanniques demandèrent alors officiellement la relaxe de ces marins. Ye en libéra neuf mais refusa de libérer les trois derniers malgré l'insistance des Britanniques faisant valoir la promesse faite par l'empereur de la protection des navires britanniques. Les Britanniques évoquèrent ensuite l’insulte faite au drapeau britannique par les soldats chinois rapportée par Thomas Kennedy, qui était à bord d'un navire voisin au moment de l'incident et déclara avoir vu les soldats chinois descendre et mettre à terre le pavillon britannique au moment de l'intervention.

Le baron Gros et Lord Elgin, plénipotentiaires envoyés par la France et l'Angleterre, n'avaient pas tardé à se convaincre que seules des mesures coercitives auraient raison de la mauvaise volonté de Yé et que Canton devait être le théâtre des premières opérations. Canton est place stratégique importante pour la Chine. Cette ville portuaire est située à une centaine de kilomètres de l'embouchure de la rivière des Perles, l'une des plus importantes voie de communication du sud de la Chine ; elle se jette entre Macao et Hong-Kong. Les plénipotentiaires demandèrent à l'amiral français Rigault de Genouilly et à l'amiral anglais Seymour de monter un plan d'attaque, au cas où la voie diplomatique normale ne fonctionnerait pas.
Aussitôt son arrivée, le baron Gros, notre compatriote, s'entendit avec lord Elgin, envoyé comme plénipotentiaire par la reine Victoria. Deux dépêches furent simultanément envoyées par les ambassadeurs au vice-roi de Canton. Elles contenaient un ultimatum et annoncaient que si, dans un délai déterminé, satisfaction pleine et entière n'était pas donnée aux deux grandes puissances, les hostilités commenceraient.

Le dix décembre, attendant toujours la réponse de Ye, l'amiral Rigault de Genouilly déclare le blocus de la rivière de Canton :
"Je, soussigné, Contre-Amiral commandant-en-chef les forces navales de Sa Majesté l'Empereur des Français dans les mers de la Chine et de l'Inde ; Après m'être entendu avec le Haut Commissaire, de Sa Majesté Impériale sur les difficultés pendantes entre les Gouvernements de la France et celui de la Chine, sur les moyens d'y mettre un terme, sur la résolution des Gouvernements de France et d'Angleterre de poursuivre en commun les réparations qui leur sont dues, et en vertu des pouvoirs qui m'appartiennent comme Commandant-en-Chef, déclare :
A partir du 12 du courant, la rivière et le port de Canton et leurs issues seront tenus en état de blocus effectif par les forces navales placées sous mon commandement, agissant de concert avec les forces navales de Sa Majesté Britannique. Il sera procédé contre tout bâtiment qui essayerait de violer le blocus, conformément aux lois internationales et aux Traités en vigueur avec les Puissances neutres.
A bord de la frégate de Sa Majesté Impériale, la « Némésis », rade de Macao, le 10 Décembre, 1857.
(Signé) RIGAULT de GENOUILLY."
Le 11 décembre, les escadres occidentales commencent à prendre place devant Canton. La Capricieuse, ne pouvant remonter la rivière par la seule force du vent, est remorquée par la corvette mixte Phlégéton jusqu’à Canton.
Quelques jours plus tard, n'ayant toujours pas obtenus satisfaction, les occidentaux envoient un message à la population de Canton, les prévenant d'une attaque imminente de la ville et les invitant à se mettre à l'abri :
PROCLAMATION DES COMMANDANTS DES FORCES ALLIEES AUX HABITANTS DE CANTON.
L'Amiral RIGAULT de GENOUILLY, Commandant les forces de S. M. l'Empereur des Français dans les mers de l'Indo-Chine. L'Amiral SEYMOUR, Commandant les forces de S. M. Britannique dans les mers de l'Indo-Chine. Le Major-général VAN STRAUBENZEE, Commandant les forces expéditionnaires de S. M. Britannique en Chine:
Considérant, que le 10 de ce mois une notification a été faite, par Leurs Excellences les Plénipotentiaires de France et d'Angleterre à la population de Canton et de ses faubourgs pour lui "'faire connaître que si avant l'expiration du délai accordé au Commissaire Impérial Yé, il n'avait pas accédé aux justes demandes qui lui avaient été présentées la ville serait attaquée ; et, attendu que les réponses que le Commissaire Impérial a faites à ces demandes ne sont satisfaisantes en aucune manière, Leurs Excellences les Plénipotentiaires se sont adressés aux Commandants en chef çi-dessus nommés pour qu'ils aient à obtenir par la force des armes ce qu'il n'a pas été possible d'obtenir par des voies amicales.
Dans cet état de choses, les Commandans en chef voulant ménager, autant que possible, la vie et les propriétés des habitants de Canton, ont accordé aux autorités civiles et militaires de la ville un délai de 48 heures pour que les Chefs militaires et les troupes sous leurs ordres aient à évacuer la ville. Si ces autorités refusent de se rendre aux injonctions qui leur sont faites, la ville sera attaquée ; mais si, heureusement, ces autorités les acceptent, les habitants sont prévenus par cette proclamation que les forces alliées destinées à occuper Canton ont reçu les ordres les plus formels de respecter la vie et les propriétés des habitans et, sous aucun prétexte, de n'agir hostilement que contre ceux qui se déclareraient leurs ennemis. Dans tous les cas, cependant, que la ville se rende ou qu'elle soit occupée par force, il est instamment recommandé,aux habitans, et dans le but de sauvegarder leurs propriétés contre les déprédations des malfaiteurs, de rentrer le plus tôt possible dans leurs demeures et d'y reprendre tranquillement leurs travaux, dès que la ville sera occupée par les forces alliées. Quant aux réglemens à établir au sujet des mesures à prendre qui paraîtraient être le plus utile pour faire respecter les lois et maintenir le bon ordre, les notables, les anciens, et les lettrés pourraientse présenter avec les fonctionnaires chefs de quartier et autres de la même classe, aux autorités des forces alliées qui s'entendraient avec eux et qui feraient tout ce qui dépendrait d'elles pour les aider à protégerla populationcontre touteinsulte. Les plaintes seront toutes écoutées et les actes de violence retomberont promptement sur ceux qui les auront commis.
Le 14 décembre les troupes alliées occupèrent sans coup férir l'île de Honan dont les habitants, non seulement ne témoignèrent aucune disposition malveillante contre elles, mais encore leurs vendirent les vivres dont elles avaient besoin ; le bras de rivière qui sépare l'île de la ville fut exploré et l'on trouva qu'il ne s'y trouvait aucun obstacle formé par des estacades ou par desjonques coulées. Les forts de Dutch et French Folly furent réparés et armés de mortiers par les Alliés, sans être inquiétés par les indigènes.
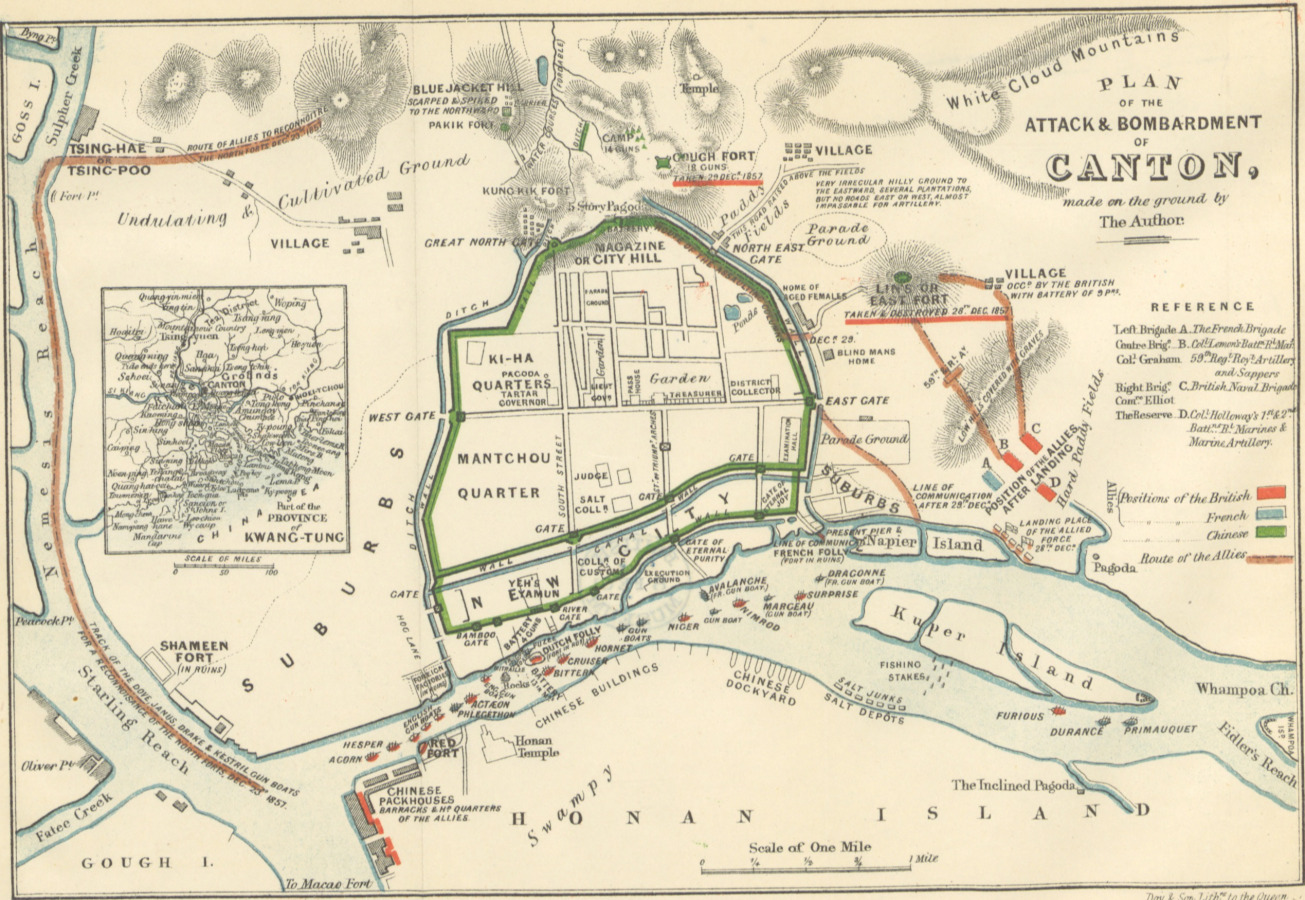
Le 24 décembre, le délai accordé à Ye étant écoulé, les plénipotentiaires lui firent parvenir un dernier message. Le 25 décembre, jour de Noël, Yeh rendit sa réponse. C'était une de ces mystifications comme savent les confectionner les Chinois, experts dans l'art d'éluder les questions. Les occidentaux ne pouvaient pas s'en contenter et le vice-roi fut sommé d'avoir à faire connaître au bout de quarante-huit heures, délai de rigueur, ses intentions d'une manière claire et nette. En même temps des proclamations furent adressées aux habitants de Canton pour leur faire connaître que, Ye ayant rejeté les propositions de la France et de l'Angleterre, si la ville ne se rendait pas dans deux jours, elle serait bombardée et prise de vive force. Ce délai était nécessaire pour faire les préparatifs du bombardement. Le 27, dès le point du jour, les lunettes se braquaient de tous les vaisseaux anglais et français vers un bateau vert, que l'on avait nommé bateau de Houqua, et qui, protégé par le drapeau blanc, avait porté d'un bord à l'autre tous les messages. Le bateau et le drapeau étaient toujours là, mais immobiles. Il était donc bien évident que le vice-roi persistait à ne pas vouloir donner les satisfactions réclamées par la France et l'Angleterre, et qu'au canon seul appartenait désormais la parole.
L'attaque avait été différée jusqu'au lundi matin, 28 décembre. Dès l'aube, les signaux hissés au grand mât de l'Actaeon et du Phlégéton, donnèrent le signal de l'action et le feu fut ouvert sur les angles Sud Ouest et Sud Est des deux villes, ainsi que sur le mur Est et sur le mur Sud en face du yamen du Vice-roi. A. sept heures, une division anglaise et française de plus de 5 5oo hommes, débarqua dans la passe de Kuper's Island et alla bivouaquer sous les murs de la ville, du côté de l'Est. Peu de temps après, le lieutenant anglais Hackett, du 59e régiment, surpris par des Chinois, eut la tête coupée; deux des agresseurs furent fusillés, un troisième fut pendu. Le capitaine de vaisseau Collier, commandant de la Capricieuse, commandait le corps français de débarquement, et Paul était à ses côtés. Le commandant d'Aboville, sur la rivière, avait sous ses ordres les six bâtiments français embossés devant Canton.

Bientôt la canonnade commence ; à terre, le premier mortier éclate sur le fort Gough, protégeant la porte orientale de la ville de Canton, qui contient un million d'habitants. Point d'empressement, point de bordée, point d'excitation. Chaque pièce est pointée avec le plus grand sang-froid, afin de toucher les murs et d'éviter d'atteindre les habitations. Mais c'est en vain que les mortiers cherchent à frapper les forts sur ta montagne. Les bombes et les boulets ne peuvent y arriver, ces forts sont hors de portée. La matinée se passe à ce feu continuel, et cependant point de signe de reddition. Les Chinois ont l'air de s'habituer à la canonnade. Leurs sampans, canots de plaisir, et même leurs bateaux chargés se promènent sur le fleuve comme aux jours ordinaires. Une foule d'habitants stationnent sur le bord et battent des mains lorsqu'ils entendent les boulets passer en sifflant sur leurs têtes ; les grands cerfs-volants, que les Chinois affectionnent, ont reparu et se jouent dans l'air au-dessus de la fumée. Ce calme, cette placidité de l'autorité chinoise et du peuple exaspèrent les amiraux alliés.
L'armement de la place, non compris les forts, se composait, au moment de l'attaque, de 574 bouches à feu, les unes en bronze, la plupart en fer, de calibres divers,. Plusieurs de ces pièces provenaient de fabriques européennes ; on en a même trouvé qui avaient appartenu à la marine de France, débris enlevés sans doute à quelque navire naufragé. Les projectiles étaient en fonte, inégaux entre eux et trop petits pour les pièces ; on en mettait plusieurs (jusqu'à cinq) pour un même coup, qui était alors chargé d'une grande quantité de poudre introduite telle quelle dans l'âme de la pièce. Ces canons étaient placés sur des affûts en bois, très bas, massifs, les uns fixes, les autres roulants, tous dépourvus de vis de pointage. Cette pièce importante et délicate était à la vérité remplacée par une pierre sous la culasse. Les Chinois avaient en outre, pour défendre leur enceinte, des espingoles en fer, des espèces de fusils de rempart très lourds, variant de 3 à 5 mètres de longueur, placés sur des chevalets en bambou. Dans ces armes, comme dans tous les autres fusils dont se servent les Chinois, l'amorce est enflammée au moyen, d'une mèche enroulée à l'extrémité d'un levier recourbé tournant autour d'un point fixe.

Notre infanterie de marine s'engage à découvert dans le village à gauche du fort Lyn. Tout à coup les nattes qui recouvraient un bâtiment carré situé tout près de là tombent comme par enchantement, et un feu très-nourri, dirigé contre les assaillants, montre que l'ennemi est sur ses gardes. Les tirailleurs à carabines rayées dirigent alors un feu roulant sur les Chinois qui se montrent aux ouvertures, néanmoins leur tir continue. Les commandants français et anglais, pour le faire cesser, font tonner la grosse artillerie ; en quelques minutes, elle abat les murs de droite et de gauche comme un château de cartes. L'assaut se prépare, mais les Chinois en ont assez, et, après une décharge générale sur les colonnes qui s'avancent, ils se retirent de la façon la plus mystérieuse : on les voit monter précipitamment et en désordre la côte du fort Gough. Deux minutes après, les drapeaux de la France et de l'Angleterre flottaient sur les murs du fort Lyn.
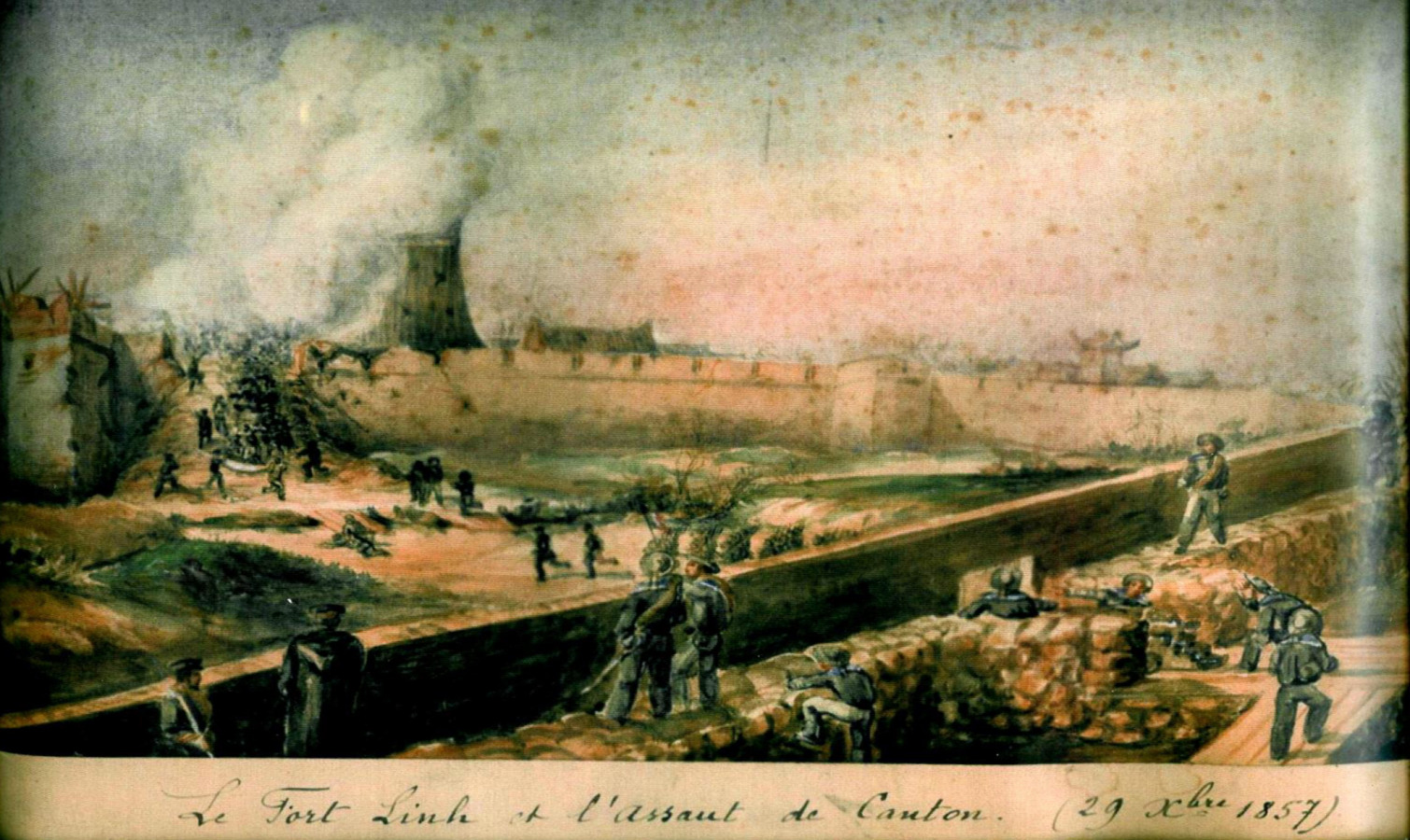
Il s'agissait de maintenir l'ordre dans la ville, et ce n'était pas une mince affaire. Canton, en effet, est le principal entrepôt du commerce intérieur de la Chine. Le mouvement des échanges s'y élève chaque année, sans compter le trafic illicite de l'opium, à plus de 200 millions de francs, et, malgré l'ouverture des ports du Nord, cette ville est demeurée le rendez-vous et le point de concentration des navires qui fréquentent les mers de la Chine. La Capricieuse, le Marceau, la Mitraille, et un bataillon de 450 hommes sous le commandement supérieur du capitaine de vaisseau d'Abboville, furent chargés de maintenir la paix à Canton pendant que le gros de la flotte repartait en mer de Chine. Paul faisait partie du corps d'occupation de Canton, mais en temps que marin, il était officiellement toujours à bord de la Capricieuse; ce qui ne l'empêchait pas, comme les autres marins, de descendre à terre régulièrement.
Le 14 février, moins de deux mois après la prise de la ville, le commandant Collier, qui avait dans les opérations contre Canton apporté un concours si efficace au commandant en chef, succombait à une cruelle maladie, au moment où l'amiral allait lui confier un poste difficile qu'il eût su dignement remplir. L'amiral, dans sa dépêche particulière au ministre de la marine, s'exprimait ainsi sur ce regrettable officier : « En perdant le commandant Collier, la marine perd un de ses officiers les plus distingués comme capitaine, et l'une de ses meilleures espérances pour le cadre des officiers généraux. Le caractère ferme et prudent de cet officier supérieur et ses qualités militaires l'avaient désigné à mon choix pour le commandement du corps d'occupation et de la division navale laissée devant Canton. » Le Marceau fut chargé par l'amiral de transporter à Hong-kong, dans le cimetière catholique, le corps du commandant Collier. A l'arrivée du cortège funèbre à bord du Marceau, la canonnière l'Avalanche fit le salut funèbre de sept coups de canon. Lorsque le corps passa près de la Capricieuse, bâtiment que commandait le capitaine de vaisseau Collier, cette corvette fit à son chef un dernier salut de sept coups de canon. Pendant toute la journée, les bâtiments français conservèrent, en signe de deuil, leur pavillon en berne et leurs vergues en pantêne.
Le 27 février 1858, pour sa participation à la prise de Canton, Paul Testard du Cosquer, novice volontaire, est décoré de la médaille militaire. Il se fait photographier dans son uniforme, sa médaille sur la poitrine, tenant à la main une maquette de la Capricieuse.

Les plénipotentiaires, reconnaissant qu'ils ne pouvaient se passer d'autorités chinoises, nommèrent vice-roi, à la place de Ye, le mandarin Pi-kouei. Dès que ce mandarin fut reconnu, il fit venir les chefs des différents services, réclama leur concours, leur déclarant qu'il assumait auprès de son gouvernement la responsabilité de sa conduite. Il prit en outre des mesures pour maintenir la tranquillité, pour empêcher les incendies, d'ordinaire si fréquents à Canton, et pour assurer l'approvisionnement de la ville. Les choses ainsi arrangées, Pi-kouei envoyai à la cour de Pékin un récit des événements, qu'il colora à sa manière. Sur cette communication, l'empereur rendit un édit sacré, aux termes duquel Ye fut destitué. En attendant un titulaire définitif, l'intérim des doubles fonctions de vice-roi et de commissaire impérial était confié à Pi-Kouei. Ce fonctionnaire témoigna alors de son désir de commencer des négociations au nom de son souverain. Mais les difficultés que l'on rencontra dans ces négociations, par suite de la mauvaise foi des Chinois, firent bientôt comprendre que le différend ne pourrait se vider utilement qu'à Pékin.
On prit des dispositions en conséquence, et, vers le commencement de mars 1858, la flotte combinée, composée de 25 navires de guerre, dont 15 anglais et 10 français, se trouva réunie dans le golfe de Pé-tchi-li, devant l'embouchure du fleuve Peï-ho, qui conduit à Pékin. La Capricieuse et la Mitraille, qui étaient jusque là restées à Canton pour garder la ville, rejoignent l'escadre. A l'expédition s'étaient associés trois vaisseaux américains et une frégate russe, portant l'amiral Poutiatine, ministre de Russie, et M. Red, ministre des Etats-Unis, qui, en bonnes relations avec les Chinois, poussaient à un arrangement en haine de l'intervention européenne. Désireux de tenter encore la voie des négociations avant d'en venir à de nouvelles hostilités, les plénipotentiaires d'Angleterre et de France firent, par l'entremise de ces diplomates, parvenir à Pékin un ultimatum, invitant le gouvernement chinois à envoyer au devant d'eux, dans un délai de six jours un commissaire muni de pleins pouvoirs, à l'effet de donner aux deux nations européennes les satisfactions qu'elles étaient en droit de réclamer pour les vexations subies par leurs nationaux et des garanties pour l'avenir. Ils déclaraient que, ce délai expiré, les troupes alliées occuperaient les forts de Peï-ho et porteraient la guerre jusque dans la capitale de l'empire.

Toutes choses paraissant être réglées, le départ de la flottille anglo-française fut arrêté pour le 3 juillet. Bientôt après, lord Elgin et le baron Gros quittèrent la Chine et firent voile pour l'Europe.
Paul retournera en station à Canton pendant près de deux ans. Le 1er septembre 1858, le capitaine de vaisseau d'Aboville, commandant la Capricieuse et le corps d'occupation de Canton, écrira une note à destination du ministère de la marine : "Conduite, santé, moralité bonnes. Aptitudes satisfaisantes aux manoeuvres d'infanterie. A assisté à la prise de Canton le 29 décembre 1857. Jeune homme zélé et plein de dévouement, bonne tenue, bonne éducation. Il serait désirable que Monsieur Testard puisse être nommé Aspirant, ce serait une bonne aquisition pour la Marine. "
Le jeune homme découvre la Chine et ses habitants au cours de son long séjour à Canton. Paul s'intéresse à l'art Chinois et fait l'aquisition de différents objets qu'il rapportera un jour à Lesneven. Il achètera notamment un coffre de couture en bois laqué noir, très richement ornementé de dorures représentant des scènes de la vie quotidienne des chinois. Il achètera également des brule-parfums chargés de dragons et de chiens, plusieurs pièces de porcelaine, et tout un tas de beaux souvenirs de son séjour. Mais sa carrière stagne, ayant toujours été en mer et en guerre depuis son engagement en 1854, Paul n'a jamais pu se présenter au concours d'Aspirant, malgré ses grandes qualités de marin et le soutien unanime de ses supérieurs. Le 14 juillet 1859, le capitaine d'Aboville réitère sa demande au ministère de la Marine, il écrit : "Beaucoup d'aptitude au métier de la mer, capable de manoeuvre d'infanterie. Jeune homme plein de dévouement, marin, bonne éducation, bonne tenue. Il faisait partie du corps d'occupation. Il est aujourd'hui sur l'aviso à vapeur La Rose, annexe de la Capricieuse." Sur cette même note l'amiral Rigault de Genouilly ajoute : "Monsieur Testard sert très bien, il mériterait d'être fait Aspirant."
A la fin du mois de mai 1860, la Capricieuse, qui vient de passer 5 années en Chine, reçoit l'ordre de regagner la France. Elle est remplacée à Canton par la Durance, qui est placée sous le commandement du capitaine de vaisseau Coupvent-Desbois, commandant du corps d'occupation de la ville depuis le départ du capitaine d'Aboville, en avril, pour raison de santé. L'aviso à vapeur La Rose, annexe de la Capricieuse devient annexe de la Durance, ce qui explique que Paul est inscrit sur le registre de la Durance comme Aspirant volontaire dans le registre des "États-Majors des batiments placés sous le commandement en chef du Vice-Amiral Charner". Paul quitte La Rose pour rejoindre la Capricieuse peu de temps avant son départ. La corvette quitte Canton le 19 juin. Après avoir complété ses vivres à Hong-Kong, pris des malades de Macao et embarqué des soldats d’infanterie de marine congédiables, elle fait route le 7 juillet pour sortir des mers de Chine par le canal de Bashi, au sud de Formose. Elle descend vers la Papouasie en franchissant le détroit de Bougainville, puis se dirige vers le sud de l'Indonésie en passant le détroit d'Ombai.
Au même moment, le capitaine de vaisseau Coupvent-Desbois, resté à Canton écrit une note sur Paul à destination du ministère de la Marine : « Jeune homme plein de zèle et de dévouement. Bon marin, bonne éducation, bonne tenue. Je le propose pour le grade d'Aspirant de seconde classe. Les six années qu'il vient de passer en Chine me paraissent lui constituer un droit exceptionnel. » Au Nord de la Chine, les Français et les Anglais venaient alors de reconquérir les forts de Pei-ho. Le commandant Jules Testard, cousin issu de germain du père de Paul, eut l'honneur de pénétrer le premier dans le fort chinois. Ce dernier s'était déjà illustrer quelques années plus tôt en Nouvelle-Calédonie, où il fonda les bases de Fort-de-France (qui deviendra Nouméa), et qui fut l'un des premiers commandants de l'île. A l'autômne, les alliés marcheront sur Pekin, renverseront la dynastie Qing et se livreront au sac du Palais d'été.
Poursuivant son retour vers la France, la Capricieuse relâche dix jours sur l'île d'Amboine, en Indonésie. Elle repart le 30 août et mouille après un mois de traversée à La Réunion, où elle restera une dizaine de jours. Après une dernière escale au Cap du 30 octobre au 11 novembre, La Capricieuse passera l'équateur le 29 novembre et jettera l'ancre à Toulon le 31 décembre 1860. Paul quitte la Capricieuse 6 jours plus tard et rentre dans ses foyers.
Paul a désormais 24 ans. Il rentre à Plouescat, où il retrouve sa mère qu'il n'a pas vu depuis au moins six ans et probablement son frère aîné Emile. Son aîné exerçait la profession de négociant et avait épousé à Neuilly Jenny Herbet de Saint-Riquier, pendant que Paul était en Chine. Le jeune couple venait d'avoir un fils Henri, né à Lesneven au mois de février 1860. Il rend ensuite visite à sa sœur aînée Pauline, qui avait déjà quatre enfants de son mari le docteur Henri Le Moine, et qui venait de s'installer au manoir de la Roche Rousse à Quessoy dans les Côtes d'Armor. Son petit frère Louis vient quant à lui de s'engager au second régiment d'infanterie de Marine, il s'illustrera l'année suivante lors de la campagne du Mexique, où il sera blessé lors la prise de Puebla, et recevra lui aussi décoré de la médaille militaire pour ses faits d'armes.
Le 4 mars, alors que Paul est en visite chez sa sœur Pauline au manoir de la Roche Rousse, le ministre de la Marine accède aux demandes de l'amiral Rigault de Genouilly et des capitaines Collier, d'Aboville et Coupvent-Desboisle. Il nomme Paul Aspirant de seconde classe, sans qu'il n'ait besoin de passer l'examen d'admission. Paul est fou de joie, il répond au ministre de la Marine pour lui témoigner de sa gratitude : «La Roche Rousse en Quessoy, le 15 mars. Excellence, J'ai l'honneur de vous accuser de la réception de ma nomination au grade d'Aspirant de seconde classe. C'est avec un profond sentiment de reconnaissance que j'accepte cette grande faveur dont j'espère me montrer digne par mes faibles mais dévoués services. D'après ma nomination je sui nommé au port de Brest; je ne sais pas si je dois attendre ici de nouveaux ordres, ou si je dois me rendre immédiatement à ma destination. Daignez agréer, Excellence, l'assurance du profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être votre très dévoué serviteur. L'aspirant de seconde classe Paul Testard.»
Division navale de la côte orientale d'Afrique
Paul rallie Brest le 6 juin et embarque à bord de la Sibylle, pour une mission en mer de 14 jours, puis sur le Tilsitt pour 5 jours. Il rejoint ensuite le navire de transport à voiles la Licorne, commandée par le lieutenant de vaisseau Latapie, sur laquelle il passera les trois prochaines années. Après avoir passé le mois de mai à préparer son expédition, la Licorne quitte Brest le 8 juin 1861, transportant à son bord des soldats de l'infanterie de la marine. Elle part rejoindre la Division navale de la côte orientale d'Afrique, basée à Saint-Denis de la Réunion, chargée de La Défense des possessions françaises du secteur: l'île de La Réunion, Mayotte, Maurice, les Seychelles... et de la protection des ports de commerce de Magagascar, notamment Nossi-Bé, Sainte-Marie et Tamatave.
Au moment où la Licorne arrive dans l'Océan Indien, Radama II, roi de Madagascar, vient de monter sur le trône. Il reprend le travail de son père, décédé il y a plus de trente ans, qui avait cherché à ouvrir son pays aux grandes puissances occidentales et à moderniser son pays. À sa mort, en 1828, son épouse Ravalona 1ère était montée sur le trône et avait pris des distance avec les européens avec lesquelles elle était entrée en conflit à plusieurs reprises. Cherchant à éradiquer le christianisme, qu'elle voit comme un moyen d'infiltration de l'influence coloniale, elle se livre à la persécution des chrétiens qui sont de plus en plus nombreux sur l'île. Radama II entreprend de mèner une politique radicalement différente de sa mère. Les relations diplomatiques entre Madagascar et les européens sont au plus haut. Le roi signe des traités pour favoriser les échanges avec la France et l'Angleterre, et n'interdit pas aux chrétiens de pratiquer leur religion.
Il est difficile de connaître le parcours exact du transport La Licorne, car les allers-retours d'île-en-île ont dû être fréquents. Les bâtiments qui composent la division navale de la côte orientale d'Afrique passent généralement l'été à Saint-Denis pour se ravitailler, et partent à l'automne dans les différentes colonies pour passer l'hiver. A bord de la Licorne, les marins doivent supporter Charles Lullier, un enseigne de vaisseau paresseux, pervers, orgueilleux et violent qui se livre à de nombreux actes d'insubordination. Le 2 juin 1862, alors que la Licorne quitte Saint-Denis pour se rendre à Mayotte et Nossi-Bé, il s'oppose violemment à ce qu'un commissaire de police, envoyé par le gouverneur de la Reunion à Mayotte, soit à la table des officiers. Peu de temps plus tard, il refusera de prendre son quart et insultera le commandant Latapie. Il sera renvoyé en France, puis de la marine. Voulant se présenter à la députation du Finistère, puis se lancer dans une carrière de journalisme, il écrira des courriers d'insultes et de menaces à destination de l'amiral Rigault de Genouilly. Quelques années plus tard, il sera emprisonné pour avoir tenté d'étrangler une femme dans une maison de tolérance où elle travaillait, et sera encore emprisonné au moment de la Commune. Après avoir passé le début de l'été à Mayotte, La Licorne sera de retour à Saint-Denis le 29 juillet, avec à son bord 123 soldats d'infanterie de marine.
L'année suivante, le 4 avril 1863, Paul est nommé aspirant de première classe. Le 27 avril, alors que la Licorne est en direction de la Réunion, le commandant de la Licorne, Latapie, meurt en mer. Il sera remplacé par Bienvenue.
Le 11 mai, Radama II est retrouvé étranglé dans son palais, un assasinat revendiqué par les conservateurs menés par Rainivoninahitriniony, très ouvertement hostiles à la France. Le nouveau pouvoir en place établit que le règne de Radama II n'a jamais existé, et que l'intégralité des traités signés pendant cette période n'ont donc jamais existés. Le capitaine Dupré, qui semble ne pas être au courant de cet événement, se dirige alors sur Tatamave à Madagascar à bord de l'Hermione, où il pense être accueilli en ami. La Licorne est envoyé le 31 mai au devant de l'Hermione par le gouverneur de La Reunion qui craint que Dupré ne soit assasiné. Elle sera ralliée par une partie de la flotte dans les jours suivants, car la France veut faire pression sur le nouveau gouvernement et menace de bombarder Tatamave. Cette opération n'aura pas été en vain car Dupré obtient le maintien du nouveau régime le maintien des relations commerciales avec la France et la liberté religieuse pour les chrétiens sur l'île. Il était primordial pour la France de rester en bonnes relations avec Madagascar car elle était en train de creuser le canal de Suez, et avait conscience qu'avec les progrès maritimes, ces îles seraient bientôt très proches de l'Europe.
A l'automne 1863, la Licorne est de retour à Saint-Denis. Bienvenue est remplacé par Panon du Hazier le premier septembre. Le navire se rendra ensuite sur l'île Sainte-Marie. Il en partira le 15 novembre et sera de retour le 22 à st Denis.
Au cours de l'année 1864, sa mission commencée il y a trois ans, La Licorne est rappelée en France. Paul arrive à Brest à l'automne. Le 21 octobre, Paul est envoyé trois mois sur le Souffleur, une corvette à roue, très peu maniable à la voile, principalement utilisée comme remorqueur. Le 4 janvier 1865, il passe une semaine dans le port de Brest sur la frégate la Guerrière, avant d'être embarqué pour trois mois sur le Louis XVI, un vaisseau école servant à l'apprentissage du canonnage. Paul a sans doute besoin de compléter ses connaissances techniques. Le 4 avril 1865, il est nommé Enseigne de vaisseau, et quatre jours plus tard on l'envoie à terre dans le port de Brest, où il passera 7 mois. Il est possible que ce soit encore pour compléter sa formation.
Nouvelle-Calédonie et Tahiti
Le 18 septembre 1865, Paul embarque sur la Sibylle, une frégate à voile commandée par le capitaine de frégate Riou-Kerangal. C'était un solide bateau, dernier vestige de nos anciennes escadres. Pendant plus d'un quart de siècle, vaillante et gracieuse, serrant bien le vent, ne manquant pas un virement de bord, se comportant à la grosse mer comme un bon cavalier indulgent aux vivacités de sa monture, la Sibylle avait chevauché les vagues de tous les océans. Mais le temps des combats sous voiles était passé, et la vieille frégate, en dépit de sa belle prestance, n'avait plus de valeur militaire. Elle arborait encore, cependant, la flamme aux couleurs nationales, signe distinctif du navire de guerre, et quatre canons de calibre moyen la protégeaient contre l'improbable insolence de canots de sauvages ou de jonques de pirates. La mission qu'elle se devait désormais de remplir consistait à transporter en Nouvelle-Calédonie des convois de forçats et à faire la relève du personnel
de nos colonies de l'océan Pacifique.
La Sibylle quitta Brest le 15 décembre pour se rendre à Toulon. Alors qu'elle franchissait le Cap Saint-Vincent au sud du Portugal, le 28 décembre, elle se porta au secours de l'Emma, navire marchand du Havre, revenant de l'Inde. Ce navire avait 143 jours de mer depuis sa dernière relache à Maurice, et tout son équipage était atteint de scorbut. La Sibylle put founir en hate du café, du citron et du quinquina aux malheureux. Elle arriva à Toulon au début de l'année 1866. Le 20 janvier, après avoir embarqué l'avant veille les passagers libres, la Sibylle embarqua en une matinée 200 forçats condamnés à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Le bagne de Toulon étant surchargé, la France à décidé de se débarasser de nombreux pensionnaires. Après trois mois de traversée, la frégate passe le Cap de Bonne-Espérance et arrive à la Réunion le 20 avril, pour y faire une escale d'une dizaine de jours, avant de reprendre la mer pour Sydney, puis Nouméa qu'elle atteind à la mi-juillet.
Le 3 aout 1866, la Sibylle quitte la Nouvelle-Calédonie transportant à son bord un certain nombre d'officiers et de militaires rentrant on France. La Sibylle emporte aussi sept caisses contenant les produits et objets que la colonie envoie à l'Exposition universelle de 1867 comme du riz, du blé, de l'orge, du maïs, de l'avoine, du sucre brut, des huiles, du thé, du café, des biches de mer, de l'écaille de tortue, des briques, un immense bloc de jade provenant l'île Ouon... Elle passera pour son retour par Papeete où elle mouille le 28 aout. L'équipage et les passagers sont accueillis avec une sympathie bien naturelle.

La Sybille quitte Tahiti, franchit le Cap Horn pendant l'automne, et remonte sur la France pour boucler son tour du monde. Elle repartira de Toulon avec 200 nouveaux forçats au mois d'avril de l'année suivante, pour effectuer le même trajet que l'année précédente jusqu'à Nouméa. Le 30 novembre 1867, la Sibylle lève les voiles pour la Cochinchine, devenue française depuis le traité de Saïgon en 1862. Entre temps, Paul apprend le décès de son frère ainé Emile, qui s'était établi comme négociant en Argentine. Il trouva la mort le 11 octobre à Buenos-Aires, il avait un fils de sept ans nommé Henri.
Indochine
Paul arrive à Saïgon au début de l'année 1868. Il quitte la Sibylle le 1er février pour embarquer sur Le Duperré, un vaisseau caserne stationnant dans la rivière de Saïgon qui accueille les marins qui sont en attente de destination. Il y reste deux mois jusqu'à ce qu'on l'envoie sur les chaloupes cannonières Hache puis Javeline, annexes du Duperré, où il restera six mois sur chacune d'entre elles. Ces bateaux, principalement utilisés pour l'exploration et la surveillance des rivières, étaient équipés de deux canons et pouvaient transporter une trentaine d'hommes. A cette même époque, Francis Garnier est en train de terminer sa mission d'exploration du Mékong commencée en 1866. La tradition familiale raconte que Paul aurait participé à cette mission. Il est possible que ce soit le cas, car il était à bord du Hache pendant les trois derniers mois de l'expédition qui aurait pu êtree utilisé sur le Mékong. Quoi qu'il en soit, sa participation, si elle a eut lieu, a du être très mineure car Paul est arrivé sur le Hache le 1er avril 1868, et la mission Garnier s'est terminée le 29 juin de la même année. La Javeline sera utilisée cinq ans plus tard par l'explorateur Louis Delaporte, en mission à Angkor.

Le 29 avril 1869, l'amiral Ohier, gouverneur de Cochinchine, confit à Paul le commandement de la chaloupe-canonnière Mousqueton. Un bateau du même type que le Hache et la Javeline, affecté lui aussi à la défense et l'exploration des rivières. Le 11 août, Paul est nommé Lieutenant de vaisseau, puis le 28 octobre, en récompense de ses services militaires rendus, il aurait été fait chevalier de l'ordre royal du Cambodge (cette information n'apparait nulle part dans son dossier militaire).
Le 5 mars 1870, après avoir passé plus de deux ans en Indochine, Paul embarque sur le transport la Creuse, à destination de Suez. Le navire quitte Saïgon le 10 mars et arrive à Suez le 7 avril. Paul y débarque le lendemain et embarque sur la frégate la Dryade qui se rend à Alexandrie. Le 17 avril, la frégate quitte Alexandrie pour Toulon avec 833 passagers, dont fait partie Paul. Elle fera une escale de deux jours à Messine, les 24 et 25 avril, avant de débarquer à Toulon le 6 mai.
Guerre de 1870 - Siège de Paris
Paul remonte alors sur Brest, où il restera à terre pendant trois mois et apprendra la déclaration de guerre de l'empire Français envers le royaume de Prusse. Dès que, le 7 août, la nouvelle des défaites successives des français parvint à Paris, et il fallut songer à armer la capitale, Son Excellence Monsieur l'amiral Rigault de Genouilly, ministre de la marine et des colonies, sollicita pour la marine l'honneur de défendre tous les forts. Cette mesure avait l'avantage de permettre au département de la Guerre d'employer de plus nombreuses troupes de toutes armes à la formation des armées actives, et de conserver dans ces dernières un nombre considérable d'artilleurs pour le service des batteries de campagne.
Six forts seulement, Romainville, Noisy, Rosny, Ivry, Bicêtre, Montrouge et les deux batteries de Saint-Ouen et de Montmartre, furent dès le principe confiés exclusivement à la marine. En outre, une flottille, composée de navires de divers modèles , fut destinée à opérer sur la Seine. Le régiment d'artillerie de marine et des troupes d'infanterie de marine et de gendarmerie maritime furent également appelés à Paris.
Les ordres furent immédiatement expédiés dans les ports de former douze bataillons de marins, renfermant tous les matelots-canonniers et matelots-fusiliers disponibles. On en trouva les éléments principaux dans les équipages des bâtiments déjà armés à Brest et à Cherbourg, et destinés au corps expéditionnaire de la Baltique, dont le départ venait d'être contremandé. Paul est affecté dès le 8 août sur le vaisseau Louis XIV, dont l'équipage est immédiatement réquisitionné et expédié à Paris pour participer à la défense de la ville. L'équipage entier du vaisseau-école des canonniers, le Louis XIV, fournit le plus important et le plus solide contingent de matelots-canonniers.
Quatre bataillons d'infanterie de marine furent formés et augmentés successivement d'un certain nombre d'hommes revenus de Sedan. Dix-sept cents hommes de l'artillerie de marine furent prêtés au département de la guerre, qui les distribua principalement dans les forts de Saint-Denis et dans les secteurs de l'enceinte. Tout ce personnel arriva à Paris par les voies ferrées au fur et à mesure de sa complète formation. Chaque homme devait être muni de ses armes et d'un sac approprié au service à terre. Le personnel de la flottille fut envoyé de Toulon pour les batteries flottantes et les vedettes, de Brest pour les canonnières. Dans le cours du siège, plusieurs bastions de l'enceinte furent armés de canons de la marine servis par des matelots. Les huit compagnies du Louis XIV constuèrent le 11e bataillon de marins et furent réparties dans tous les forts, qui reçurent chacun une compagnie. Chaque compagnie ne comportait pas moins de 200 à 250 hommes, faute d'officiers et de sous-officiers pour la constituer au chiffre réglementaire. La compagnie de Paul est envoyée au fort de Bicêtre, au sud de Paris, et intègre le 9e bataillon de marins commandé par le capitaine de frégate Fournier. Paul, secondé par l'enseigne de vaisseau Véron, en commande la 4e compagnie.
Les forts de la marine formèrent deux groupes séparés : les trois forts situés à l'Est, Romainville, Noisy, Rosny, composaient une première subdivision sous les ordres du contre-amiral Saisset, dont le quartier général était au fort de Noisy, et les trois forts du Sud, Ivry, Bicêtre, Montrouge, composaient une deuxième subdivision sous les ordres du contre-amiral Pothuau, qui s'établit au fort de Bicêtre. Chaque fort fut placé sous le commandement supérieur d'un capitaine de vaisseau, investi des droits et prérogatives que confère aux commandants supérieurs le décret du 13 octobre 1863, portant règlement sur le service des places. Ces fonctions furent données à des capitaines de frégate dans les forts où résidaient les contre-amiraux. Le commandement de la batterie établie à Saint-Ouen, dans le parc Le Gentil, fut confiée au capitaine de frégate Coudein; celui des deux batteries établies sur les buttes Montmartre au capitaine de frégate Lamothe-Tenet. Ces batteries furent mises le 14 septembre sous la direction supérieure des commandants de l'artillerie de leur circonscription.
Tout le personnel marin fut soigneusement épuré dès le début, et les officiers ou les hommes qui, par leur conduite ou leurs antécédents, ne furent pas jugés dignes de l'honneur de concourir dans nos rangs à la défense, furent renvoyés dans leurs ports. Le vice-amiral commandant en chef, par un ordre général du 13 août, rêgla ainsi qu'il suit le service intérieur des forts :
ART. 1er. Les forts seront tenus comme des vaisseaux.
ART. 2. Le service s'y fera conformément au décret du 20 mai 1868 sur le service à la mer, en tout ce qui ne sera pas contraire aux règlements sur le service des places.
ART. 3. Les commandants des forts se conformeront aux observations qui leur seront faites par les commandants de place, en ce qui concerne le service de place.
ART. 4. Le plus ancien des lieutenants de vaisseau canonniers sera spécialement attaché à l'artillerie.
ART. 5. Un officier sera désigné dans chaque bataillon pour remplir les fonctions d'officier d'armement. Un autre sera chargé du casernement.
ART. 6. Tous les officiers habiteront les logements d'officiers dans les forts, excepté à Romainville, où le nombre des chambres est insuffisant. Des dispositions spéciales seront prises pour ce fort.
ART. 7. Les officiers tiendront leur table dans les forts.
ART. 8. Les commandants des bataillons se feront remettre la liste des hommes choisis pour être domestiques d'officiers, plantons, etc. Cette liste sera envoyée au commandant en chef.
ART. 9. Le nombre des domestiques sera déterminé conformément au règlement sur le service à bord.
ART. 10. Aucune permission ne sera accordée aux marins et quartiers-maîtres avant que le commandant en chef ait donné des ordres à ce sujet. Des officiers mariniers en petit nombre pourront en obtenir, s'ils démontrent que leurs familles habitent effectivement Paris. Ils devront être rentrés avant le coucher du soleil.
ART. 11. Après le coucher du soleil, personne, excepté les officiers, ne pourra sortir des forts.
ART. 12. La surveillance la plus active sera exercée au sujet de l'exécution des dispositions qui précèdent.
Le vice-amiral commandant en chef,
Signé : DE LA RONCIÈRE-LE-NOURY
Un ordre en date du 15 août, prescrit en outre que Messieurs les officiers résidant dans les forts devront être toujours en uniforme. La tenue devra être correcte et absolument conforme aux règlements. Un ordre général, en date du même jour, prescrit encore « qu'aucune personne étrangère aux forts ne devra y pénétrer, à moins d'être munie d'un permis nominatif émanant soit de la place de Paris, soit des commandants du génie et de l'artillerie, soit des contre-amiraux commandant les subdivisions, soit enfin du vice-amiral commandant en chef.
Enfin, le 18 août, lorsque la plus grande partie du personnel est arrivée à Paris, le vice-amiral adresse l'ordre du jour suivant à la division des marins détachés dans les forts :
« Officiers , officiers mariniers et marins,
Vous êtes appelés à Paris pour concourir, avec vos frères de la garde nationale et de l'armée, à la défense de la capitale. La patrie compte sur votre courage, votre dévouement et votre sentiment de la discipline. Vous ferez voir que ces vertus qui animent l'homme de mer ne sont pas moindres sur le terrain d'un bastion que sur le pont d'un vaisseau. Vous serez sur les remparts de Paris ce, que vous avez été aux tranchées de Sébastopol. Et si l'heure devait sonner d'un effort suprême, votre patriotisme et votre valeur témoigneraient que vous étiez dignes d'être choisis pour défendre le cœur de notre chère patrie.
Le vice-amiral commandant en chef,
Signé: DE LA RONCIÈRE-LE-NOURY. »
Dans ce but, l'équipage entier du vaisseau le Louis XIV étant venu à Paris, ce vaisseau devint nominalement le centre administratif de la division des marins. Chaque bataillon fut considéré comme un bâtiment annexe du Louis XIV, et s'administrant comme tel avec un rôle particulier et un conseil d'administration. Paul est affecté à l'annexe 8 du Louis XIV. Chaque bataillon d'infanterie de marine s'administra également lui-même sous la surveillance du chef du service administratif.
On rassembla dans les forts pour soixante-quinze jours en moyenne d'approvisionnements de toutes sortes : vivres de campagne, effets d'habillement, chauffage, luminaire, savon et tabac. Des marchés furent passés pour assurer le renouvellement de ces approvisionnements. Un certain nombre de médecins de la marine, sous la direction centrale d'un médecin principal, fut attaché à chaque fort. Des infirmeries de vingt-quatre lits par fort, au moins, furent disposées et munies de tous les médicaments et matériel nécessaires. Dès que la variole commença à paraître, nos hommes furent vaccinés. Les salons de réception du ministère de la marine furent transformés en ambulance, sous la direction de M. Reynaud, inspecteur général du service de santé de la marine. Plusieurs médecins de la marine furent appelés à Paris pour être mis à la disposition de l'armée de terre. Un aumônier de la marine fut attaché à chaque fort.
Tous les ingénieurs hydrographes du dépôt des cartes et plans de la marine furent mis à la disposition du vice-amiral commandant en chef. Ils furent chargés de lever les plans du terrain autour des forts, et des observatoires.
Au 8 août, les forts de la marine étaient dans la situation réglementaire de l'état de paix. Ils ne possédaient que leur armement de sûreté, composé de dix pièces et d'une batterie de campagne. Ils n'avaient aucune des installations nécessaires pour soutenir une attaque. Ainsi les embrasures n'étaient point prêtes; il n'y avait ni poudrières de service sur les bastions, ni traverses, ni pare-éclats, etc., etc. Les cours des forts étaient encombrées de matériel et notamment de pièces destinées à armer l'enceinte. Le fort de Montrouge particulièrement était un dépôt central d'artillerie, et un atelier de quatre cents femmes y fabriquait des cartouches. La portée et la puissance des pièces destinées depuis plusieurs années à armer les forts étaient aujourd'hui insufissantes.
On songea de suite à faire venir des ports des canons de la marine, en fonte, dont les portées vont jusqu'à 6,500 à 7,000 mètres. Le poids de ces canons, avec leur affût, est de 6 à 12 tonneaux, et leurs obus pèsent de 32 à 52 kilos. La charge de poudre est en moyenne le sixième du poids du projectile. 183 canons arrivèrent à Paris. Chaque pièce, munie de son armement complet, fut accompagnée d'un approvisionnement de deux cent cinquante coups. Huit mille caisses à poudre, pleines ou vides, les suivaient. On commanda en Angleterre cent cinq mille grands sacs à terre. Cinq cent mille rations complètes furent envoyées des ports militaires à Paris. L'encombrement des chemins de fer apporta dans cet envoi de très grands obstacles. Dès le 21 août, un marché de vivres, pour la valeur de trois millions, fut passé dans les principaux ports de commerce. Les vivres provenant de ce marché purent arriver à Paris avant l'investissement.
C'est grâce à la prodigieuse activité de M. l'amiral Rigault de Genouilly, parfaitement secondé par l'administration de la marine, que cet immense matériel et ces approvisionnements de toute nature purent arriver en temps utile dans la capitale.

Dès le mois d'octobre, on songea à mettre des canons sur des trucks de chemin de fer en les garantissant avec un blindage de 6 centimètres d'épaisseur. M. Dupuy de Lôme, inspecteur général du génie maritime en retraite et membre du comité de défense, fut chargé de surveiller la construction de ces wagons. Chacun des wagons fut armé par treize marins, et chacun des autres par dix-huit.
Dès que les forts eurent un armement suffisant en personnel, leurs équipages se mirent à l'oeuvre pour venir en aide aux services du génie et de l'artillerie. Les matelots furent employés à toute nature de travail. Il y avait un véritable chaos à débrouiller, et chacun se mit avec une fiévreuse ardeur à tous les travaux de défense des forts et de leurs approches. De nombreux ouvriers civils furent embauchés par le génie. Les canonniers et les artilleurs de la marine s'employèrent à la confection des gargousses, des artifices, au chargement des obus et des bombes. Les charpentiers de la marine firent les abatis d'arbres nécessaires. Des maisons, des murs un grand nombre, durent être rasés.
Le génie militaire fit construire sur les bastions des poudrières, des traverses et des abris. Il établit des pare-éclats dans les cours, des masques devant les portes des forts. Il fit étayer les étages inférieurs des casernes et blinder les planchers avec du sable. Enfin, il installa tous les abris qu'il crut nécessaires eu égard à la puissance nouvelle acquise par l'artillerie moderne, les forts ayant été construits à une époque où cette puissance était loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Une épaisseur de trois mètres de sacs à terre dut être placée contre le mur de fond des casemates, dont l'épaisseur était tout à fait insuffisante. Il importait d'assurer dans les forts l'approvisionnement en eau. Chacun d'eux était muni d'une citerne qui se remplissait à l'aide de dérivations très habilement faites par M. l'ingénieur Marchant, directeur de la Compagnie des eaux de Paris. Des prises d'eau furent organisées dans diverses parties des forts pour les cas d'incendie et aider au service de propreté.
Les casemates furent disposées de manière que les hamacs des hommes pussent être pendus. Ces hamacs, quoique faute de temps on n'ait pu en faire venir qu'un nombre insuffisant, furent une grande ressource à la fin du siège, alors que la paille vintà manquer.
On devait naturellement songer à entourer les forts de torpilles. Le capitaine de frégate Lefort, qui avait été à la tête de l'école des torpilles à l'île d'Oléron, fut chargé de ce travail pour les forts de la marine. On fit venir pour le seconder un certain nombre d' hommes de cette école. Le capitaine de frégate Trêve fut chargé du même service pour certains des autres forts. M. Dupuy de Lome s'en occupa autour de l'enceinte de la rive gauche ; le génie militaire sur la rive droite. Afin de bien se rendre compte du résultat, l'amiral fit faire des expériences dans le parc de Villeneuve-l'Étang , qui donnèrent des résultats satisfaisants.
M. l'ingénieur hydrographe Delamarche fut chargé, dès le 14 août, de faire dresser des cartes des environs des forts, indiquant tous les points remarquables avec leurs distances aux divers bastions. Le travail fut partagé entre deux ingénieurs assistés des sous-ingénieurs.
Les forts furent reliés entre eux et avec la càpitale par des fils électriques dont quelques-uns étaient souterrains. Ils furent également reliés au moyen d'une communication aérienne établie à l'aide d'un mât, d'une vergue et d'un télégraphe marin à pavillons, et à signaux de grande distance au moyen de bombes et de cônes. Sur certains points choisis de l'enceinte continue, on établit également une communication avec le télégraphe marin. Il en fut de même pour plusieurs monuments de Paris d'où on pouvait surveiller les travaux de l' ennemi. Les timoniers de la marine, rompus à ce genre d'observations, et munis de longues-vues, de boussoles, de micromètres, de binocles de nuit, desservaient ces postes, qui avaient été pourvus en outre de feux de Bengale et de fusées de diverses couleurs. La marine fut chargée d'installer de semblables postes dans tous les autres forts et aux points correspondants de l'enceinte continue, et d'y établir un personnel marin permanent. Pour les signaux de nuit, on fit usage du système Godard. Ce système consiste en un fanal armé d'un puissant réflecteur et muni de deux écrans mobiles, l'un opaque, l'autre rouge. Le jeu alternatif de ces écrans donne plusieurs combinaisons de chiffres qui se traduisent dans le dictionnaire télégraphique marin. Ce système fut perfectionné par M. Lissajoux. Ce savant concentrait les rayons lumineux de façon à ne les rendre visibles que pour les observateurs, et produisait des intervalles de brèves, de longues et de longues doubles analogues aux points et aux traits de l'appareil Morse. Un code de signaux complet à l'usage du siège fut rédigé. Tous les points principaux des environs de Paris avaient une désignation. Des chiffres secrets furent remis à chaque chef. L'emploi de la lumière électrique fut un des meilleurs moyens de vigilance.
Les ballons ont joué un grand rôle dans le siège. Tout d'abord des ballons captifs furent organisés par MM. Godard et Nadar. Un certain nombre de marins furent mis à la disposition de ces aéronautes. Mais les observations dans ces ballons, rappelés toujours par la corde qui les retenait à terre, étaient très-difficiles, par suite des secousses que donnait cette corde. On fit partir ensuite un certain nombre de petits ballons pouvant porter un paquet de lettres formant un poids d'un kilogramme, et réglés, en tenant compte des circonstances atmosphériques, de manière à tomber à une distance de douze lieues au moins de Paris. Ces ballons eurent des chances diverses.

Lorsque, sur la proposition de M. Rampont, directeur général des Postes, le gouverneur décida l'envoi de ballons montés, le nombre des aéronautes se trouvant insuffisant, M. Godard organisa à la gare d'Orléans une école composée de marins de bonne volonté qui fournirent pendant tout le siège aux besoins du service des ballons expédiés par cet aéronaute.
Le vice-amiral commandant en chef adressa le 13 septembre aux contre-amiraux et commandants supérieurs l'ordre du jour suivant contenant le résumé de ses prescriptions :
« La période d'organisation des forts, dont la défense est confiée à la marine, est aujourd' hui terminée. Il ne reste plus que quelques détails à perfectionner, que quelques approvisionnements à compléter. Nos efforts doivent actuellement, dans le peu de jours qui nous restent d'ici à l'arrivée de l'ennemi, se porter plus particulièrement sur les exercices militaires. Vous devez faire journellement des branle-bas de combat complets, pour que chacun connaisse à fond son poste. Vous devez également faire des branle-bas de combat de nuit, en prévenant votre monde la première fois, et ensuite en les ordonnant inopinément. La force d'un vaisseau, vous le savez, consiste autant dans l'habileté de l'équipage qui le monte que dans l'esprit de cet équipage. C'est à entretenir cet esprit que vous devez vous attacher. Vos différents rapports me donnent l'assurance que cet esprit est bon parmi nos marins. L'expulsion de quelques hommes qui ne s'étaient pas montrés dignes d'occuper les postes d'honneur qui nous sont confiés ne peut que servir d'exemple. L'esprit de l'infanterie de marine, d'une nature peut-être différente, eu égard aux différences d'habitude et de discipline, est également bon. Mettez tous vos soins à l'entretenir, et à ne pas créer parmi les deux éléments qui forment l'équipage des forts d'autre antagonisme que celui de la rivalité du courage et de l'accomplissement du devoir. Les troupes du génie se composent d'hommes d'élite. Je ne pourrais assez vous engager à accorder à ces braves et infatigables soldats toute l'estime qu'ils méritent.
Vous savez qu'il est de règle que l'équipage d'un fort doit être divisé en trois parties ou trois quarts. L'un de ces quarts fait ce que l'on peut appeler le service militaire : il est aux pièces et est chargé de la surveillance, des factions, etc., etc. Un autre quart fait le service intérieur de la caserne, les corvées, la propreté, etc., etc. Enfin le troisième quart se repose.
Je vous recommande de respecter le repos autant que possible. Un homme ne travaille bien, ne veille bien, nous en avons , l'expérience, que quand il est bien reposé. Le service le plus important du fort, comme à bord d'un vaisseau, c'est la surveillance extérieure. C'est sur ce point que je tiens à attirer le plus particulièrement votre attention, et je ne saurais assez insister sur la nécessité de faire comprendre à vos subordonnés l'extrême utilité de cette partie du service, dont toutes les autres, pour ainsi dire, dépendent. Il n'est pas possible d'admettre qu'un fort puisse être surpris. Une telle occurrence serait la honte éternelle de celui qui le commande. Votre principale attention devra donc se porter sur cette surveillance. Dans ce but, vous multiplierez les factionnaires et les patrouilles, avec lesquels il faut organiser des signaux de convention au moyen des cornets à bouquin et des sifflets de maître ; vous ferez un usage constant des longues-vues de jour et de nuit, dont chaque officier, conformément à nos règlements , doit être pourvu ; vous dresserez les factionnaires et les veilleurs à se servir de l'ouïe non moins que de la vue; vous rechercherez enfin tous les moyens de savoir ce qui se passe autour de vous. C'est ainsi que vous pourrez vous garder et être toujours prêt, quelque entreprise que tente l'ennemi. Votre appareil électrique peut vous être d'un bon secours dans le même but. N'en faites pas un usage permanent, et changez-le souvent de place, en le mettant alternativement aux extrémités des divers bastions, en le transportant même en dehors du fort, afin qu'il trompe l'ennemi sur sa situation exacte. C'est dans ce but que je vous ai prescrit de le rendre portatif. Suivez les mêmes prescriptions pour l'appareil Godard, que vous pourriez munir d'écrans.
Il faut que vos officiers connaissent à fond le terrain qui entoure les forts jusqu'à une certaine distance, qu'ils en étudient les accidents, les points qui pourraient servir d'abris à l'ennemi, les chemins, etc., etc. Cette connaissance est aussi utile aux officiers qui dirigent l'artillerie qu'à ceux qui sont destinés à opérer dans les sorties. J'ai, dans ce but, fait dresser des cartes de détail sur lesquelles tous les points remarquables sont indiqués avec leurs distances. Faites apprendre ces cartes par vos officiers, qui doivent en faire des copies. Je vous ai fait distribuer en outre plusieurs exemplaires des plans des environs des forts. Assurez-vous que les officiers les étudient dans le cabinet comme sur le terrain.
Je vous recommande d'exiger du silence dans le fort. Tout bruit extraordinaire peut être une indication pour l'ennemi, de même que tout mouvement apparent. Rien ne doit faire pressentir à l'extérieur ce que vous vous proposez de faire ni ce qui se passe à l'intérieur.
Je vous ai prescrit de choisir un certain nombre d'hommes d'élite qui seraient parfaitement familiarisés avec les chemins qui relient les forts entre eux et avec l'enceinte continue. Ces hommes devront avoir un signal de reconnaissance. Les signaux électriques ou aériens peuvent en effet être détruits ou entravés. Les officiers devront eux-mêmes être au courant de cette topographie. Il est telle circonstance où c'est un officier qui doit aller porter un ordre ou une information.
Pour le service de l'artillerie, je n'ai aucune recommandation particulière à vous adresser. L'éducation de vos canonniers est complète. Étudiez les portées de vos pièces particulièrement. Cette observation est surtout utile pour les pièces de bronze, que nos marins connaissent moins. Pour la mousqueterie, vous ne sauriez assez recommander de tirer lentement en visant à chaque coup. Contenez l'ardeur de vos hommes en ne faisant tirer qu'au commandement; ce n'est qu'ainsi qu'on peut viser la majorité des hommes à atteindre. On consomme autrement toutes les cartouches sans effet utile.
En ce qui touche au génie, je vous prescris de toujours prendre l'avis de l'officier du génie que vous avez près de vous. Il est dans le service des forts une quantité de sujets sur lesquels, nous autres marins, nous ne saurions nous prononcer avec connaissance de cause. La spécialité de l'officier du génie vous sera excessivement précieuse, et vous devez toujours prendre en très grande considération les opinions qu'il émettra. Dans ce but, vous ferez appel à son dévouement, et vous aurez soin de faire comprendre à vos officiers, même ses supérieurs , toute la déférence dont ses avis doivent être entourés.
Tout en entretenant chez vos hommes le courage nécessaire devant le danger, évitez soigneusement de les exposer inutilement. Leur vie nous est précieuse, et nous n'avons pas les moyens de renouveler les vides qui se feront dans nos rangs. Dans les sorties seulement, faites preuve de la plus grande hardiesse. L'audace est toujours un élément de succès. Ne craignez pas alors d'exposer votre monde si vous devez en obtenir un résultat.
C'est contre les projectiles explosibles que vous devez surtout vous garer. Mettez toute votre intelligence à vous préserver de leurs effets. Ayez soin de tenir éloignés les uns des autres, dans l'intérieur des forts, les objets facilement incendiables que vous aurez dû y laisser. Lors du bombardement , ne laissez circuler que les hommes de service. Dans le cas où l'ennemi ferait usage de bombes à pétrole, vous devez savoir que le pétrole s'éteint en le couvrant de sable, ou, à défaut, de terre. Si vous êtes exposé à un assaut ou à une escalade , tenez prêts des fagots imbibés de pétrole pour, les jeter dans les fossés ou sur les assaillants. C'est dans ce but que j'ai fait munir les forts de cette matière inflammable.
Plusieurs torpilles ont été posées autour de vous. Vous pourrez vous en servir au moment opportun. Ce n'est pas au passage des premiers assaillants qu'il faut les faire éclater, c'est seulement lorsqu'un certain nombre d'entre eux les a dépassées. Tâchez de ne pas les employer toutes lors d'une première attaque.
Vous devez avoir dans les casemates qui renferment vos vivres de campagne quelques barils de poudre auxquels doivent aboutir les fils d'une pile électrique placée convenablement. C'est afin que si, dans un moment extrême, après avoir épuisé tous les moyens possibles de défense, après avoir perdu une grande quantité de votre équipage, vous vous voyiez réduit à faire sauter le fort, vous puissiez en même temps détruire tous les approvisionnements les plus utiles à l'ennemi. Il va sans dire que, dans une telle occurrence, vous feriez tous vos efforts pour enclouer d'abord les canons.
Je n'ai pas besoin de vous recommander d'apporter la plus stricte économie dans vos consommations; nul ne peut prévoir la durée du siège, les communications avec l'enceinte continue peuvent être difficiles. Considérez-vous toujours comme sur un vaisseau naviguant qui n'a d'autres ressources que ses propres approvisionnements.
Je ne saurais assez insister sur la nécessité d'entretenir le moral de votre personnel. Tout en ne cessant jamais les exercices, encouragez les jeux, les exercices gymnastiques, recherchez toutes les distractions que permettent les circonstances. Le moral de votre équipage ne vous assurera pas moins le succès que son éducation militaire; les marques de votre sollicitude continue pour le bien-être de vos subordonnés ne leur seront pas un encouragement moins puissant que leur patriotisme et le sentiment de leurs devoirs.
Je n'avais pas besoin de vous adresser les instructions qui précèdent; je me suis borné à mentionner les principales. Les prescriptions qu'elles renferment étaient déjà dans votre esprit, et il en est bien d'autres que votre intelligence rend inutile d'énumérer. Mais je tenais à vous faire savoir que nous étions en communion d'idées, et qu'ainsi vous trouveriez toujours en moi un appui qui n'est que le résultat de la confiance que j'ai en vous. En dehors de ce que la Providence décidera, je laisse avec sécurité le succès entre vos mains, certain que votre valeur, votre expérience et votre initiative ne feront pas défaut à ce que la patrie attend de vous.
Le vice-amiral commandant en chef,
Signé: DE LA RONCIÈRE-LE-NOURY. »
Au moment où l'ennemi a investi Paris, à la mi septembre, les forts confiés à la marine étaient dans un état de défense satisfaisant. La flottille, complètement armée, prête à agir. Dans les forts, divers travaux du génie exécutés à l'entreprise étaient encore à terminer, mais on était en état d'ouvrir le feu et de soutenir avec succès celui de l'ennemi. Ces forts, construits à une autre époque, dont plusieurs par suite étaient placés dans des conditions désavantageuses, étaient néanmoins dans un état de défense matériel qui eût nécessité de grands efforts de la part de l'ennemi. Le moral des marins, chargés de les défendre, était à la hauteur de la mission qui leur était dévolue. Ils avaient confiance en eux-mêmes, confiance en leurs officiers, confiance en leur amiral, enfin ils comptaient sur les instruments mis à leur disposition. Ce moral ne s'est jamais démenti.
Le bien-être relatif de chacun fut la préoccupation incessante du vice-amiral. Pendant tout le temps du siège, les hommes eurent des vêtements complets de travail, des bas de laine, des ceintures de flanelle, de chaudes capotes d'infanterie, de bonnes chaussures, et, autant qu'il fut possible, des peaux de mouton. Les officiers, logés dans l'intérieur des forts, exerçaient sur eux et sur leur bien-être une surveillance de tous les instants. Les habitudes de la marine se prêtaient d'ailleurs à cette sollicitude, qui avait pour fruit une obéissance parfaite.
Le 2 septembre, l'empereur Napoléon III capitule à l'issue de la bataille de Sedan. Il est fait prisonnier. La nouvelle est connue à Paris le 3 septembre, y déclenchant des troubles et conduisant à la proclamation de la République française du 4 septembre 1870. Le gouvernement de la Défense nationale, composé de députés républicains de Paris est formé, avec à sa présidence le général Trochu.
Cette révolution survint au milieu de l'ardeur des préparatifs. La discipline ne subit dans ce cataclysme aucune atteinte. La défense de la patrie étouffait tout autre sentiment, et le vice-amiral commandant en chef avait pu écrire, le 8 septembre, au contre-amiral de Dompierre d'Hornoy, délégué au ministère de la marine :
« Dans les circonstances graves où se trouve la France, les officiers et marins détachés à Paris demeurent animés du plus ardent patriotisme. Ayant l'honneur d'être à leur tête, je me porte garant que leur unique sentiment est celui d'un entier dévouement pour le salut de la patrie, et je suis fier d'avoir à leur en donner l'exemple. »
A partir de ce moment là, les allemands arrivant sur la capitale, les événements se succèdent rapidement, et les journaux du siège ainsi que les rapports des officiers nous mettent à même de suivre jour par jour les opérations auxquelles la marine fut appelée à prendre part. Les journaux du siège du fort se trouvent dans l'ouvrage "La Marine au siège de Paris", écrit par le vice-amiral Bon de La Roncière-Le Noury, commandant en chef des opérations de la marine lors du siège de Paris, d'après les documents officiels, écrit en janvier 1872. La lecture du journal de siège du fort de Bicêtre, où Paul servait, nous apprend que le fort eut à repousser quelques attaques à la fin du mois de septembre. La fin de l'année 1870, fut plus calme et la plus grande activité du fort fut alors de soutenir le fort de Montrouge, très affaibli par de nombreuses attaques successives, en bombardant différents points stratégiques occupés par les prussiens. Le 17 janvier 1871, Paul fut envoyé au fort de Montrouge, pour combler les lourdes pertes que ce dernier avait subit la veille. Les derniers jours du mois de janvier furent pour le fort de Montrouge extrèmement éprouvant, comme nous le montre la lecture du journal de siège de la place.
Extraits du journal de siège du fort de Montrouge
16 janvier : A sept heures cinquante minutes du soir, le gouverneur transmet toutes ses félicitations au commandant et aux braves défenseurs du fort de Montrouge. Il annonce qu'il va y envoyer de nouvelles corvées, et notamment des troupes du génie pour les réparations les plus urgentes. Notre bastion, sur lequel l'ennemi s'est acharné, est fort endommagé. Montrouge a tiré dans cette journée 530 obus et 86 bombes. Mais il a été cruellement éprouvé : il a 6 tués et 7 blessés. Une seule bombe lui a tué 4 hommes et mis un cinquième hors de combat. Le capitaine de frégate Kiesel est blessé mortellement. Le vice-amiral commandant en chef, qui se trouve près de ce brave officier, lui prodigue les paroles les plus encourageantes. Le lieutenant de vaisseau Santelli, blessé de nouveau, persiste à rester à son poste au bastion. Enfin à neuf heures du soir, le lieutenant de vaisseau Saisset, fils unique du vice-amiral commandant les forts de l'Est, est tué roide par un boulet venant de pièces légères que l'ennemi approche du fort la nuit, à l'abri de ses batteries de position.
17 janvier : L'ennemi continue à envoyer des obus sur les quartiers de Paris de la rive gauche. Messieurs les lieutenants de vaisseau Gigon, Testard, Dorlodot-Dessart, et l'enseigne de vaisseau Servan sont envoyés de Bicêtre et d'Ivry au fort de Montrouge pour combler les vides que la mort a faits parmi nos camarades.

18 janvier : Ces bombes nous occasionnent nos plus grandes avaries et aussi nos plus grandes pertes de personnel. Le tir des obus de gros calibre, quoique assez précis, ne nous a pas encore occasionné de grands dégâts. Quant à ceux de petit calibre, à la distance où nous sommes, ils sont plus gênants que nuisibles. Nos pertes sont sensibles, mais n'altèrent en rien le bon esprit de nos marins. Leur fatigue est excessive. Ils sont encore assez nombreux pour servir les pièces qui tirent, et d'ailleurs le feu de l'ennemi nous débusque chaque jour de quelque logement. Après que le coq a été tué dans la cambuse, un employé du télégraphe est blessé dans sa casemate, où les appareils ont été en partie détruits. Il nous faut déménager ces deux casemates et ne laisser dans les cours des bastions que les magasins de vivres où nous irons puiser pendant la nuit. Les cuisines sont déplacées aussi, le chemin à suivre pour y aller étant trop dangereux pendant la journée. En un mot, nous sommes obligés de nous concentrer chaque jour davantage. Mais c'est du malaise, voilà tout, et cela n'a rien à voir avec les conditions réelles de la défense. Beaucoup de projectiles n'ayant pas éclaté aujourd'hui, on a cru que l'ennemi nous avait envoyé des boulets pleins. Il faut plutôt attribuer cette circonstance à l'état de la terre détrempée. D'ailleurs l'ennemi est encore bien loin pour essayer de faire brèche. Les intelligents sapeurs du génie sont de plus en plus nécessaires pour nos travaux de réparation. La garnison de Montrouge garde toujours sa ferme attitude. En la voyant à l'œuvre, on comprend que pour nos marins comme pour leurs officiers, le mot devoir a toute sa signification.

19 janvier : A Montrouge, Monsieur le capitaine de frégate Vidal est grièvement blessé, le lieutenant de vaisseau Dordolot-Dessart moins grièvement. Nous avons en outre treize marins blessés. Deux brancardiers de la Société internationale qui viennent le soir chercher des blessés du fort [sont eux-mêmes atteints, l'un d'eux grièvement. Montrouge a tiré dans cette journée 362 obus. Le soir, une vive fusillade se fait entendre dans l'Ouest. Un feu nourri part du Mont-Valérien. A huit heures, la fusillade cesse.
20 janvier : Le fort de Montrouge continue à déployer, dans la lutte inégale qu'il soutient, les efforts les plus soutenus et les plus dévoués, malgré les pertes sensibles qu'il a faites parmi ses officiers et son équipage. Le temps est très-brumeux. L'ennemi envoie d'abord quelques coups sur le fort. Il accélère son feu vers neuf heures. A onze heures, la brume se dissipe, les batteries allemandes tirent plus vivement, et nous leur répondons modérément. A quatre heures le feu cesse des deux côtés. Vers sept heures du soir l'ennemi recommence par intervalles. Montrouge n'a que deux marins blessés aujourd'hui ; il tire 87 obus et 7 bombes.

21 janvier : Le tir des Prussiens est très-modéré jusqu'à onze heures, moment où la brume se dissipe. De une heure à quatre heures il devient beaucoup plus vif. Les batteries de Fontenay et les mortiers cessent le feu à quatre heures et demie. La batterie de l'Hay tire jusqu'à cinq heures. Pendant la nuit, le tir ennemi est très-lent sur Montrouge, mais un grand nombre de projectiles sont envoyés sur Paris. Calme complet aux avant-postes. Nos dégâts matériels sont peu considérables aujourd'hui. Nous avons un mobile tué et deux matelots blessés. Montrouge a consommé dans la journée 187 obus et 23 bombes.

22 janvier : A huit heures du matin, les batteries allemandes de l'Hay ouvrent leur feu sur Montrouge. Peu après, celles de Fontenay commencent à tirer sur les bastions 3 et 4 de ce fort. Les batteries de Châtillon tirent sur Vanves et les remparts. Les bastions 1 et 2 répondent à l'Hay. Les bastions 3 et 4 et la courtine 3-4 ripostent énergiquement aux batteries de Fontenay. De deux à quatre heures, le feu de l'ennemi est très-vif, surtout sur le bastion 4, contre lequel s'acharne Fontenay. Nos mortiers de 0m,22 tirent de temps en temps sur les points de Bagneux d'où partent des coups de fusil de rempart. Ceux de 0m,27 tirent sur Fontenay. Vers quatre heures, le feu cesse de part et d'autre. La nuit, l'ennemi tire à de longs intervalles sur le fort. Fontenay tire plus fréquemment sur Paris. Dans cette journée, nous avons eu plusieurs embrasures bouleversées ; la masse de mire du canon de 24 du saillant du bastion 3 est brisée par un coup d'embrasure; une pièce de 24 de la courtine 3-4, démontée également par un coup d'embrasure qui a brisé une roue; enfin, quelques épaulements et des traverses sont bouleversés par des bombes de om, 22. Nous avons quatre marins blessés, dont un quartier-maître canonnier grièvement. Nous tirons dans cette journée 286 obus et 38 bombes. A dix heures quarante minutes du soir, le général Le Flô, ministre de la guerre, adresse à tous les forts le télégramme ci-après : « Monsieur Jules Ferry, maire de Paris, a adressé à Messieurs les commandants des neuf secteurs la dépêche suivante : Quelques gardes nationaux factieux, appartenant au 101e de marche, ont tenté de prendre l'hôtel de ville. Ils ont tiré sur les officiers de service et blessé grièvement un adjudant-major de la garde mobile. La troupe a riposté. L'hôtel de ville a été fusillé des fenêtres des maisons qui lui font face de l'autre côté de la place et qui étaient d'avance occupées. On a lancé sur nous des bombes et des balles explosibles. L'agression a été des plus lâches, et la plus odieuse d'abord au début, puisqu'on a tiré plus de cent coups de fusil sur le colonel et ses officiers au moment où ils congédiaient une députation admise un instant avant dans l'hôtel de ville. Non moins lâche ensuite, quand, après la première décharge, la place s'étant vidée et le feu ayant cessé de notre part, nous fûmes canardés des fenêtres en face. Dites bien ces choses aux gardes nationaux, et tenez-moi au courant. Ici tout est rentré dans l'ordre. La garde républicaine et la garde nationale occupent la place et les abords. » L'ardeur de la lutte, le sentiment du devoir militaire, ne permettent pas aux défenseurs des forts, que le patriotisme seul soutient, de prêter attention aux événements qui se passent à l'hôtel de ville.

23 janvier : A sept heures trente, les Allemands ouvrent le feu, lentement sur Montrouge, et très vivement sur Vanves. A huit heures, Montrouge commence à répondre, et le feu ennemi devient très-vif sur lui de midi à quatre heures surtout. Les pièces de l'Hay ont notre caserne de gauche pour principal objectif. Les avaries s'accentuent, mais le capitaine de vaisseau Amet continue la défense avec la même énergie. Le bastion 4 principalement souffre beaucoup des bombes ennemies : tous les abris des hommes sont défoncés ; les bombes font encore écrouler la voûte du magasin à projectiles, quoiqu'elle ait déjà été épontillée. Les merlons des bastions 3-4 et de la courtine 3-4 sont renversés, les embrasures démolies, et une brèche complète, pratiquée dans le mur de gorge. Les matériaux tombés dans le fossé forment rampe pour y arriver. Pendant la nuit, on déblaye le tout, on disperse les matériaux dans le fossé, et on y creuse une tranchée. Le fort de Bicêtre tire sur Fontenay. Les batteries de l'Hay tirent sur Montrouge pendant toute la journée ; les Hautes-Bruyères ne tirent pas , mais Bicêtre occupe toujours l'ennemi. Une pièce de 24 de la courtine 3-4 de Montrouge a une roue brisée, on la répare. Celle du saillant du bastion 3 a son affût complétement démoli et sa masse de mire enlevée. Une nouvelle pièce de 24, venue de Paris, est mise à sa place. Vers quatre heures le feu cesse. Pendant la nuit, l'ennemi ne tire que sur Paris, sauf quelques coups rares à l'adresse du bastion 4. Un bruit incessant de chariots se fait entendre vers Fontenay et Châtillon. Montrouge a 7 marins blessés. M. le lieutenant de vaisseau Bellanger, qui commande le bastion 4, reçoit trois blessures légères. Le fort tire dans la journée 225 obus et 45 bombes. La situation du fort de Montrouge empire chaque jour. Aujourd'hui la lutte a été rude. Il existe un regrettable manque d'ensemble entre les directions données aux forts de la marine et celles données aux forts armés par la guerre et aux batteries qui les avoisinent. L'appui mutuel qu'ils se doivent fait ainsi quelquefois défaut. Dans cette période de la défense, il appartiendrait à un service unique de prendre la direction de l'ensemble des opérations. Chaque jour, les choses se passent à peu près ainsi : le fort de Vanves ouvre dès le matin un feu nourri. La canonnade s'engage violemment. Montrouge vient en aide à Vanves, et bientôt Fontenay se met de la partie; puis, Vanves se tait ou à peu près , et Montrouge reste seul aux prises avec l'ennemi. La batterie placée près de Montrouge, quand elle tirait, débarrassait ce fort de trois ou quatre pièces qui la prenaient pour objectif. Hier encore il en était ainsi; mais auj ourd' hui, cette batterie n'ayant pas tiré , nous avons eu sur nous le feu de toutes les pièces des batteries de Fontenay, y compris les mortiers. Notre bastion 4 n'est plus qu'une ruine ce soir. La batterie de l'Hay a commencé à faire ce que nous redoutions, c'est-à-dire à prendre à dos notre courtine 3-4, où sont établies les seules pièces avec lesquelles nous pouvons faire une diversion utile aux bastions 3 et 4. Notre situation défensive est loin ainsi de s'améliorer, et voici l'état où nous sommes : les blindages établis devant nos magasins à vivres, dans la cour du bastion 4, sont pulvérisés. Les voûtes des casemates sont entamées et les sacs à terre avec lesquels nous avons constitué un blindage intérieur ne peuvent donner une protection suffisante à nos vivres, au milieu desquels les obus pénètrent. Chaque nuit, nous retirons ce que nous pouvons, mais ce travail est difficile et dangereux. Une fois engagés dans ces débris, les hommes ne peuvent plus se garer lorsque le son du cornet à bouquin se fait entendre. Le mur de ce bastion a maintenant une large brèche, et du côté du fossé, les pierres du mur forment rampe. Nous nous occupons à disperser ces matériaux, mais cette brèche ne fera qu'augmenter. Les voûtes de presque tous nos magasins à poudre et à projectiles des remparts, trop faibles partout, ont fléchi par suite d'explosions de bombes, et nous avons dû les épontiller en attendant de pouvoir reprendre la maçonnerie. Les corps de logis de chaque côté de la porte sont devenus presque inhabitables ; il est difficile de mettre les hommes de garde en sûreté. Le génie, sous l'énergique direction du lieutenant-colonel Lévy, va percer une galerie dans le masque de la porte ; ce sera toujours un abri. Enfin, les terres des parapets ont été si bien labourées par les obus qu'elles n'offrent plus de consistance ; les travaux de réparation rendus ainsi plus faciles peut-être , offriront moins de garanties de résistance. En même temps, le tir de l'ennemi a gagné en justesse, les coups d'embrasures se multiplient, et par suite les accidents aux pièces. Les bombes nous donnent le coup de grâce. Dans ces conditions, pour continuer une défense honorable et ménager les forces et le sang de sa garnison, le fort de Montrouge a besoin d'être appuyé : cela serait facile. En armant la batterie Millaud plus fortement, on tiendrait en respect les pièces de campagne de Sceaux; en remaniant trois des embrasures de la batterie de six pièces de 24 qui est en dehors et à côté du fort, cette batterie atteindrait Fontenay. Bicêtre et les Hautes-Bruyères font de leur mieux pour nous aider. Le 7e secteur de l'enceinte vient également à notre secours de tout son pouvoir; il tire beaucoup, mais il est bien loin. Cependant l'ennemi, de temps à autre, lui envoie quelques obus, et c'est autant de moins pour nous. L'esprit qui anime le personnel de Montrouge est parfait. Les officiers donnent l'exemple, et les marins, les canonniers surtout, se comportent vaillamment. Dans leurs visites, le vice-amiral commandant en chef, et le vice-amiral Pothuau, qui s'y rend presque tous les jours, ont contribué à maintenir ce moral. Ils ont pu apprécier les mérites de ces braves gens et de leur digne commandant, le capitaine de vaisseau Amet. Le capitaine de vaisseau Salmon a remis dans la journée le commandement des Hautes-Bruyères au général Martenot, pour retourner avec sa brigade à Charenton. Les marins de cette brigade regrettent cette redoute, où ils se trouvaient comme à bord d'un vaisseau, dont ils avaient amélioré les défenses avec le plus grand intérêt, et d'où ils venaient utilement en aide à leurs camarades de Montrouge.
24 janvier : Le temps, brumeux dès le matin, reste couvert toute la journée. L'ennemi tire très-lentement, environ un coup par quart d' heure. De neuf heures à trois heures, quatre bombes seulement tombent dans le fort. Les dégâts matériels ne consistent qu'en deux traverses-abris percées par ces bombes. Nous ne répondons pas un seul coup de canon, et nous continuons à faire des travaux de réparation qui exposent peu les hommes. Nous avons eu un maître, un matelot et un surveillant du génie blessés légèrement. Bicêtre est également muet.
25 janvier : Le capitaine de frégate de Larret-Lamalignie vient remplacer au fort de Montrouge le commandant Vidal, grièvement blessé le 19. Le temps est couvert et brumeux. Les batteries ennemies ne commencent pas leur feu avant neuf heures, et cependant, dès huit heures, le 7e secteur tire sur elles ; le 8e secteur tire également. Le feu de l'ennemi, dans la matinée, est moins rapide que les jours précédents. Il envoie des obus et des bombes sur les bastions 3 et 4 et la courtine 3-4. La brume se lève peu à peu, et la batterie prussienne de l'Hay ouvre le feu sur le bastion 2 et la courtine 2-3. Elle envoie aussi quelques coups d'écharpe au bastion 3. Dans l'après-midi le temps s'éclaircit, et le tir des batteries ennemies devient de plus en plus vif. Bourg-la-Reine tire quelques coups sur le bastion 3 et sur la courtine 2-3. Les bastions 1 et 2 répondent alternativement à la batterie de l'Hay. Les bastions 2, 3, 4, la courtine 3-4, les mortiers, répondent aux batteries de Bagneux et de Fontenay. Vers quatre heures, les batteries de l'Hay et de Bourg-la-Reine cessent de tirer, le feu de Fontenay se ralentit, et il n'arrive plus de bombes. Un certain nombre d'embrasures ont été endommagées sur la courtine 3-4 et sur les bastions 3 et 4 ; elles sont réparées le soir. Un coup d'embrasure produit par une bombe, à la première pièce de 0m,l6 du flanc du bastion 4, bouleverse l'embrasure, brise la hausse, contusionne le pourvoyeur. On répare plusieurs abris, traverses et épaulements. Le travail dure toute la nuit et est terminé à huit heures du matin. Pendant la nuit, le tir ennemi a été lent sur le fort, mais actif sur Paris. Nous avons 4 blessés. Le fort a tiré 84 obus et 14 bombes.
26 janvier : Le fort de Montrouge commence à être bombardé très lentement vers huit heures trente minutes du matin. La brume est très épaisse jusqu'à onze heures. A partir de ce moment, le feu des Allemands s'accroît successivement. Vers midi et demi, le fort commence de son côté à répondre, et la canonnade dure de part et d'autre jusqu'à quatre heures trente. En raison des recommandations faites la veille par le général Guiod, commandant en chef de l'artillerie, et qui nous sont renouvelées sur la nécessité de ménager les munitions, nous répondons dans la proportion d'un coup pour trois. Et cependant nos canonniers prévoient bien que, malheureusement, nos munitions, quel que soit désormais notre prodigalité, dureront aussi longtemps que les approvisionnements de vivres qui restent dans la ville. L'ennemi continue à tirer sur le fort et sur Paris plus vivement que de coutume, et son feu augmente encore de vivacité dans la soirée. De dix heures à onze heures cinquante-cinq, il ne discontinue pas. Nous transportons dans la soirée une pièce de 0m,16 du bastion 3 au bastion 4. Nous avons eu un matelot tué et quatre blessés, dont deux grièvement. Montrouge a tiré dans la journée 65 obus et 17 bombes. Dans la soirée, le ministre de la guerre donne l'ordre de réduire à quinze jours de vivres l'approvisionnement des forts. L'excédant doit être transporté immédiatement à Paris par les soins de l'intendance. Mais les moyens de transport étant devenus insuffisants par la rareté des chevaux, cet ordre ne put être exécuté qu'incomplètement. A neuf heures vingt du soir, le général Vinoy envoie à tous les forts la dépêche suivante : « Suspension d'armes à minuit. Cessez le feu sur toute la ligne. Exécutez rigoureusement cet ordre. Accusez réception. » Le feu cesse partout à minuit. Toutefois, il est constaté qu'à minuit trente-cinq un obus allemand tombe encore dans le fort d'Aubervilliers. Chacun l'a compris : la fin de la lutte est proche; on n'ignore pas que l'approvisionnement des vivres de Paris est arrivé à son terme extrême. Le sacrifice sera d'autant plus sensible pour les forts qu'arment nos marins, que ceux-ci se savent approvisionnés en vivres et en munitions pour une résistance prolongée. Mais il nous faudra bien courber notre orgueil; suspendre ainsi la défense n'est pas le moindre sacrifice qui est imposé à notre dévouement pour la capitale. Néanmoins, jusqu'à minuit, de tous côtés, à Saint-Denis, dans l'Est, dans le Sud, nos forts, nos batteries, nos redoutes tirent avec une égale ardeur. A minuit précis, tout bruit cesse autour de Paris vaincu par la famine.

27 janvier : A huit heures du matin, tous les commandants de corps d'armée, les officiers généraux, les chefs d'état-major, les commandants supérieurs du génie, de l'artillerie et des forts, les chefs de corps, se réuniront au ministère de la guerre pour y recevoir une importante communication du gouvernement. Cette communication est l'exposé de la situation de la défense de Paris fait par le général Trochu, celui de l'état des approvisionnements de la capitale, le récit des défaites de nos armées de province, enfin l'explication des préliminaires d'armistice en vertu desquels l'armée est prisonnière de guerre. Dans cette réunion, où se trouvent des officiers généraux et supérieurs de toutes les armes, le capitaine de vaisseau Amet, commandant supérieur du fort de Montrouge, est l'objet de tous les empressements. Le général Vinoy envoie dans l'après-midi la circulaire suivante : « La suspension d'armes comporte la cessation complète de tous travaux de défense, de terrassements, de tranchées, batteries et autres. Toutes les pièces mobiles doivent être enlevées de leurs positions, mises en parc et prêtes à rentrer au premier ordre. Donnez des ordres en ce sens. » Les ordres sont exécutés et tous travaux de réparation suspendus.
28 janvier : Les bases de l'armistice sontaffichées dans Paris : L'ennemi doit occuper tous les forts. La garde nationale garde ses armes. L'armée, qui doit être désarmée, à l'exception d'une division de 12,000 hommes, reste dans Paris. Les officiers gardent leur épée. Quelques manifestations populaires ont lieu en ville, et une certaine confusion règne dans tous les services. On envoie à Paris, dans nos magasins, tous les objets de matériel appartenant à la marine, autres que ceux qui composent l'armement militaire des forts. Au fort de Montrouge, le capitaine de frégate de Larret-Lamalignie, récemment promu, porte atteinte à sa vie en se tirant deux coups de revolver. Il succombe trois jours après. C'est le quatrième capitaine de frégate que perd ce fort. Trois ont été successivement tués à l'ennemi; un cinquième a été blessé très grièvement. Une dépêche chiffrée du délégué du ministre de la marine adressée à nos forts, le défend d'une facon absolue de faire descendre les canons de leurs affûts. Les bastions doivent rester intacts, armés exactement comme avant la suspension d'armes. Aussitôt que les préliminaires d'armistice ont été connus, le vice-amiral commandant en chef, interprète des sentiments douloureux du personnel sous ses ordres, adresse, à la date de ce jour, la lettre suivante au général en chef de l'armée de Paris : « Mon général, D'après les termes reproduits ce matin au Journal officiel, les forts de Paris doivent être occupés par l'armée allemande. J'ignore la forme qui doit présider à notre évacuation ; mais permettez-moi d'insister auprès de vous pour que les plus grands adoucissements soient apportés aux sentiments si douloureux qu'en éprouvent nos marins. Puisque la cruelle nécessité leur en fait un devoir, ils sauront se résigner. Ils abandonneront, en courbant tristement la tête, des remparts qu'ils défendaient au nom de la patrie, et où bien des leurs sont tombés bravement. Mais si les lois de la guerre ne s'y opposent pas absolument, permettez qu'ils se retirent avant l'arrivée du vainqueur. Je connais les nobles sentiments de nos hommes; plusieurs officiers sont venus hier me les exprimer en leur nom. Il n'a pas dépendu d'eux que leurs forts restassent inviolés. Faites qu'ils ne voient pas l'affreuse réalité, et veuillez ordonner que ces forts soient rendus par les autorités qui nous y ont reçus à notre arrivée, c'est-à-dire le commandant de place, les agents du génie et de l'artillerie. Votre cœur de soldat a déjà compris les sentiments que j'ai le devoir de vous exprimer. Je n'insisterai pas; mais jusqu'au dernier moment je compterai sur une solution qui constituera pour nos braves marins la dernière récompense qu'ils ambitionnent. Je suis, etc., etc. Signé : DE LA RONCIÈRE LE NOURY. » Le général en chef accéda à cette demande, et les marins conserveront à leur amiral une vive reconnaissance de s'être fait le jaloux interprète des sentiments de tous. Aucun de nos forts n'est en effet réduit par la force; leur feu n'est pas interrompu. Ils sont largement approvisionnés. Leurs défenseurs ne succombent que parce que Paris meurt de faim. Ces nobles défenseurs ont donc droit à tous les égards de leurs chefs, comme à l'estime de leurs adversaires.
29 janvier : Le 29, à cinq heures cinq minutes du matin, le général en chef télégraphie aux forts que l'évacuation et la rentrée des troupes dans l'enceinte doivent avoir lieu aujourd'hui même. Il leur adresse ses instructions par écrit. Il donne l'ordre en outre de couper les fils des torpilles, et de prendre des mesures pour écarter tout danger d'explosion. Les commandants des forts doivent vérifier ce travail et s'assurer qu'il est terminé pour neuf heures du matin. A neuf heures, le mouvement d'évacuation commence, mais auparavant tout a été mis en ordre dans nos forts. Nos hommes se sont attachés ainsi à montrer jusqu'au dernier moment l'esprit qui ne cesse de les animer. Presque tous ont à cœur d'en laisser la trace à l'ennemi. Les artilleurs de la marine du fort de la Briche, après avoir vainement attendu des chevaux annoncés de Paris pour emmener leurs pièces mobiles, s'y attellent spontanément eux-mêmes sous les ordres du chef d'escadron Duran, et les ramènent ainsi en ville. Nos marins rentrent à Paris, en ordre et en silence, et se rendent à l'École militaire, où ils doivent être casernés. La foule s'incline sur leur passage, salue avec un respect sympathique les officiers qui les conduisent. L'équipage du fort de Montrouge est l'objet de vives démonstrations. On apprend qu'un général allemand, en arrivant dans ce fort, a demandé le nom du commandant, et s'est exprimé sur la belle défense qu'il a opposée dans des termes qui justifient ces démonstrations de la foule. Le gouvernement, qui veut donner une marque d'estime aux marins, décide que trois bataillons de matelots fusiliers, formant un total de 1,800 hommes, feront partie de la division de 12,000 hommes qui doit rester armée. Le général d'infanterie de marine Faron est placé à la tête de cette division. Ses services distingués dans l'armée active lui valent cet honneur. Les trois bataillons de marine sont commandés par le capitaine de vaisseau Lamothe-Tenet, l'héroïque combattant du Bourget. Ils sont casernés à la Pépinière.
30 janvier : Le 30 janvier, le présent ordre du jour est lu devant nos marins assemblés : « Le vice-amiral commandant en chef est heureux de porter à la connaissance de la division, par la voie de l'ordre, le témoignage de haute satisfaction que le ministre de la marine a adressé au capitaine de vaisseau Amet, commandant supérieur du fort de Montrouge, pour la belle et vigoureuse conduite que son équipage et lui ont tenue pendant près d'un mois sous le feu incessant des batteries prussiennes : Monsieur le commandant, Au moment où vous venez de quitter avec votre équipage le fort que vous avez si héroïquement défendu, je tiens à vous exprimer les sentiments d'admiration que vous avez inspirés à vos camarades et à la population entière de Paris. La défense de la capitale a été belle, et parmi les brillants faits d'armes qui s'y sont passés, la lutte du fort de Montrouge aura une célébrité exceptionnelle, et la marine l'enregistrera dans ses fastes célèbres. Chacun de vos officiers et marins inscrira avec un juste orgueil sur ses états de service : J'étais au fort de Montrouge ; et vous, leur noble chef, par votre énergie et votre bravoure, vous vous êtes créé des titres qui vous assurent la plus brillante carrière. Recevez, Monsieur le commandant, l'assurance de mes sentiments de haute estime. Le contre-amiral, délégué du ministre de la marine et des colonies. Signé : DE DOMPIERRE D'HORNOY. » En recevant cette flatteuse dépêche, le premier soin du capitaine de vaisseau Amet fut de reporter une grande part de ces éloges sur ses dignes collaborateurs du génie militaire, à la tête desquels était le lieutenant-colonel Levy, dont le concours dévoué et sans prix dans la direction des travaux de réparation du fort, fut toujours au-dessus de toutes les difficultés.
Les marins attendent avec impatience le moment de quitter Paris et de retourner dans leurs ports ou dans leurs familles. Leur désœuvrement forcé et les tentatives d'embauchage dans l'armée du désordre qui s'organise, créent une situation d'une excessive gravité. Les éloges souvent exagérés dont la marine est l'objet, l'engouement qui s'attache à elle, rendent les marins le point de mire des agitateurs. On exploite leur inaction, et on cherche à créer parmi eux un antagonisme avec leurs frères de l'armée. On veut faire un drapeau d'un uniforme que l'on sait respecté de tous. Et lorsqu'il est question de l'entrée des Allemands dans une partie de Paris, on leur parle de marcher à l'ennemi, espérant donner le change à leur patriotisme. Mais le sentiment de l'honneur a conservé ses droits, un très-petit nombre a répondu à ces excitations. Parmi ceux-là, la plus grande partie sont des Parisiens réadmis pour la durée de la guerre, éloignés depuis longtemps de nos rangs, où ils n'étaient plus dignes de rentrer. Le 27 février, en présence de ces faits, l'ordre du jour suivant fut lu et affiché à l'École militaire et à la Pépinière : « Le contre-amiral, délégué du ministre de la marine et des colonies, fait appel au bon esprit des marins de la division de Paris, dans les graves et tristes circonstances où se trouve la France. Malgré les efforts de tous, malgré le dévouement, le courage et le patriotisme dont les matelots ont donné tant de preuves pendant le siège de Paris , le gouvernement de la Républiqué a dû consentir à l'entrée d'une partie de l'armée allemande dans quelques quartiers isolés de Paris : cette entrée se fera le mercredi 1er mars, à dix heures du matin. Si douloureux que dût être un pareil sacrifice, le chef du pouvoir exécutif a cru devoir l'accepter pour sauver et conserver à la France la ville forte de Belfort, qui forme, avec la Suisse, notre meilleure frontière vis-à-vis de l'Allemagne. Paris, qui s'est illustré par l'héroïque défense de ses enfants, donnera cette nouvelle preuve de résignation. Les marins comprennent toutes les grandeurs et tous les sacrifices faits au pays, eux qui ont pour mission de porter au loin le sentiment de l'honneur de la France ; ils apprécieront celui-ci, et sauront se faire de cette abnégation un nouveau titre à l'estime. Officiers, officiers-mariniers et matelots, Je vous demande de rester dans cette nouvelle épreuve ce que vous avez été devant l'ennemi, des hommes de cœur, d'ordre, de dévouement. Aujourd'hui, comme au milieu des tempêtes et des combats, ce sont les grandes vertus des marins. Vous saurez les garder. Sous la pluie d'obus, sous la mitraille, sous le froid glacial, dans les forts, sur les remparts de l'enceinte, au Bourget, au plateau d'Avron, à Choisy-Ie-Roi, à Champigny, partout où il y a eu le danger à affronter, la patrie à défendre, vous avez porté haut le nom de la marine française. Soyez aussi grands dans l'adversité que dans la lutte, aussi généreux dans l'acceptation, que braves et inaltérables dans le danger. Soyez calmes en présence des Allemands, évitez toute occasion de contact avec des ennemis que vous avez combattus et étonnés par votre courage. Donnez à cette population de Paris qui vous honore pour votre dévouement, pour votre discipline, pour votre énergie , l'exemple de l'abnégation. Vous diminuerez ainsi notre malheur, et vous vous montrerez dignes de nouveaux succès dans l'avenir. Le contre=amiral, délégué au ministère de la marine, Signé : HUGUETEAU DE CHALLIÉ. »
Lors de la manifestation populaire du 28 février, des groupes, grossissant vers le soir, s'accumulèrent devant l'École militaire et surtout devant la caserne de la Pépinière, conviant les marins à prendre part à un banquet préparé à la Bastille. A l'École militaire, les tentatives de la foule sont infructueuses. A la Pépinière, les grilles de la caserne sont brisées par les émeutiers, auxquels nos marins, réunis à leurs postes, leurs officiers en tête, et dépourvus d'armes, ne peuvent opposer aucune résistance sérieuse. La foule se précipite dans l'intérieur de la caserne et se jette au milieu de leurs rangs. Malgré les exhortations de leur commandant, quelques marins sont entraînés. Mais ceux-ci même ne tardent pas à comprendre le rôle qu'on veut leur faire jouer, et à l'appel du soir , il n'y a que huit absents sur 1,800 hommes.
Le contre-amiral de Challié, délégué du ministre de la marine, va le lendemain matin, accompagné du contre-amiral de Kergrist, visiter nos casernes. Il réunit les matelots, et, dans une chaleureuse allocution, il les complimente de leur conduite de la veille, où ils ont montré une fois de plus les sentiments de dignité et d'honneur que les meneurs leur ont fourni l'occasion de faire éclater au grand jour. C'est ainsi que jusqu'à la dernière heure, après les péripéties de toute nature qu'ils ont traversées, nos marins sont restés fidèles aux sentiments de discipline et de patriotisme que leur a inculqués sans relâche, pendant le cours de ce long siège, leur commandant en chef. C'est ainsi que respectant leur uniforme, ils ont pu échapper aux suggestions subversives qui se faisaient une arme de leur popularité, et échapper à un danger plus terrible peut-être que le feu de l'ennemi, la trahison à la patrie, et le déshonneur qu'elle entraîne. Ce n'est pas sans regret que le vice-amiral, retenu à Bordeaux par son mandat de député, n'a pu leur adresser ses remercîments d'être restés jusqu'à la fin les inébranlables champions de cette discipline qui a fait leur principale force, et sans laquelle la bravoure reste impuissante et l'instruction militaire stérile. Il leur aurait dit : « Braves équipages, héroïques bataillons, En vous quittant l'âme brisée des douleurs de la patrie, prévoyant les nouvelles épreuves qui vous attendaient, je comptais sur votre droiture pour les surmonter. Mon attente n'a pas été trompée. Là encore, comme pendant tout le siège, vous vous êtes montrés les inébranlables champions du devoir militaire, dont le respect est votre honneur et votre force. Retournez dans vos foyers. Vous avez été des guerriers fidèles au drapeau, dociles à vos chefs. Vous y serez des citoyens honnêtes et considérés. Dans vos villages, qui ne s'inclinerait devant vous? Votre sang largement répandu rappelle vos luttes héroïques, et le nombre de ceux qui manqueront, hélas ! au retour, sera un triste et éloquent témoignage de votre valeur. Gardez le souvenir de votre commandant en chef; gardez le souvenir de mes chers et dévoués collaborateurs, l'amiral Saisset, cet homme à l'esprit entreprenant et fécond en ressources, qui fut le héros d'Avron; l'amiral Pothuau à la téméraire et chevaleresque bravoure, qui ne croyait au danger qu'après l'avoir affronté; enfin celui dont la soucieuse prévoyance n'a cessé de veiller sur vos besoins, le modeste et infatigable amiral de Kergrist. Fier de leur concours, que ne leur dictait pas moins une vieille amitié que les lois du service, le plus grand honneur de ma longue carrière sera d'avoir été à votre tête pendant ce siège sans exemple dans l'histoire. Et si j'ai mérité leur estime et la vôtre, le sentiment du devoir accompli en commun sera l'éternelle et la dernière récompense de ma vie militaire. »
Enfin, le 8 et le 9 mars, les matelots de Cherbourg, de Brest et de Rochefort quittent Paris et rejoignent leurs ports. Ceux de Toulon ne peuvent commencer à se mettre en route que le 15 mars, jour où la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée
reprend son service. Le 17 au soir, nos derniers contingents avaient quitté Paris. Le lendemain, la Commune victorieuse était maîtresse de la capitale abandonnée à elle-même.
Paul rentre à Brest le 8 mars 1871. Hormis une semaine passée sur la frégate ponton l'Hermione, servant de prison pour les insurgés de la Commune, il restera à terre dans le port jusqu'au 24 août 1872. Paul habite officiellement place du chateau, à Brest, mais rend régulièrement visite à sa famille à Lesneven et Plouescat. Il est probable qu'il ait rencontré Marie Collin, sa future épouse, au cours de ses séjours à Lesneven car ses parents y tenaient l'hôtel des trois piliers. Profitant de son long séjour en Bretagne, il fait construire en 1872 la maison de Ker Treaz « maison du sable » dans la baie de Pontusval (actuelle ville de Brignogan-Plages) car, comme tout marin, il a besoin de voir la mer. A l'époque, Brignogan n'était qu'un hameau plus à l'intérieur des terres. Les paysans y ramassaient du goémon et de là en partaient des convois pour aller fertiliser les terres dans tout le pays. C'était aussi une baie de mouillage pour les navires, et on y trouvait souvent des marins anglais. Le littoral n'y était pratiquement pas construit et, à part le manoir du Scluz, qui servait de troquet, et Kerazel, qu'une de ses tantes, Adèle Testard, avait fait construit avec son mari en 1855, la maison de Ker Tréaz fut une des premières à jouxter la plage. Cette maison à été agrandie en 1948.
Gabon
A la fin août, Paul apprend qu'il doit rejoindre la division navale de l'Atlantique sud, commandée par le contre amiral Le Couriault du Quilio, et plus exactement la station du Gabon. C'est un poste peu envié car la vie au Gabon est réputée très difficile, à cause du climat tropical et des nombreuses maladies qui y règnent. Heureusement pour lui, il sera accompagné par l'enseigne de vaisseau André Coffinières de Nordeck, qu'il connait déjà puisqu'ils étaient ensemble aux forts de Bicêtre, et avec qui il se liera rapidement d'amitié. Les deux hommes quittent Brest, rejoignent Toulon et embarqueront ensemble sur la Cérès à destination de Dakar le 1er septembre. Coffinières, écrivain et aquareliste, écrira ses mémoires en 1911 dans un ouvrage intitulé : Le Gabon. Souvenir d'une campagne faite en 1872. Ses écrits et ses dessins nos livrent d'abondants de détails sur le séjour de Paul au Gabon. Il écrit :
Départ de BrestAprès la guerre néfaste de 1870, la marine fut quelque peu sacrifiée ; alors les officiers peuplèrent les ports sans occupations et sans emplois. J'étais enseigne de vaisseau en 1872, au port de Brest, attendant comme nombre de mes camarades le moment d'embarquer. Enfin ce jour arriva. Depuis longtemps j'étais le second sur la liste d'embarquement, désirant impatiemment la nouvelle d'un départ. Peu m'importait d'aller à droite ou à gauche; mon désir était d'aller loin pour voir le plus de monde que je pourrais et pour naviguer le plus longtemps possible, suivant en cela les conseils de l'excellent amiral Rigault de Genouilly.Un jour donc, à Brest, je déjeunais à l'hotel Lequer, rue de Siam, quand on me fit demander à la Majorité générale. Je me mis en ronte immédiatement et j'y rencontıai mon camarade l'enseigne de vaisseau Chaudeborde, comme moi convoqué; il avait le numéro un sur la liste d'embarquement. Plus de doutes, nous allions être désignés pour quelque batiment. Le major général D... nous reçut ensemble. C'était un petit, homme fort aimable avec les favoris réglementaires. Il avait toujours des chemises éblouissantes, et cet amour du beau linge Iui avait permis, étant emlbarqué sur un navire qui emmenait proscrit en Amérique le prince Louis Napoléon, de lui venir en aide pour lui compléter sa garde-robe, un peu restreinte dans un départ précipité.Le major général nous dit qu'il avait l'ordre de désigner les deux premiers enseignes de la liste, l'un pour le brick l'Entreprenant, et l'autre pour la Cordelière. Très correct, il nous fit choisir par rang de liste. Chaudeborde choisit le premier; il prit le brick Entreprenant, qui faisait le service du Senégal et le courrier entre la Sénégambie et le Gabon. N'ayant pas le choix, j'eus la Cordelière, qui était un ponton mouillé au Gabon. Ce n'était pas très brillant comme campagne, mais, enfin, le pays était encore bien peu connu et, l'amour des aventures me fit faire contre mauvạise fortune bon cœur; d'ailleurs, plus tard, quand nous connûmes les navigations de l'Entreprenant, je fus considéré comme ayant été le mieux partagė. Ce qui prouve qu'il faut suivre son destin !Je devais me trouver à Toulon pour embarquer le 1er septembre sur la Cérès,; nous ėtions le 23 aoůt. J'avais juste le temps de faire mes malles pour aller embrasser ma famille et pour rallier mon navire. Je partis pour Paris; mes parents étaient à notre campagne de Préjoli, près de Chevreuse; quand j'arrivai avec cette nouvelle de destination pour le Gabon, tout le monde voulut s'opposer à mon départ et mon père m'engagea vivement à donner immédiatement ma démission. Il avait toujours combattu ma vocation maritime, mais j'étais toujours enragé pour voir des pays nouveaux et je dis que je tenais à poursuivre ma carrière, quelles qu'en fussent les mauvaises chances. Le Gabon n'avait donc pas très bonne réputation à cette époque. Je ralliai Toulon et la Cerès, malgré le grand chagrin que j'eus de quitter les miens contre leur gré.
A Toulon - A bord đe la Cérės - Vieille marineJ'étais très jeune, Toulon si gai, les camarades fort en train; tout cela, avec le plaisir de prendre la mer, me consola bientôt de mes tristesses. Nous étions beaucoup de passagers sur cette Cérès pour Dakar, le Sénégal, et certains forçats pour les iles du Salut. La Cérès devait revenir en France par Fort-de-France (Martinique), toujours à la voile nécessairement. Elle n'avait pas de machines. Est-ce loin ! les navires à présent n'ont plus de voiles ! On ne pensait pas alors à faire voyager les officiers, et les marins en paquebots! II y avait sur notre transport beaucoup de forçats destinés aux établissements de Cayenne. Le commandant Ducrest de Villeneuve ėtait un vieux brave complètement sourd qu'on đénommait familièrement dans la marine, à cause de son infirmité, l'auberge pleine, en souvenir de la pièce la bien connue : Les deux Sourds ou l'Auberge pleine. Très bon marin, très apprécié de tous pour son caractère et sa science de lạ mer, le commandant Ducrest de Villeneuve était très gai malgré sa surditė, qui amenait les quiproquos les plus joviaux ; il en riait lui-meme quand il s'en rendait compte. Le commissaire, très jeune, d'excellente famille, par atavisme sans doute (on sait que la liste des conseils judiciaires, chez les notaires, contient l'armorial de France), avait des idées à lui sur l'administralion, il inscrivait ses comptes au crayon n'importe où, sans se préoccuper de faire des paperasses ; sa comptabilité s'étalait sur les cloisons et sur les portes de son logement. C'était excellent pour éviter, la perte de documents précieux qu'une brise indiscrète eut pu fąire s'envoler s'ils eûssent été écrits sur papiers; mais cette défiance des feuilles volantes devait, plus tard, jouer à notre original administrateur un mauvais tour. On nous raconta que le second dz la Cérès, à la fin de la campagne, fit repeindre tous les appartements sans prévenir personne : le brave commissaire, dans sa modestie, n'avait pas signalé quels étaient ses procédés mnémo-techniques. Le ravalage du batiment causa la perte totale de la comptabiļité du bord ! Ce fut une catastrophe administrative ! Le ministère, à cette nouvelle, eut le mauvais coeur de casser de son grade le pauvre commissaire, qu'on renvoya au pain sec de sa gentilhommière; mais aux débuts de la campagne on ne prévoyait pas ces événements et on était tout aux nouveaux. Il y en eut un burlesque qui nous amusa fort. Le major général, suivant le règlement, vint passer une inspection avant le départ de la Cérès. Ce major général portait des pantalons blancs très courts munis de sous-pieds blancs ; il était chaussé de la demi-botte, encore à ce moment d'uniforme. Cette tenue, quelque peu désuëte, nous avait déjà mis en l'air, quand vint l'appel nominatif de l'équipage et des passagers. Tout le monde était sur le pont très solennel. Le commissaire, lisant son rôle d'équipage, appelait chacun par son nom. Quand ce fut le nom des forçats, on les fit comparaitre, les extrayant de leurs cages pour les y reintégrer dès qu'ils avaient répondu à leur nom; a la fin le commissaire se tut, sa liste était épuisée, sa voix aussi d'ailleurs, mais ce n'était pas l'important ; l'évennement était qu'il restait encore un forçat non appelé, non inscrit ! On lui adressa la parole pour l'interroger ; personne ne put comprendre ce qu'il disait. Les gardes-chiourmes n'y entendaient rien; on le leur avait remis, ils le gardaient. Cet homme, interrogé, ne répondait pas ou prononçait que des mots inintelligibles. On n'avait pas encore vu d'acra, on ne savait pas quel était cet homme et d'où il venait. Tous les linguistes du bord lui parlèrent; personne ne put s'en faire entendre. Le spectacle de ces interrogatoires divers faisait se tordre l'assemblée. Enfin, le colonel Galli-Pasboc, celui-là même qui fut tué en Calédonie plus tard, en 1878, prétendit, que c'était un Annamite, parlant mal l'annamite, comme qui dirait un homme qui parlait un auvergnat d'annamité ! Au fond on ne savait pas d'oủ venait ce forçat ni pour quelle deslination il était désigné. Mais, comme dans la marine à voiles on se débrouillait toujours et que c'étaiť le plus haut gradé qui décidait toujours de tout sans observations, dans le cas actuel, le major général conclut en donnant l'ordre d'inscrire d'office pour Cayenme le malencontreux passager. Ce bonhome, ahuri, fut ramené dans sa cage avec les autres forçats. Il fut dénommé le Muong, du nom, d'une populalion très fruste de l'Annam. Il n'était pas beau. En revanche, comme beau sexe, nous avions quelques personnes jeunes, femmes de gardes-chiourmes ou de gendarmes de l'escorte des bagnards. Au carré, figuraient quelques dames charmantes, qui accompagnaient leurs maris fonctionnaires aux colonies. On appareilla par très beau temps et notre voyage s'ellectua très convenablement en longeant la cote d'Espagne de très près. Nous achetâmes du poisson et des raisins des pêcheurs dont, nous rencontrâmes les barques près d'Alicante. Nous fûmes bientot tous bons amis, alors on organisa des charades pour s'amuser pendant la traversée; elles étaient très bruyantes. Durant ce temps, le commandant seul et complètement sourd, n'ayant aucune distraction, charmait ses loisirs en peignant de couleurs variées le plafond de son appartement. Et la Cérès, sous toutes voiles, glissait sur les flots tranquilles le long de la côte d'Afrique. Nous arrivâmes ainsi, sans nous ennuyer, à Dakar, au Sénégal.

A bord de l'Entreprenant -Tenue des officiers de la marine à voiles - Un marsouin blanc. Paté de marsouin
A Dakar, je dis adieu à la Cérès, dont j'ai toujours gardé le meilleur souvenir, et j'embarquai sur l'Entreprenant, le 26 septembre 1872. Avec la logique qui a toujours été l'apanage de la marine, l'Enreprenant s'appelait officiellement brick. Or, un brick n'a que deux mâts; celui-là en avait trois. C'était un trois-mâts barque. On eut dû l'appeler ainsi en lui modifiant sa mâture, mais la sacrosainte administration n'aurait plus reconnu son navire, et alors il naviguait toujours sous la dénomination primitive, et personne ne s'en étonnait. Il ne faut jamais s'étonner dans la marine ! La moitié de l'équipage était composée de marins d'un peu de tous les ports de France, l'autre moitié l'était de Sénégalais du plus beau noir. Le capitaine (on ne disait pas encore commandant à cette époque) était un lieutenant de vaisseau, ancien aide-de-camp de l'amiral Rigault de Genouilly. II devint plus tard le contre-amiral Rocomaure, né natif de Toulon. Le second était I'enseigne de vaisseau Huguet, du port de Rochefort. Le capitaine Rocomaure portait une casquette grand avenir, c'est-à-dire à large visière, à cuve vaste et flottante, pour s'affirmer de Toulon et du port de Toulon. Son second avait une casquette rigide comme une sorte de toquet, avec une visière microscopique collée sur le front; c'était la casquette de petit avenir. II était de Rochefort. En ce temps-là, chacun s'habillait un peu comme il le voulait, et certains uniformes se ressentaient de l'originalité de leurs propriétaires. J'ai dit un mot des casquettes du capitaine et du second; chacun se coillait à sa façon: un des officiers du bord trouvait joli d'avoir une casquette pour I'inspection, dont la visière était en écaille de tortue: II en était très fier; certains l'enviaient ! C'était un chic espagnol ! A terre, on arborait comme tenue suprême le chapeau de forme gris avec l'uniforme, redingote à revers largement ouverts, gilets variés, en coeur à un ou deux boutons ; une seule uniformité pour les favoris ! Ce n'est que plus tard qu'on adopta la barbe. La moustache, seule, à la Jean-Bart, nous fut apportée par le xxe siècle. Mon logement, à bord de ce brick trois-mats, n'existait pas ! Le soir on me crochait un hamac dans l'avant-carré, c'était simple et de bon gout. Dame ! on fait à présent plus de frais pour Fallières quand il va en Tunisie! Pour distraction, j'avais les incidents d'une traversée à voiles dans des régions de calme, puis l'inspection du dimanche. Ce jour-là, c'était réjouissance. Tout à bord était propre et reluisait, comme c'était la gloire des navires de guerre avant la vapeur; I'équipage en blanc, astiqué au clair, avait à la gauche les noirs habillés en marins et de très bonne tenue.
Le capitaine, long et dégingandé, arrivait sérieux à ce contingent noir et il adressait à chacun une bonne parole dans ce genre : «Ah ! te voilà, Boubou N'Diaye ! toi sage cette semaine? » Le noir disait toujours : « Oui, capitaine, sage ! - Huguet ! faisait Rocomaure, C'est vrai cela ? II faut récompenser cet homme là. » Huguet appelait le fourrier qui s'approchait, tenant d'un côté des petits pots de pommade dans son chapeau et de l'autre, dans une assiette, de la cassonnade, de ce que l'on appelait de la bonne quatrième. (Dieu ! ce qu'il y avait de crottes de rats !) Alors, suivant l'inspiration, Huguet faisait offrir au noir de la cassonnade ou bien un flacon de pommade. Dans un cas, le noir prenait,une poignée de cassonnade qu'il dévorait immédiatenment; dans l'autre cas, il s'emparait, récompense suprême, d'un petit flacon de pommade à la rose ou à l'oeillet ; il enlevait le bouchon et il vidait du doigt la pommade, dont il se beurrait la figure en manifestant la plus extrème volupté, voluptas voluptatum ! Aussitôt il apparaissait plus noir que jamais, à la grande admiration de ses camarades. Cette émulation particulière et négrotique d'avoir une figure vernie à des parfums violents et variés donnait les meilleurs résultats pour le travail du bord. Mais Huguet n'était pas prodigue de ces largesses que payait la caisse de détail.
Notre voyage de Dakar à Libreville dura quarante-cing jours, et nous portions la poste ! Parfois nous restions presque sans bouger sur une mer plate, brillante comme de l'étain fondu; alors nos grandes distractions étaient de voir apparaitre des troupeaux de marsouins. C'était aussi quelque espérance de sortir de notre repos, car le marsouin sautant annonce le vent, dit le proverbe marin. Ces marsouins chassaient, en lignes très régulières, comme des rabatteurs bien dressés. Ils arrivaient en bondissant et on ne se lassait pas de ce spectacle. Nous n'en avions d'ailleurs pas d'autre ! Les plus curieux des marsouins venaient évoluer autour de notre petit navire. C'est ce qu'on attendait, parce que le capitaine d'armes y trouvait à développer ses talents de maitre harponneur. Bien établi sur la sous-barbe, cet artiste attendait sa victime et lui lançait d'une main sûre son trait au cœur. II nous prit ainsi fort adroitement un marsouin tout blanc que nous lui avions désigné. Nous n'avons jamais vu d'autre marsouin albinos que celui-là dans nos nombreuses navigations.
Le capitaine d'armes joignait à ses talents d'harponneur celui de fabricant de pâtés. II voulut nous en faire un avec du marsouin. C'était horriblement mauvạis, à cause de l'odeur de poisson de ces animaux. Nous pouvons affirmer que le marsouin n'est pas comestible et pourtant il diffère bien peu du porc comme organisme. Quand on tuait un cochon et qu'on l'ouvrait en deux, si l'on avait en même temps un marsouin et qu'on l'ouvrit de même manière, on était étonné de voir que ces animaux, si différents à l'extérieur, étaient semblablement conformes au dedans. Natura simplicissima.
Notre cuisinier ordinaire était un noir sénégalais, embarqué avec son aide, qui se nommait le rapace. Jamais un cuisinier noir sénégalais n'embarque sans son rapace ! C'est son factotum ! Toute la journée on entendait le rapace fabriquer des hachis en maniant des couteaux comm s'il eût tenu les baguettes d'un tambour. C'était toute la musique du bord que ce roulement presque continu; cependant, parfois il était traversé par le cri strident d'un coq qu'on appelait Rustel de Bedfort, en souvenir d'un officier très élégant et très coureur, qui mourut quelques années après aux environs de Brest, en voulant franchir avec son cheval une vache qui traversait une route! (La marine aimait alors beaucoup à faire de la cavalerie à terre. On prétendait que celui qui sait se tenir sur une vergue doit savoir se cramponner sur un cheval !) Enfin, malgré ces innocents amusements; la traversée nous paraissait un peu longue, lorsqu'enfin furent signalées les terres du Gabon.
On atterrit classiquement sur le mont Bouët. On se guida sur l'ile Coniquet et, après avoir évité les bancs, on donna dans la grande passe, laissant à droite la pointe Pangara et le bois fétiche. Il fallait se défier des courants qui portent au Nord; on donna franchement sur le mouillage, poussés par la brise du large qui souffle sur ces régions heureusement à peu près régulièrement toutes les après-midi jusqu'à six heures. Bientôt, nous aperçûmes la montagne Sainte, puis, entrant dans ce grand estuaire, nous vimes le palais du gouvernement.
La Cordelière était mouillée en rade, ayant à côté d'elle un autre ponton et d'autres petits bateaux, dont une canonnière, la Mitrailleuse, anciennes unités de combat de l'ancienne marine, armées d'espingoles et de haches, voire d'espontons d'abordages. Les deux pontons, peints en gris clair, avaient des semblants de mâts destinés aux signaux. lIs étaient entièrement recouverts de toitures en bois; leur aspect était lugubre, on eut dit des sarcophages !

Nous les trouvâmes cependant très bien, tant nous étions désireux de sortir le plus tot possible de notre tout petit Entreprenant, où l'on était à cuire trop à l'étroit. La terre nous parut magnifique tout d'abord; nous étions frappés d'admiration par la splendide végétation du pays, car nous n'avions encore vu depuis France que les rochers d'Espagne, puis les sables et les roches dénudées de Dakar et de Gorée. J'échangeais mes impressions avec le lieutenant de vaisseau Testard, de Lesneven, avec qui j'avais fait la guerre en 1870 au fort de Bicètre et à la redoute des hautes Bruyères. D'être ensemble nous réconfortait de cet embarquement sur un triste ponton de la côte d'Afrique en un pays quasi sauvage.
Le 26 septembre, nous quittâmes l'Entreprenant, après avoir remercié les officiers du bord, Rocomaure, Huguet, Labastie, Chaudeborde, etc., qui avaient lait leur possible pour nous rendre moins dures les installations rudimentaires dont ils avaient dû disposer pour nous, faute d'autres. lls devaient rester quelque temps en rade et ils avaient à faire d'autres voyages pareils ; nous devions les revoir par la suite, tellement ennuyés sur leur brick qu'ils en arrivaient à envier notre situation sur la Cordelière. Tout est bien relatif en ce monde !
Arrivée à bord de la Cordeliėre – Un singe et un martin-pêcheur

Le 26 novembre 1872, l'embarcation qui était venue nous chercher à bord de I'Entreprenant, nous donnait déjà une idée de l'originalitė de notre futur lieu de séjour. C'était une baleinière armée de superbes noirs vétus simplement d'un morceau de pagne indispensable. Ces hommes avaient des musculatures admirables. Leurs bras étaient ornés de bracelets nombreux, sciés dans des dents d'éléphants. Ces hercules faisaient voler l'embarcation sur l'eau, cadençant leurs rigoureux coups d'aviron d'une mélopée gutturale qu'entonnait le chef de nage et que scandaient les bruits secs des ivoires de bracelets claquant les uns sur les autres ; l'équipage, à chaque note du patron, répliquait avec ensemble, à l'unisson, par un grognement qu'on aurait pu transcrire par: « Bo ! Bo ! Badis ! Bôo !!! C'étaient des hommes de Crow, qu'on appelle des Crowmen, et qu'on engage pour deux ans, en vue des travaux pénibles, sur toute cette côte d'Afrique. Les Crowmen sont pacifiques à l'encontre des Sénégalais ; qui sont des guerriers et que l'on prend plus spécialement pour les actions de guerre. Ces deux espèces de noirs diffèrent absolument de formes, de couleurs et de gouts. Il y a chez les uns et chez les autres de très braves gens, pleins de dévouement.

Quand nous accostâmes la Cordelière, il était environ trois heures de l'après-midi. Montés à bord, nous fûmes étonnés du calme absolu de ce bâtiment ; on n'y voyait personne. Et pourquoi donc ? parce que c'était l'heure de la sieste. Nous descendimes au carré. Un homme très gros, tout débraillé, en bras de chemise et en pantalon blanc, pieds nus, ronflait sur les coussins du canapé. Nons étions prévenus que c'était le second du bord. Ce modeste enseigne de vaisseau, qui provenait du cadre de maistrance, constituait tout l'état-major du capitaine de frégate, Garraud, gouverneur du Gabon.
Je voûlais respecter le repos de cet état-major, mais Testard, assez pointilleux sur l'étiquette et vexé d'avoir eu sur le pont une réception fort peu réglementaire, n'hésita pas à secouer le dormeur en l'interpellant par son nom: Eh Galidy ! Galidy ! » Notre mauvaise humeur ne put tenir devant la figure rougę et ahurie du dit Galidy, subitement arraché à son sommeil cataleptique. « Allons debout ! lui dit Testard, où sont nos chambres ? Nous ne nous mettions pas non plus beaucoup en frais de politesses, comme vous voyez. Galidy se décida, pour lors, à se mouvoir et, sans s'excuser de sa tenue, il nous montra à babord la chambre de Testard et, plus en arrière, à toucher le carré, celle qui m'était destinée. C'était la sienne pour le moment. Je fus désagréablement affecté de l'état de cette chambre: un singe attaché au sabord gambadait en ce logis. Il sentait très mauvais. Galidy s'excusa de son mieux et me dit de l'attendre au carré, qu'il allait faire sa toilette, puis ses malles, pour me céder la place. Je revins donc au carré. Il était assez grand, placé à l'arrière de la corvette, il avait quatre sabords pour l'aération ; mais deux bouteilles, alias water-closets à l'ancienne mode, ouvraient directement dans cette pièce; une odeur forte de cancrelats se dégageait de partout. Pour le moment, on ne voyait pas les insectes. lls faisaient également la sieste, sans doute ! Cependant, tandis que je passais une revue sommaire de ce local, je perçus des hurlements féroces provenant de ma future chambre. Une certaine agitation se fit alors dans le navire. On entendit des courses molles de pieds nus. On arrivait d'un peu partout, terminant plus tôt que d'habitude la sieste, et chacun apparaissait en costume spécial; pyjamas, caleçons, chemises, pareos, gandouros arrivaient vers nous, et c'est ainsi que nous fimes connaissance du docteur Le Grand, du docteur Pujot, du docteur Le Janne, des deux commissaires du bord, H.. et G..., du maitre d'hôtel, du cuisinier et de quelques comparses sans importance.
La cause de tout ce remue ménage était le cri d'effroi de Galidy, dont les économies avaient été saisies pąr son singe, perché maintenant en dehors sur le mantelet du sabord et jetant des pièces de cent sous à l'eau; il s'amusait, le pauvre ! Galidy heureusement rattrapa son sac, c'étaient ses économies de campagne ! Le singe s'enfuit à l'extérieur au bout de sa corde. Le folatre S... au pantalon fétiche en exécuta un pas. Tout le monde était très gai à présent et très réveillė. Le carré, avec ces costumes pittoresques, était très animé. Mais, autre cri d'alarme ! Cette fois, c'était l'ami Testard qui avait commencé ouverture de ses malles et qui avait eu la triste idée de mettre ses chaussures à sécher sur son mantelet de sabord. Le singe, n'ayant plus de piastres à jeter, avait aperçu ces chaussures et il était venu leur commencer un nettoyage radical, qui consistait à les envoyer à la mer rejoindre les piastres de Galidy. Conséquence : Testard furieux, usant de son pouvoir de second, débarqua aussitôt Galidy avec son singe et ses malles faites n'importe comment, et il l'expédia au brick l'Entreprenant. Ainsi fut remis le service.
Après ces émotions, nous nous mimes en tenue régulière, en redingote, épaulettes et sabre, ce qui déjà nous paraissait extraordinaire pour le pays, et nous fûmes nous présenter au commandant Garraud, gouverneur du Gabon. Dès notre entrée chez legouverneur, nous en eûmes une bonne impression. Il avait des souliers. C'était le premier individu du bord que nous trouvions si correct. II est vrai qu'il n'avait pas de gilet, mais il avait une requimpette en orléans, si curieuse de tons rougeàtres, verdàtres et autres, qu'on acceptait tout de suite sa cravate, faite d'un vieux ruban de robe de dame, sans doute un souvenir amoureux. A côté du gouverneur figurait son chapeau de feutre d'une couleur devenue indéfinissable au soleil équatorial. On savait qu'il avait été violet parce que le ruban en avait été enlevé récemment. La place s'en détachait vivement avec sa couleur originelle sur le fond, devenu gris de poussière et complėtement passé. Ce fut donc sans étonnement que nous entendions, en entrant au salon, le capitaine de l'Entreprenant qui prenait congé gaiement du gouverneur en lui disant: " Eh, commandant ! vous avez tout de même bonne mine (et avec un fort accent moko, c'est-à-dire toulonnais), et bé, semblez un martin pêcheur. " Cette familiarité n'avait pas été très appréciée par le gouverneur, qui nous fit, à nous, une réception digne, mais courte, quoique nous fussions bien innocents des galéjades du capitaine de l'Entreprenant.
Quand nous descendimes au carré, les camarades nous dirent « Il vous a parlé, cest étonnant ! cela ne vous arrivera pas souvent; il n'est pas gènant, on ne le voit presque jamais. » En effet, ce brave homme vécut toujours étranger à ses officiers, qu'il laissa parlaitement libres de leurs actions, ce dont nous lui gardậmes beaucoup de reconnaissance. Personnellement, je n'eus que les meilleurs rapports avec lui.Requins marteaux – Singes apprivoisės – Le défilé des élégants et des elégantes. La tornade - Les cancrelats, les moustiques, les ratsLe jour même de notre arrivée, nous descendimes à terre à quatre heures. II faisait encore très chaud, mais c'était l'heure réglementaire. La Cordelière était mouillée à un mille de terre; l'estuaire du Gabon avait, là, environ six milles de large, soit quelques douze kilomèlres. On était devant le palais du gouverneur, dont la place était plantée de superbes mangotiers datant de l'occupation rançaise (1839). Les va et vient nécessitaient une certaine attention, car il fallait se délier des lames qui formaient souvent une barre près du rivage. A de certains jours, cette traversée n'était pas sans danger, les requins marteaux foisonnant en rade. Ces requins sont des squales bizarres qui semblent, en effet, d'énormes marteaux, avec leur tête renflée étrangement; ils sont très féroces et tomber à l'eau est à éviter. Pour débarquer, on accostait à un mauvais appontement, en partie démoli par la mer. Les jours de houle, on allait carrément s'échouer à la plage; alors les Crowmen sautaient à l'eau, et, dės que l'on touchait le sable, ils tiraient au sec la baleinière. Il fallait l'habileté de ces noirs pour mener à bien cette besogne.

Ce fut pour moi l'enchantement que de voir cette superbe flore équatoriale. La végétation saillait de partout avec une intensité que je n'avais pas vue encore aussi forte, quoique j'eusse déja visité Balhia et Rio-de-Janeiro. Nos camarades nous mirent aucourant des occupations du pays en dehors du service, qu'on pouvait rėsumer ainsi : aprės déjeuner, comme nous l'avions vu déjà, tout le monde faisait la sieste jusqu'à quatre ou cinq heures, puis on allait se promener; à cinq heures et demie, on se retrouvait au jardin de la Cordelière, ou l'on se baignait, où l'on se douchait, puis l'on revenait tranquillement à la place du gouvernement, à la paillotte de la Cordelière, qui était une petite naisonnette composée de deux ou trois pièces, munie de verres d'eau, de rafraichissements variés et de l'absinthe traditionnelle, dont on faisait alors un usage régulier sur Ja cote d'Afrique. Elle empėchait, disait-on, les fièvres. Au Tonkin, elle empėche, dit-on, le choléra. C'est la meilleure panacée coloniale. Donc, à l'ombre d'une absinthe, c'est là qu'on s'installait sous cette vérandah pour deviser le plus joveusement possible en regardant passer les gens du pays.

On attendait ainsi l'heure de rentrer à bord, ordinairenment indiquée par I'arrivée de la tornade du soir qui venait avec une grande régularité en de certaines saisons. Une autre attraction de ce club d'officiers était la visite des singes, amenės à leurs propriétaires respectifs par des nėgres qui les gardaient à terre. Chaque officier avait, en effet, un ou deux singes, car l'enseigne Galidy n'était pas seul à posséder pareille bête domestique. Nous avions vu Galidy à bord avec son singe; c'était tout à fait exceptionnel, et parce qu'il s'apprètait à partir avec lui sur le brick Entreprenant. D'ordinaire, comme il y avait assez d'animaux malfaisants à bord de la Cordelière, la consigne commandait de laisser les singes a terre, où ils étaient beaucoup mieux et où ils ne genaient personne. Quand on allait se promener on se faisait amener son singe tenu en laisse comme un chien. On lui donnait quelques sucreries et on le lachait en liberté; dès lors, il vous accompagnait dans vos promenades, souvent très amusant par ses gambades dans les arbres chargés de lianes. Il vous suivait très fidèlement. Cela m'étonait toujours; mais, en réfléchissant, on comprend que la paresse et la gournandise lui commandaient cette conduite. Le singe, qu'on sait libidineux, est, en outre, un gourmand. On en fait ce qu'on veut par cette passion. Le soir, au club des officiers, les singes prenaient, eux aussi, des absinthes qu'on leur faisait carabinėes; rien n'était aussi drôle ensuite que de les voir s'élancer avec des accidents et des gestes de pochards, dėgringolant des arbres pour aller faire des politesses aux nègres qui passaient sur la promenade. Le singe adore l'absinthe. Nous n'avions pas seulement les singes pour nous divertir aux heures de club. Une maison de commerce avait inventé, à cette époque, de vendre aux indigènes des chapeaux tubes de toutes les couleurs, des gris, des roses, des jaunes, des verts, des violets, enfin de toutes les nuances les plus tendres de l'arc-en-ciel. Dès le premier soir, nous jouimes du spectacle du défilé des élégants, du cru, presque nus, mais coillés de ces jolies et très originales coiffures tuyaux de poële. lIs passaient en vous saluant très poliment pour la plupart. Quand, ils ne le faisaient pas, d'ailleurs, un simple appel de langue aux singes tapis dans les palmniers livrait aux bêtes le mal appris et c'étaient alors des rires homériques à voir les nėgres s'enfuir affolés, en protégeant leur précieux couvre-chef, pendant que les singes ivres cherchaient, en les poursuivant, à les leur ravir. Mais tout se terminait sans dommage, la plupart du temps, à cause de l'ébriété des singes qui finissaient par se houspiller entre eux en laissant I'homme se sauver, et du bon naturel du noir qui aime à rire.
Le costume des indigènes consistait en un simple pagne tourné autour du corps au-dessous des tétons. Les femmes, indifféremment, serraient leur pagne au-dessus ou en dessous de leur poitrine, mettant souvent en montre des appâts gourdilormes, bene pendentes; de proportions énormes. (Hėlas ! en avons-nous vu de ces lamentables mamelles !) Lamentables, au point de vue esthétique, mais autrement non. Là-bas, ce n'est pas une mauvaise note pour une femme que cette exubérance de seins, au contraire; elle indique une bonne mėre de famille; en ellet, les femmes portent leurs enfants sur le dos en les retenant par leur pagne; pour nourrir ce petit postillon, elles lui envoient leur sein par dessus leur épaule ! Vlan ! L'enfant se cramponne à sa bouteille vivante, qu'il allonge tant qu'il, peut pour boire plus facilement. De là cette extraordinaire longueur de mamelles des négresses de ce pays, comme de presque tous les autres, d'ailleurs. Ces meurs semblent être celles de la nature. On nous raconta qu'il y avait au village de Louis une femme qui avait des seins tombant au-dessous des genoux. Elle était énorme et on la citait dans le pays comme richement agrémentée à ce point de vue. Elle était, comme on dit à présent, un records pectoral. [...]

Tout le monde quittait régulièrement le Casino modeste de la paillotte quand on apercevait, vis-à-vis au-dessus du monument du gouvernement, les nuages de la tornade arrivant ponctuellement à la méme heure, tous les soirs. On s'empressait alors de rallier le bord de son navire. Une tornade est un orage à forme spéciale d'une très grande violence, dont nous parlerons en détail plus tard; pour le moment, je dirai seulement qu'elle s'annonce longtemps à l'avance par des coups de tonnerre, qui deviennent de plus en plus violents à mesure que l'orage se rapproche. Ces orages viennent toujours dans la mėme contrée, du même côté.

A Libreville, la.maisonnette des officiers faisait face au palais du gouvernement, sorte de long bâtiment peint à la chaux et qu'éclairaient en plein les rayons du soleil couchant. La tornade apparaissait à l'Est, au-dessus du palais du gouvernement, en énormes nuages que doraient les derniers feux du jour, puis ces immenses nuées, s'élevant comme un rideau de décor, semblaient tout à coup former une caverne horriblement noire, dont la limite supérieure élait très nettement marquée en un arc régulier. C'était un spectacle imposant. Dès que paraissait cet arc il était temps de filer à bord, ou l'on arrivait poursuivi par les coups de tonnerre. Le temps d'accoster et souvent, déjà, s'abattait la pluie diluvienne avec les éclairs et les détonations les plus eflrayantes; mais, à bord de la Cordelière, on était à l'abri sous le toit qui recouvrait toute la corvette et on allait se mettre joyeusement à table pendant que la tempète faisait rage au dehors. Cependant les premiers jours on ne pouvait s'empêcher de tressaillir aux déchirements brusques de la foudre trop rapprochée, et puis on s'y habituait; plus tard, on y prenait plaisir, car ces coups de tonnerre amenaient la forte pluie rafraichissante dans une température de 30° de moyenne à l'ombre.
Mon impression de début à ce premier diner de la Cordelière fut que nous n'étions pas dans une colonie banale. Les tonnerres de la tornade, comme un orchestre splendide d'horreur, nous tenaient compagnie pendant le repas. L'atmosphère, surchargée d'électricité, était sillonnée des vols des cancrelats qu'excitaient toutes ces fulgurences; je n'avais pas encore vu voler autant de ces affreux animaux, cela m'étonnait, comme effet diabolique. Des nėgres, presque nus, servaient à table; c'étaient nos domestiques, sortes de statues de bronze à l'odeur de fauve qu'on voyait peu, mais dont la présence se manifestait à l'odorat. Ils étaient absolument propres, mais leur odeur était celle des tigres en liberté. Ajoutez à tout cela pas mal de moustiques ! Quand il n'y avait pas d'éclairs, on n'avait pour luminaire qu'une lampe à huile minuscule, économique. Non! ce n'était pas là le Café des Anglais !
On ne se couchait pas de bonne heure à bord de ce navire. On attendait la fin de l'orage, qui durait généralement jusque vers les onze heures; on jouissait alors d'une fraicheur relative en contemplant un ciel tout lumineux d'étoiles. Ce soir-là, après avoir observé ces phénomènes, je me retirai dans ma chambre. J'y constatai quelque chose de fort désagréable qu'on ne m'avait pas signalé, c'est que cette chambre, située auprès de l'office, était visitée par des nuées de cancrelats et de rats, tous fort odorants et fort déplaisants en leurs audaces. Je m'expliquai alors le sommeil profond de Galidy pendant le jour. Il se rattrapait de la nuit. Combien de fois, plus tard, ne pouvant dormir, je passai des heures entières de nuit occupé à piquer avec un poignard sur les persiennes qui formaient les cloisons de ma chambre les cancrelats qui les constellaient, sorte de gnomes noirs aux grandes antennes toujours mobiles, aux yeux brillants qui semblaient vous narguer. IIs étaient légions. On en tuait, il en revenait; de guerre lasse, on allait se coucher; alors les rats couraient sur le lit. Je finis toutefois par m'endormir en me disant par manière de philosophie: Les journées seront probablement intéressantes, mais les nuits seront surement sans agréments et je me consolai en rêvant qu'à terre, dans l'ombre de la forėt équatoriale, dans cette brousse admirable que j'avais aperçue en arrivant, des tigres, des éléphants, des serpents et d'autres bêtes monstrueuses devaient en ce moment se rafraichir en se frottant aux lianes parfumées qu'avait inondées la tornade. C'étaient les bruissements des cancrelats qui, dans mon sommeil, devenaient les bruits des fauves dans la forêt; C'étaient les galops des rats qui me paraissaient des fuites affolées d'antilopes que poursuivaient des animaux superbes aux mouvements souples et rapides, mais aux odeurs spéciales qui les révélaient aux pauvres herbivores dont ils se nourrissaient. Je voyais encore en rêve des singes pochards qui se battaient avec des nėgres à chapeaux de couleurs brillantes; je voyais des éclairs, des belles feuilles de bananiers, des négresses en pagnes multicolores. Enfin, le sommeil calme et réconfortant me prenait; sans doute quand le bal des rats et des cancrelats finissait, car ces animaux sont plutot des nocturnes qui se retirent avant le lever du joụr. Sans cela on n'y tiendrait pas. J'ai oublié d'insister sur les moustiques dans l'énumération des balleurs nocturnes de ma corvette gabonnaise. Ajoutons-les aux autres malfaiteurs déjà signalés.Encore des rats - Un duel au sabre à bord de la corvette la Cordelière, au Gabon (1872)
C'est une petite histoire des premières impressions gabonnaises. Au coucher du soleil, vint comme d'habitude la tornade. Là nuit n'ėtait pas encore faite que déjà les embarcations avaient rallié la Cordelière, mouillée à un mille de terre par le travers de Libreville, dans I'estuaire du Gabon. Aussitôt on les avait hissées à leurs porte-manteaux et on les avait amarrées en vue de la toumente qui se prėparait. Les nables avaient été soigneusement débouchés pour que l'eau de pluie pût s'écouler sans trop alourdir les citernes qu'allaient devenir tous ces esquifs suspendus à leurs palans ? Ces opérations n'étaient pas finies depuis longtermps et l'équipage était encore sur le pont, lorsque la tornade, qui montait vite de l'họrizon avec ses éclairs et ses roulements de tonnerre, arriva déverser ses trombes d'eau sur notre bâtiment. Il fallait vraiment avoir pris l'habitude de vivre au milieu de ces météores. pour ne pas être effrayé des détonations fulgurantes qui traversaient l'air, du bruit, de la pluie tombant à seaux, des déchirements brusques de la foudre. Mais on s'habitue à tout et, déjà réunis au carré, les officiers se réjouissaient de la fraicheur relative qu'amenait la tornade. Cependant, ils étaient nerveux, et, sur un motif bien futile, les discussions étaient devenues aigres. II s'agissait de cette opinion qu'avançait un des convives : « Je parie, disait-il, que tous ces coups de tonnerre donnent à l'eau de pluie une réaction acide en lui fournissant de l'acide azotique. Mais non, disaient les uns ; mais si, disaient les autres. Vous vous trompez, l'eau des orages contient de l'ammoniaque, c'est connu, et non pas de l'acide azotique, et patati et patata ! » Enfin, le pharmacien dut aller chercher du papier de tournesol, qui montra lumineusement qu'il devenait rouge à la pluie de tornade, et donc que c'était bien de l'acide azotique qui était formé dans ces explosions violentes des tonnerres gabonnais.
Il faut avoir vécu dans des carrés de navire pour comprendre comment une discussion aussi simple peut dégénérer presque en dispute. Nous aurions dû nous en amuser, comme le faisait le Crowman qui nous servait à table, silencieux, mais hilare de toutes ses belles dents blanches reluisant dans sa figure de bronze, statue, vivante aux proportions admirables, sans costume, n'ayant pour feuille de vigne qu'un simple mouchoir. Ce Crowman ruisselait d'eau, car il allait chercher les plats à la cuisine à l'avant du navire, et, chaque fois qu'il traversait le pont, il recevait les abats d'eau de la tempête, de sorte qu'arrivant avec les assiettes, protégées par des couvercles étincelants, il semblait chaque fois venir du fleuve, où il aurait été chercher en plongeant quelque « clypens » coulé par mégarde et repêché par miracle.

Après le diner, on s'amusa en donnant à manger à un marsupial minuscule qui était, prisonnier dans une cage à serin. Puis, à un caïman qui nageait dans une baille placée dans un coin, on enleva l'amarrage de bitord qui lui tenait prudemment les machoires fermées. Une fois l'animal à son aise, on lui passa du pain, de la viande et autres objets comestibles ou non, sur lesquels il se lança avec voracité. Puis il fallut lui remettre sa muselière. Opération délicate, mais que les ressources du noeud coulant résolurent comme tous les soirs. A partir du moment de cette servitude, le caïman était extrait de sa baille et il errait mélancoliquement le long des cloisons du carré; gigantesque lézard un peu musqué, on n'y faisait pas attention; l'odorat est indulgent quand on est embarqué. Pendant ces divertissements, les pipes allaient leur train, l'atmosphère se corsait de fumées qui semblaient celles de pièces d'artillerie dont l'orage fournissait la musique. Les cris des discussions aidant, on se serait cru au milieu d'un combat naval.
J'allai sur le pont lorsque la pluie cessa. C'étaient à présent les étoiles et le calme de la nature avec quelques cris joyeux de nocturnes allant commencer leurs chasses. Tous les soirs, avant de rallier ma cabine, je venais ainsi prendre l'air sur la dunette. L'atmosphère était purifiée par la tornade, on respirait avec plaisir après les chaleurs étouffantes de la journée. Quelquefois, il faisait relativement frais ; alors je me roulais dans une couverture et je m'endormais là pendant des heures. Puis je descendais chez moi, au milieu des odeurs de toutes sortes, dont celles des cancrelats étaient les plus méphitiques. On voyait les petits yeux de ces animaux désagréables briller à la base de leurs longues cornes toujours agitées. IIs étaient très vifs et très défiants. Ils allaient et venaient à l'apparition de la lumière. Parfois ils s'envolaient et semblaient alors sentir un peu plus mauvais. IIs ne distillaient que de la pestilence ! Ou bien on les voyait fuir de toutes parts comme affolés : c'était un rat qui faisait sa ronde. Rats et cancrelats constellaient les ponts et les cloisons. Les chiens et les chats remuaient un peu les oreilles à leur approche; ils avaient renoncé à les détruire. Nous couchions dans des cabines mal défendues contre toutes ces vermines.
Enfin, ce soir-là, j'avais fini par venir trouver mon lit; il était dans un coin, la tête du côté de la cloison de la coursive. Je tombai de sommeil bientôt, malgré rats et cancrelats. Tout à coup, je fus tiré de mon profond et délicieux anéantissement par une sensation qu'il faut avoir éprouvée pour savoir combien elle était répugnante. Figurez-vous qu'un gros rat avait imaginé de pénétrer chez inoi. Il avait grimpé de I'extérieur jusqu'aux boiseries ajourées qui laissaient venir l'air près du plafond, et là, se lançant au hasard, il était venu tomber à quatre pattes et de ventre en plein sur ma figure ! Vous comprenez que je ne fis qu'un bond ! je sautai de mon lit, j'allumai ma bougie et je saisis d'une main mon bougeoir, ayant pris dans l'autre moi sabre. Je me mis à chercher mon rat dans ma cabine. L'espace n'était pas grand, mais il était encombré. De temps en temps, j'apercevais mon malfaiteur, j'allongeai un coup droit: manqué ! Je tempestais ! Mon voisin, brave lieutenant de vaisseau (il s'agit de Testard), vint au bruit comme faisaient les lieutenants de Napoléon pour le canon. Il entra vivement chez moi avec son bougeoir et son sabre ; nécessairement il était en bannière comme moi. Dès lors, la chasse commença, très animée. Le rat filait d'un côté de l'autre, nous menaçait quelquefois, et, vu notre costume, nous frémissions à son approche. Quand nous croyions le tenir dans un coin, c'étaient des cliquetis de fer qu'accompagnaient nos cris. Les sabres s'entrechoquaient, nous proférions des injures, à bord on n'est pas très collet monté. Aussi les c..., b.. de s.. et autres aménités voltigeaient avec accompagnement des cliquetis d'armes blanches. Les atteintes aux boiseries attrapant les coups de taille résonnant en bruits sourds, les coups de pointe à fond faisant vibrer les panneaux, avec cela les cris du rat quand il voyait passer la mort de trop près, tout ce vacarme devait paraitre fantastique pour des personnes à l'extérieur de la cabine. Aussi bientot un rassemblement de gens inquiets s'était-il formé dans la coursive. lls demandaient : Qu'y a-t-il ? Arrètez ! lIs vont se tuer ! » lls n'osaient pas entrer de peur d'attraper un coup de manchette ou une lançonade qui ne leur était pas destinée. Cependant, un plus brave ouvrit la porte. Il était aussi en bannière avec son bougeoir à la main (on n'éclairait pas encore les navires à l'électricité). II vit avec plaisir que nous étions intacts et sans blessures. Mais alors ? Un rat ! II voulut s'en mêler ! mais le rat avisé avait pris la porte et nous restâmes quinauds après cette bagarre. On nous félicita cependant comme après un combat heureux où il n'y a eu que des héros et pas de victimes, car les cerveaux frappés par les discussions du diner au carré avaient travaillé pendant le sommeil lourd des premières heures, et tout le monde était arrivé, trompé par le cliquetis des armes et les cris des chasseurs, à croire à un duel sans merci au sabre et à la chandelle.
Cette aventure se termina par des rires au carré, où chacun se rendit avec son bougeoir. Un farceur posa même le sien sur le caiman muselé, qui errait toujours mélancolique et qui dut se trouver bien extraordinaire en son role de Lucifer. On organisa un souper avec des conserves, qu'on arrosa d'un bon petit vin blanc de Cassis. [...]
Aperçu de Libreville en 1872
La place du Gouvernement, ouverte du coté de la mer, était, d'autre part, entourée de bâtiments formant un fer cheval. Au sud, à droite, les magasins des approvisionnements, toujours en lutte avec les fourmis qui dévorent tout dans ces climats ; on les combat avec le sel marin, qui seul les arrệte. En en répandant sur le sol ou bien en arrosant d'eau salée les allées, on leur barre le passage et on les fait fuir. Sur le même coté, les bâtiments du commissariat et le Trésor. Au fond, à l'est, le palais du gouverneur, édifice peint à la chaux avec portiques au rez-de-chaussée et au premier. En bas les salles de la justice et de la police ; au premier, les appartements du gouverneur, qu'il n'occupait que pendant la journée, allant coucher à bord comme tous les officiers blancs. A gauche, au nord, il y avait l'hôpital, les magasins de l'artillerie, le logement des soeurs, la chapelle. Une herbe épaisse couvrait la place, que deux allées de mangotiers coupaient en croix. Du côté de la mer, il n'y avait que la petite case des officiers sur un talus couvert de végétations denses qui dominait la plage.


Là se rouillaient, malgré tous les coaltars possibles, les chaines et les ancres d'approvisionnement dans des graminées, des lianes et des bananiers qui formaient un fouillis inextricable. La rouille mangeait tout, malgré tous les soins. C'est dans cette colonie du Gabon, d'ailleurs, qu'on signala, jadis, des canons disparus par l'action de l'air ; les farceurs dirent qu'ils avaient été mangés par les cancrelats ! Le plus fort est que c'eût été possible, car les tornades et les coups de soleil font tomber en poussière tout ce qui est fer et les cancrelats dévorent toutes les poussières de détritus. Au Gabon, les actions atmosphériques étaient si corrosives qu'on avait toutes les peines du monde à conserver pour la navigation deux chaloupes à vapeur en fer, dont on se servait couramment. II fallait en avoir une à l'eau une semaine et la mettre ensuite en réparation pendant une autre semaine. Ces chaloupes donnaient un mal énorme à tenir en bon état. C'étaient des cauchemars pour le second du bord.
Derrière le Gouvernement, un sentier s'enfonçait dans les brousses, ayant à gauche l'hopital où l'on remisait les singes. On y soignait aussi des noirs. Les blancs venaient à bord de la Cordelère, où les soins éclairés du docteur Legrand, de son second Pujot, des médecins. Le Janne et plus tard du docteur C..., tâchaient de les tirer de leurs accès de fièvre. Un arbre énorme de cet hôpital était rempli de nids pendant comme des gourdes des branches. En continuant le sentier, on trouvait le quartier de mes laptots, logés dans des cases à la mode du pays. Plus loin encore, c'était le cimetière, bien garni avec les tombes des soeurs, très massives pour empêcher les fabricants de fétiches de venir profaner les dépouilles des femmes blanches. Notre cuisinier du bord, Samba, avait été accusé de pareil crime ; faute de preuves on l'avait relaché et même pris à la cuisine des officiers !
II n'avait aucun scrupule ! Son fils, employé aussi au carré, dénonçait généralement ces méfaits paternels ! Puis on allait assez loin, jusqu'à un monticule de 65 mètres de haut, dominé par un arbre à trois étages très remarquable, d'où on apercevait au Nord le mont Bouët ! Mais tout était tellement perdu dans les grandes herbes, dans les lianes et les grands arbres, qu'on ne s'y débrouillait pas très bien. Le caractéristique du paysage était toute la gamme des verts sur une terre rouge, à peine entrevue sous la végétation. Un très beau jardin envahi par la brousse était à l'est du Gouvernement, on l'appelait le jardin de Kerhallet. Plus près de la mer, il y en avait un autre plus modeste, entouré de pieux de bambous, qui était celui de la Cordelière. On y avait aménagé un beau bassin où les officiers se baignaient. L'eau y arrivait par un ruisseau et s'écoulait en douche, puis allait à la mer en une sorte de fossé qui longeait l'établissement du traitant Airnain [...]Il y avait bien aussi d'autres femmes blanches, il est vrai, mais celles-là étaient de pauvres soeurs aux figures émaciées qui tâchaient d'inculquer quelque idée de chasteté aux jeunes indigènes, sans jamais y parvenir. Ces pauvres soeurs périssaient les unes après les autres à cette impossible besogne. Tous les jours je descendais à terre ; le matin, j'allais faire maneuvrer mes laptots ; le soir, je faisais des excursions.

Or, on pouvait, en allant se promener, adopter de piquer droit vers l'intérieur dans les sentiers à travers les brousses, mais cette promenade n'était pas très fraiche, ou bien l'on pouvait suivre la plage, en se dirigeant à droite ou à gauche, profitant un peu de la brise du large et n'ayant pas de lianes à couper pour avancer dans un fouillis de verdure. Mes premières randonnées se firent tout naturellement en descendant le fleuve et en allant vers la mer. On respirait mieux en se dirigeant au nord.


C'est ainsi qu'aux débuts, surpris par l'atmosphère lourde du pays, on s'échappait vers le large machinalement. Il n'y avait ni voitures, ni chevaux, ni ânes au Gabon. On était obligé d'aller toujours à pied. On aurait pu supposer qu'on y trouverait des charrettes à boeufs, car les boeufs pouvaient vivre en ces climats, mais cela n'éxistait pas, pour la raison qu'il n'y avait pas de chemins ; on n'y trouvait que des sentes entretenues par le passage des piétons ou des fauves et envahies aussitot par la végétation si l'on cessait quelques jours d'y passer. Il n'y avait pas non plus de boeufs porteurs comme au Sénégal, ni de chameaux. Partout où le cheval ou l'âne ne peuvent pas exister, la vie du blanc est très aléatoire. Au Gabon, ni chevaux ni ânes; en conséquence, on étąit fixé sur la salubrité de la colonie. Tout d'abord on craignait tout : le soleil, la fièvre, les tigres, les caīmans, les serpents, etc. On ne sortait qu'avec force parasoles, fusils, guètres, flacons de quinine, d'ammoniaque et autres pharmacies. Puis on s'habituait à la forêt ; on n'en craignait plus les surprises et on s'allégeait le plus possible pour circuler plus facilement.

La factorerie Pilastre - Un lavement sous l'Équateur
Les frères Pilastre étaient venus de Rouen faire la traite sur la côte d'Afrique, comme l'avait faite leur père, fondateur de leur établissement; ils étaient trois frères, dont un fut happé par un requin à l'ile du Prince, alors qu'il plongeait en une eau très claire pour voir quelque chose de brillant qui était justement ce requin; pris par la cuisse, il put s'échapper et remonter à la surface, mais il succomba en peu de minutes à sa blessure; un autre mourut des fièvres. L'ainé, resté seul, fortement déprimé par ces catastrophes, rentra en France.
A mon arrivée au Gabon, cette factorerie, qui était située au bord de la mer, près de l'établissement des Sœurs, faisait de bonnes affaires; les trois frères vivaient en bonne entente. Leur factorerie était construite à la mode coloniale, en bois, sans plafond, le parquet perché sur des piliers en maçonnerie terminés par des coupes mėtalliques où l'on entretenait de l'eau salée pour se garer des fourmis qui auraient dévoré le magasin. On y trouvait, couverte par la toiture, une vérandah faisant le tour de l'établissement, qui permettait de vivre à l'air à l'abri du soleil et de la pluie. Le magasin était long et spacieux, avec un comptoir qui tenait toute la longueur de la pièce; c'était quelque chose comme le dispositif de distribution des bagages dans les gares. Ayant grimpé un escalier de bois, le public entrait par une porte largement ouverte du côté de l'ombre et se répartissait le long du comptoir. Donc là ce n'était pas un vain mot que cette dénomination de comptoir de la côte d'Afrique.
On voyait dans les acheteurs toutes les races: les Pongwés ou Gabonnais, [...] lache et mou, beau, bien fait; ils avaient la figure sympathique et intelligente, couleur alezan doré, des attaches et des mains fines. Costume: un chapeau de feutre ou un tube coloré, colliers de verroterie, torse nu, reins ceints d'un pagne de couleur voyante. IIs causaient beaucoup et servaient de truchemens ou d'interprėtes assez volontiers. Les femmes gabonnaises avaient les épaules nues, des pagnes cachant pudiquement, les seins, des bagues et des bracelets de cuivre bien astiqués, et les jambes garnies depuis le cou-de-pied jusqu'au genou de cercles de laiton polis. Elles étaient très propres, mais leur coiffure au beurre de coco, dit beurre de galam, sentait légèrement le rance. Il est curieux que ces gens-là n'aient pas l'odorat plus avide de bonnes odeurs; ils ont cependant des plantes très odoriférantes ; mais ces Africains ignorent les délicatesses des parfumeries employées par les sauvagesses d'Océanie, plus fines, plus policées, parce que la race rouge est plus près de la blanche que ne l'est la race noire.

La coiffure d'une femme gabonnaise prend plusieurs jours à confectionner; c'est un vrai travail de tissage de cheveux qu'exécutent des femmes artistes capillaires du pays. La forme générale de ces coiffures affecte un semblant de casque avec des cocardes sur les tempes. Le tout est beurré fortement avec le karilé (beurre de coco). Les élégantes ainsi parées, plantent dans leur coiffure une ou deux épingles en ivoire terminées par des parties plates, on dirait des sortes de flèches, on les appelle des tondos.

La médecine gabonnaise est très rudimentaire, ce ne sont que des infusions de plantes à avaler ou bien des cataplasmes de feuilles à appliquer. Il faut signaler cependant la manière dont ils s'administrent des lavements. Qu'on excuse cette description. Je vis un jour une mère en donner un à son jeune enlant. L'ayant placé sur sa cuisse droite, de manière qu'il ait bien en l'air son petit tutu, elle lui introduisit le bout d'une calebasse dans ce que les Espagnols appellent l'op del culs, puis elle se mit à souffler fortement par l'autre orifice de la calebasse pour chasser dans le corps du bambin une décoction tiède de quelques feuilles lénitives. Ce tableau de famille était assez pittoresque.

Dans cette factorerie Pilastre, sur laquelle j'insiste un peu parce qu'elle donne une idée de ces sortes d'établissements de la côte d'Afrique, les Gabonnais représentaient l'élément élégant et civilisé. lIs ne manquaient pas, en entrant, de saluer par un retentissant M'bolani! (bonjour vous) ou bien, si on se trouvait seul, M'bolo ! (bonjour toi) et ils portaient la main à leur bonnet; peut-être que les singes des officiers de la Cordelière étaient un peu pour quelque chose dans cette éducation de politesse. Enfin elle n'en n'existait pas moins. Les femmes, généralement assez bien en chair, avaient des yeux superbes qu'elles savaient faire parler à l'occasion.
A coté de ces demi-civilisés on voyait des représentants d'une race moins fine, plus rude, laide, petite, c'était celle des M'boulous. Quels vilains cocos! Les Gabonnais étaient la race maitresse du pays que nous étions venus occuper en 1839. Leur roi était Denis Rapatyombo, qui logeait de l'autre côté de lestuaire, à Denis. Jadis un personnage, ce potentat n'était plus guère considéré que comme une curiosité de l'ancien temps. Autrefois on lui rendait les honneurs du canon quand il venait à bord. C'était le plus grand roi du plus grand peuple du pays. Actuellement, on se dérangeait à peine à son passage. [...] Les M'boulous n'étaient que des tributaires dont les villages se trouvaient au nord de Libreville. Leur roi était Kringer, d'une esthétique très médiocre, mais père officiel d'une fort belle personne, la princesse Arundo, au nom romanesque, aux manières fort affables [...].
Parfois des êtres étranges, aux coiflures fantastiques; maigres, efflanqués, aux dents taillées en pointe, armés toujours d'une ou deux lances, sales avec des bracelets de fer ou de laiton, les reins ceints de peaux de singes ou de chats sauvages, portant des poignards de leur facture gainés de peaux de serpent, venaient par bandes de trois, ou quatre pour vendre une belle dent d'éléphant. IIs apportaient aussi des poires de caoutchouc ou bien des bûches d'ébène ou de bois rouge. Dès que les gens de la factorerie voyaient arriver ces sauvages avec ces poires de caoutchouc, ils entonnaient : C'est ta poire! poire! poire! c'est ta poire qu'il nous faut ! Les commis, placés derrière le comptoir, étaient pleins de politesse pour ces sauvages, qui étaient des Palhouins ou Fans, race venue de I'intérieur de l'Afrique, se rapprochant comme forme et comme couleur des Sénégalais.

Bientôt le maitre de la factorerie, lui-mėme, arrivait pour faire le marché. II leur offrait des rafraîchissements. Pendant qu'ils dégustaient des breuvages, les Pahouins examinaient les marchandises qui pendaient au plafond et qui paraissaient en pilastres derrière les commis vigilants, hors de portée de ces simiesques acheteurs. On ne leur laissait guère manier la marchandise autrement: pfft ! ni vu ni connu ! ils auraient dévallé dans la brousse avec ce qu'ils auraient agrippé. On leur montrait donc tout, mais avec la consigne mirar non locar. On leur faisait voir les beaux neptunes brillants comme de l'or qui étaient des plats de cuivre très grands, semblables à des moules de patisserie pour faire des tartes gigantesques. Ces neptunes étaient destinés à faire bouillir de l'eau de mer pour en extraire du sel. On vendait aussi des sacs de sel de 30 kilos. Ce poids est la charge régulière d'un porteur africain. Le sel était la monnaie du pays, on le vendait par sacs tout pesés de 30 kilos ; pas de détail à cause de l'humidité du climat. Les feuilles de tabac servaient de monnaie de billon. Pour les fortes sommes, on assemblait des lots de choses étranges, dont le fond était un assortiment d'étoffes de coton teintes aussi brillamment que possible, de fusils à pierre belges, de liqueurs impossibles venant d'Angleterre ! Les perles de verre étaient assez recherchées, mais il y avait des modes, nous échappant, pour ces ornements. On faisait aussi grand cas des fusils, mais à pierre de préférence. Les sacs de poudre et de plombs, les pierres à fusil étaient très demandés.[...]

Pour ces hommes primitifs le commerce est, sans conteste, l'art de se voler quelque chose les uns aux autres. Ils comprennent ainsi les transactions. Souvent les acheteurs de factorerie ignorent l'usage de ce qu'on leur donne dans le lot destiné à rétribuer l'apport de leurs marchandises. Je vis un jour deux Palouins qui, après une affaire commeiciale, s'étaient établis l'un en face de l'autre à déguster de l'affreuse eau-de-vie de traite dite alougou, dans un vase de nuit orné d'un oeil, épave de quelque foire des environs de Paris. Ce vase leur semblait une coupe enviable. Ces sauvages aiment assez à boire et on leur vend des liqueurs terribles, ils n'aiment que cela, l'alougou ou eau-de-vie de traite allemande, le kirsch venu de je ne sais où, sans doute de quelque fabrique d'acide sulfurique ou de Belgique, le gin, autre acide diabolique, horrible produit anglais. Plus le liquide brûle et plus les Pahouins l'affectionnent. [...]

IIs ne mangent pas souvent à leur faim, si l'on en juge par leur maigreur squelétique. lls se nourrissent de bananes, de gibier et fréquemment de chair humaine. Ce sont des anthropophages bien caractérisés. En 1872, on tenait les Pahouins éloignés de Libreville; on les empêchait de s'établir dans l'estuaire du Gabon. Quand ils s'approchaient trop ou qu'ils pirataient les traitants, on faisait contre eux de petites expéditions. C'est à cela que je servais de temps en temps avec mes quelques sinistres laptots borgnes. [...]

Actuellement, revenons à la factorerie Pilastre, que j'ai entrepris de décrire pour donner une idée de toutes les autres factoreries africaines. Nous savons déjà qu'il y avait un grand magasin avec un comptoir tout le long de la pièce; à l'entour il y avait les chambres des employés et du maitre de la factorerie, très simplement et très sommairement meublées; ces pièces contenaient comme meuble principal un lit à moustiquaire, car les moustiques et les cancrelats ne manquaient pas plus à terre qu'à bord, il fallait se garder en plus des scolopendres, des scorpions et autres insectes piquants ou contondants, en outre des fournis de toutes les formes et de toutes les grandeurs, fléaux dont nous souffrions moins à bord de la Cordelière, dont le couchage était envié par les traitants. On avait aussi parfois la visite de serpents, souvent tres venimeux, dits vipères cornues.
Chaque factorerie avait, suivant son importance, un certain nombre de Crowmen à ses ordres. Chez Pilastre il y en avait une soixantaine, logés dans une case à part, sur la plage, près des pirogues de la maison. Ces pirogues de traite ou sers-boats étaient superbes, taillées dans un seul tronc d'arbre, longues de dix à quinze mètres parfois, et larges de 1m50 environ. Elles provenaient d'arbres qu'on appelle fromagers ou coton-trees. Il y avait aussi de plus petites pirogues. La plage devant la factorerie Pilastre était des plus pittoresques avec ces embarcations légères aux formes fuselées, qu'armaient ces beaux Crowmen toujours riants. Le mouvement de cette marine faisait plaisir à voir.

Non loin de là, l'aspect de la plage était, au contraire, lugubre; on y voyait de nombreuses coques de navires échouées côte à côte sur le sable. On eut dit d'un cimetière de vaisseaux, c'était I'usage; les vieux serviteurs de la marine de guerre étaient amenés au Gabon pour y terminer leur carrière. On les conduisait au plein un peu plus loin que Pilastre et on les y laissait. Cela faisait un paysage étrange à cause de ces vieilles membrures qui semblaient des carcasses d'animaux gigantesques. On avait quelque peine à songer que ces épaves avaient flotté, portant fièrement notre pavillon dans tous les pays du monde. On aurait pu les insinérer et en tirer quelque parti peut-être ; en tous cas on eut fait disparaitre ce spectacle pénible de cette fin lamentable de vieux serviteurs. Je ne les contemplais jamais sans une certaine mélancolie.
La roche fétiche - Une scène chorégraphique en l'honneur de la Princesse ArundoII faisait chaud ! chaud ! chaud ! II était deux ou trois heures de l'après-midi à peine et la brise de mer tardait encore à s'établir. J'errais sur la dunette de la Cordelière à regarder le paysage, lorsque j'entendis quelques tamtams qui semblaient donner un concert au village de Pyrrha, proche de Libreville en remontant le fleuve. Je fis armer une baleinière et je partis voir ce qui se passait. Débarqué à notre appontement habituel, je passai devant la factorerie Airnain, puis devant une autre plus modeste, je traversai un ruisseau sur quelques planches et, à travers un petit bois, je ralliai la plage que je suivis ; elle était souvent interrompue par des roches, une, entre autres, qu'on appelait la roche féliche, massive, plate avec une sorte de rigole. On disait que c'était sur cette roche que les féticheurs accomplissaient leurs sacifices humains avant l'arrivée des blancs au Gabon. C'est possible ! Mais cela me semble bien solennel, pour des sauvages aussi simples ! Je continuai, appelé par le bruit des tamtams qu'on entendait de plus en plus actifs. Enfin, j'arrivai au petit village d'où sortait tout ce vacarme.

Je fus agréablement surpris par ce que je vis. Un certain nombre de femmes gabonnaises étaient alignées en plein soleil sur une sorte de place du village. Elles exécutaient un ballet chanté. Dans leurs mouvements flambloyaient leurs pagnes très voyants, de toutes les couleurs et tout neufs ; autour de leur tête, des étolles étaient posées en turban avec les bouts flottants sur l'oreille ; leurs bracelets de jambes reluisaient comme de l'or. EIles chantaient à l'unisson en exécutant avec beaucoup d'ensemble des mouvements gracieux et point impudiques. Elles agitaient ensemble leurs bras, en faisant flotter des étoffes de couleur ou en se frottant les mains en cadence. Et tout cet ensemble, sous un soleil étincelant, était un régal pour les yeux, s'il n'en était pas un pour les oreilles, car l'orchestre jouait en mesure des airs étranges avec une sorte de furie inlassable.

Cette fête était donnée à la princesse Arundo, assise dans un fauteuil d'osier, entourée de ses femmes, accroupies ou vautrées par terre, accompagnant la danse de battements de mains rythmés. On eût dit les castagnettes de cette musique. Sans qu'il y eut d'interruption dans les évolutions du corps de ballet, je fus amenė près de la princesse Arundo, qui me fit apporter un confortable fauteuil pareil au sien. Je me réjouis d'avoir devancé l'heure de ma promenade habituelle, assistant ainsi à l'improviste à cetle originale représentation. La princesse était loquace ; elle parlait le français d'une manière très compréhensible ; étant élève des bonnes Soeurs chez qui elle avait puisé des manières quasi-europėennes sur la tenue dans le monde. Elle m'apprit que ces femmes qui dansaient n'étaient autres que les danseuses du roi Denis; venues pour la circonstance, de l'autre côté du fleuve. C'était sa fête. Elle m'expliqua leurs chants qui n'avaient rien de bien extraordinaires comme pensées. Elle me fit remarquer l'ensemble des mouvements fort gracieux des ballerines qui ne levaient presque pas leurs jambes mais remuaient beaucoup leur torse, au contraire du corps de ballet de notre Academie nationale de danse. La princesse m'expliqua même les costumes. Ils étaient très simples. Un premier pagne servant en quelque sorte de chemise et de jupon et par-dessus un autre jouant le rôle de robe ou d'écharpe. Donc, pas de tutus ! Nécessairement ni pantalons, ni combinaisons ! Nous parlames aussi des visages glabres des musiciens et, à ce sujet, la princesse m'apprit qu'au Gabon les sapeurs eux-mèmes étaient rasés au plus près tous les matins.
Les danseuses semblaient infatigables; à la longue, leurs exercices devenant monotones, Arundo m'invita à venir visiter sa case. Puisqu'il s'agissait d'une princesse, c'était un palais! Il ne se distinguait guère des autres à l'extérieur ; au-dedans, il y avait seulement des nattes plus propres et plus neuves, en plus grand nombre que dans les autres habitations des personnes ordinaires, aussi, pour laisser passer la chaleur du jour, je restai là quelques heures, à converser avec cette aimable jeune fille. Elle babillait trės gentiment sur tous les sujets. Je pris plaisir à l'entendre exprimer ses idėes de jeune sauvagesse. Une chose l'étonnait beaucoup : c'est que nous n'avions pas amené d'Europe, avec nous, nos femmes, parce que l'idée de célibat lui était incomprélhensible. Songez donc que, dans ce pays, les filles commencent à devenir mėres vers dix ans! Aussi sainte Catherine est inconnue au Gabon ; personne ne la coiffe. Ce n'est pas un pays ordinaire : on y rase les cheveux des femmes, mais des captives seulement ; on y rase les mentons des hommes, mais seulement ceux des sapeurs. Les dames gabonnaises gardent leurs cheveux en des coillures très compliquées, coquettes comme des « wantos tanganis » (comme des femmes blanches).

Ayant interrogé Arundo, je vis que la Gabonnaise n'a pas d'idées poétiques sur l'amour. ll s'y organise très simplement. Elle n'a pas de formule polie pour en parler. ... Au Gabon, on avait fort à faire pour poétiser même les princesses. (On se tutoie toujours dans ce pays, cela n'a aucune conséquence).
La station locale du Gabon, située sur l'estuaire de Gabon, sert de base aux différentes missions d'exploration du Gabon. Bien que les navires de la division navale de l'Atlantique sud y séjournent souvent, seuls deux navires y stationnent à l'année : la Cordelière, et la Tirailleuse, une chaloupe-canonnière servant principalement à remonter les rivières.

Depuis plusieurs années, les marins et explorateurs français s'intéressent au Gabon et au fleuve Ogooué, considéré alors comme une des meilleures voies potentielles d'exploration pour accéder au centre de l'Afrique. . Victor de Compiègne et Alfred Marche, soutenus par la Société de Géographie, montent le projet de remonter le fleuve jusqu'à sa source. Le 1er novembre 1872, Victor s'embarque à Bordeaux précédé par Alfred Marche de quelques semaines. Victor est acceuilli par Messieurs Testard et Coffinières, officiers de la Cordelière. Voici comment il racontera sont arrivée dans l'estuaire : "Le 16 janvier, nous apercevions, dès huit heures du matin, la terre c'était celle du Gabon. Rien, lorsque, par un beau soleil, on entre dans le magnifique estuaire que forme ce fleuve, ne peut faire soupçonner qu'on arrive au pays des marécages, de la fièvre et de la malaria. On passe d'abord près de la pointe Clara, aux forêts immenses, à la végétation gigantesque puis viennent de riantes prairies émaillées d'arbres à fleur, sur lesquelles se détachent, au pied de grands baobabs, les habitations du roi Denis et de ses sujets. Dans la baie. le pavillon français, que nous n'avons pas vu depuis quelques jours, flotte sur un grand bâtiment d'aspect étrange. C'est la Cordelière, vieille et glorieuse frégate, convertie en ponton et en hôpital. Près d'elle, deux jolis petits avisos, la Tirailleuse et le Marabout, déploient aussi nos couleurs nationales. On approche, et, sur les vertes collines à demi boisées, on distingue plus nettement notre belle mission catholique et les cases qui l'environnent. A un kilomètre de là brillent au soleil la maison du gouverneur et l'ancien hôpital, dont la blancheur ressort au milieu du feuillage sombre des arbres à mangos qui les entourent puis les grands cocotiers du jardin de l'amiral et les maisons en planches des négociants, peintes de couleurs variées. Derrière tout cela, dans le lointain, s'élève le sommet bleu du mont Bouët. Si l'on se tourne vers la droite, on voit le fleuve Gabon suivre son cours et s'étendre à perte de vue, large et magnifique. Sur ses bords, Glass-Town, résidence des riches négociants anglais et allemands et des missionnaires américains, puis la pointe Ovoendo, et enfin, dans le fond du tableau, l'Ile–aux-Perroquets, avec l'entrée du fameux Remboë, dont les rives sont occupées par les Pahouins. 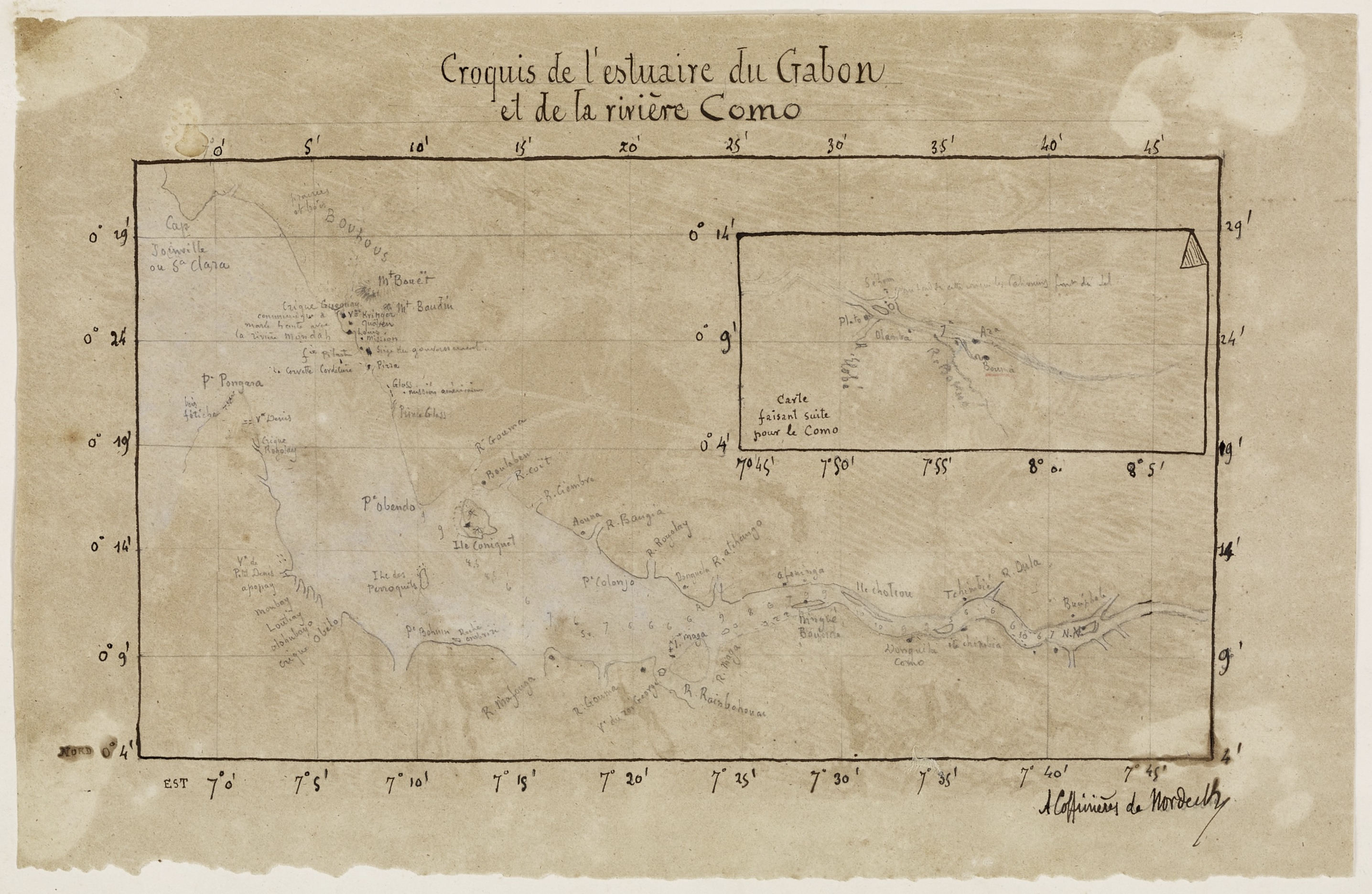
Nous avons jeté l'ancre à midi. Par suite de l'extrême insalubrité du climat, l'établissement français est aujourd'hui restreint à des proportions très modestes. C'est ainsi que l'on a retiré la compagnie d'infanterie de marine qui s'y trouvait, que l'amiral et son escadre, au lieu de séjourner au Gabon, font la station du Sud, et ne viennent ici que deux ou trois fois par an que l'hôpital, construction importante et faite avec beaucoup de soin, a été évacué pour les blancs, du moins, qui sont transférés à bord de la frégate que le palais du Gouvernement n'est occupé que pendant le jour; en un mot, que le vrai poste français est à bord de la Cordeliére. Aussi nous profitons du bateau de la santé pour nous faire conduire directement à bord de la Cordelière. Nous avons été reçus, non seulement avec cette exquise urbanité que l'on est sûr de rencontrer chez des officiers de la marine française, mais encore avec toutes les marques d'une obligeance à toute épreuve et d'un véritable intérêt. L'Africa ne devait pas repartir ce jour-là. Il fut convenu qu'on nous donnerait, le lendemain matin, la chaloupe à vapeur, pour transporter nos bagages; et en attendant que nous eussions un logis installé, les officiers nous offrirent l'hospitalité du carré. On verra du reste, dans la suite de ce récit, qu'il n'est sorte de bontés que ces messieurs n'aient eues pour nous chaque fois que nous sommes venus à l'établissement français du Gabon. Qu'il me soit permis, en mon nom et en celui de mon compagnon de voyage, de leur exprimer ici tous nos remercîments et toute notre gratitude. Je ne puis les nommer tous, mais je voudrais au moins citer, parmi ceux auxquels nous devons le plus Monsieur Guisolfe, commandant du Marabout; Messieurs Legrand et Pujot, médecins de la marine, qui nous ont prodigué des soins si dévoués enfin, nos excellents amis, Messieurs Coffinières de Nordeck et de Lansac, enseignes de vaisseau. Je reviens à mon récit. A trois heures, Monsieur Testard, second du bord, voulut bien nous conduire à terre pour nous présenter au commandant Garrot, qui est à la fois commandant du Gabon et de la Cordelière. Il est logé dans un grand bâtiment carré, blanc, et bâti à la mauresque. L'intérieur en est bien meublé, et il donne sur un très joli jardin. Cette construction qui, somme toute, présente une assez belle apparence, est un objet d'admiration superstitieuse pour les nègres qui viennent de l'intérieur. Des chefs hakalais, arrivés quelque temps auparavant, déclaraient que les hommes n'y étaient pour rien, et que la main du diable avait seule pu faire un pareil palais.

Comme je l'ai dit, le commandant ne s'y tient que pendant une partie de la journée, et a toute son installation à bord. Nous fûmes très-bien reçus; M. Garrot s'intéressa vivement à notre entreprise, et mit à notre disposition tous les documents intéressants du pays, soit au point de vue géographique, soit au point de vue de l'étude de la langue. Il nous promit de nous mettre en relation avec les hommes qui connaissaient l'intérieur, et qu'il serait bon de s'attacher à un point de vue quelconque. Enfin, ce qui était précieux pour nous, il mit à notre disposition, pour tout le temps de notre séjour, une case appartenant au gouvernement, et agréablement située sur le bord de la mer. Quand nous eûmes quitté le commandant, Monsieur Testard nous conduisit au jardin des officiers, où nous trouvâmes tous ces messieurs rassemblés. Sans ce jardin des officiers, je ne sais comment on vivrait au Gabon car c'est là qu'on trouve la meilleure, je dirai presque la seule distraction qu'offre ce triste pays. Il y a en effet là, sous une admirable voûte de bambous, qui forme un dôme inaccessible aux rayons du soleil le plus ardent, un grand bassin rempli d'eau courante dans lequel on se plonge et l'on nage avec bonheur. Là aussi on a établi un système de douches, véritable trésor dans l'Afrique équatoriale. On ne saurait imaginer rien de plus joli que le paysage qui entoure ce buen retiro, dont Monsieur. Coffinières de Nordeck a fait de ravissantes aquarelles.

Aussi, dès ce moment, nous devînmes les hôtes assidus du jardin des officiers. Le soir, nous retournâmes dîner à bord, où nous nous sommes couchés émus et enchantés d'un accueil si sympathique et si excellent. Le lendemain, nous allons à bord prendre nos bagages et serrer la main aux frères Grandy, avec lesquels nous échangeons toute sorte de vœux de succès; puis nous nous installons gaiement dans la petite maison que le commandant nous avait donnée. Jusqu'ici tout allait à souhait. Notre voyage s'accomplissait paisiblement et agréablement. Le lecteur a pu le voir, nous n'avions rencontré aucune contrariété, aucune difficulté sérieuse. Malheureusement, nous avions, comme dit la sagesse des nations, mangé notre pain blanc le premier. Maintenant, les mauvais jours allaient commencer, les jours de fièvre, de privations, de lutte constante avec les hommes et avec les choses. D'abord ce fut la maladie qui arriva : mon ami et compagnon de voyage, Alfred Marche, a habité la presqu'île de Malacca, il a été en Cochinchine, passé la mauvaise saison dans le Sénégal et dans la Gambie j'ai moi-même voyagé durant dix mois dans la partie la plus marécageuse de la Floride, séjourné deux fois sur l'isthme de Panama, et je suis resté assez longtemps sur cette côte des Mosquitos réputée si malsaine. Tous ces pays ont un mauvais renom en les trouvant beaucoup plus supportables qu'on ne le dit, nous nous étions flattés de l'espoir que l'insalubrité du Gabon aurait été exagérée. Malheureusement, il n'en est rien. Dans les pays dont je viens de parler, nous avions eu de mauvais jours, quelquefois souffert de la fièvre, très-souvent de l'ardeur excessive du soleil ou de pluies torrentielles mais nous n'avions rencontré nulle part cette atmosphère pesante et humide, ce malaise perpétuel, ces nuits qui n'apportent aucun repos, le thermomètre jour et nuit à 30 degrés, sans variations sensibles, le temps toujours à l'orage, presque tous les jours des averses effroyables qui surprennent à l'improviste et mouillent jusqu'aux os. Encore sommes-nous dans ce qu'on appelle la petite saison sèche. Aussi, dix jours après notre arrivée, la nuit même, Marche et moi nous fûmes pris de vomissements violents aux vomissements succédèrent deux heures d'un frisson glacial, puis, pendant quatre ou cinq heures, une chaleur brûlante, une soif intolérable. C'est la fièvre du pays. Nous payions notre premier tribut à ce terrible climat du Gabon tribut dont nous nous sommes depuis si largement acquittés. Le lendemain, comme notre état avait empiré, il fallut nous transporter à l'hôpital, où les soins les plus dévoués nous furent prodigués."

Victor de Compiègne et Alfred Marche firent plusieurs séjours de repos sur la Cordelière durant leur périple. A la fin de l'été 1873, épuisés par les maladies tropicales, les deux explorateurs durent retourner à la station de Libreville, pour y recevoir des soins. Compiègne écrit : "Tout à coup Marche, frappé d'une idée lumineuse, se rappela que nous avions dans notre malle, qui, par parenthèse, était dans un triste état, un pâté de foie gras. Ce pâté de foie gras nous avait été envoyé par M. Walker à Adanlinanlango, mais nous l'avions réservé pour ne le manger que le jour où nous aurions du pain et du sel qui nous manquaient là-bas; dans la circonstance actuelle, M. P. et Marche poussèrent des cris de joie en le découvrant; n'ayant pas de fourchettes, ils furent obligés de se servir de celles du père Adam. Marche avait remplacé à la barre le Krouman qui n'en pouvait plus, il tenait le gouvernail d'une main et de l'autre la boite au pâté tout à coup arrive un coup de roulis qui lui fait perdre l'équilibre et voilà le foie gras qui roule dans la mer ! Il y a de ces désastres que la plume ne doit même pas essayer de décrire. Cependant ce jour-là devait voir la fin de nos maux à midi, poussés par une brise excellente, nous atteignions la pointe Pongara à deux heures, après l'avoir doublée, non sans peine, nous entrions dans l'estuaire du Gabon. Là, notre goélette se comporta d'une façon si ridicule qu'elle attira l'attention d'un officier de marine qui se promenait sur le pont de la Cordelière il appela aussitôt ses camarades, et tous étaient à nous regarder, se demandant d'où pouvait venir et à qui pouvait être un bateau manœuvrant d'une manière aussi fantaisiste. Ils furent quelque temps sans pouvoir s'en rendre compte; mais en voulant doubler la Cordelière pour gagner la terre, nos marins manquèrent leur coup et nous vînmes rester en plan à cent soixante mètres de la frégate les officiers coururent chercher une longuevue et découvrirent avec stupeur leurs amis les explorateurs. Aussitôt une baleinière fut détachée du bord, et Coffinières vint nous chercher. « Mon pauvre Compiègne, me cria-t-il du plus loin qu'il m'aperçut, dans quel état vous revenez. Il y a longtemps que nous vous attendions, me dit Monsieur Testard, le second de la frégate, au moment où nous mettions le pied à bord, aussi votre chambre est prête : notre chambre était une des chambres de l'hôpital que l'on réservait d'habitude aux officiers malades; nous nous y installâmes aussitôt; nous l'occupions alors pour la troisième, mais non pour la dernière fois."
Les deux explorateurs feront un relevé de plus de 400 km du fleuve, auparavant en blanc sur la carte. Ils étudiront la langue M'Pongwé et celle d'autres tribus, établiront un catalogue scientifique très précis des diverses pièces qu'ils rapporteront. Victor de Compiègne deviendra l'ami de N'Combé, le "Roi-Soleil", chef de tribu à Adanlinanlago, sur l'autre rive de l'Ogooué, en face de Lambaréné. À la pointe extrême de leur exploration, ils seront arrêtés par une attaque de cannibales qui massacreront la plus grande partie de leur porteurs. Ils devront alors rebrousser chemin et rejoindront une dernière fois la Cordelière, dans un état de santé déplorable. Compiègne écrit : "Mon entrée sur la Cordelière ne fut pas brillante; j'étais nu pieds, en haillons et me traînant à peine; aussi les matelots qui avaient été renouvelés depuis notre départ me virent avec un grand étonnement prendre, sans me tromper, le chemin qui menait au carré d'officiers. Il y avait beaucoup de nouveau à bord : les officiers qui avaient été si aimables pour nous, Messieurs Testard et Coffinières, étaient retournés en France ; mais leurs remplaçants, Messieurs Letroquère et de Lansac, nous accueillirent comme de vieux amis." Les deux explorateurs rejoindront Paris le 20 juillet 1874. Le 5 août 1874, Compiègne fera le récit de son expédition devant les membres de la Société de Géographie. Miné par la malaria, il ne pourra entreprendre de nouvelles explorations. L'année suivante, Pierre Savorgnan de Brazza se rendra célèbre en reprennant les traces de Victor de Compiègne au Gabon, aidé de ses carnets, notes et observations, qu'il viendra chercher en personne dans la propriété familiale de Victor à Fuligny. Il explorera l'Ogooué, le Congo et fondra la ville de Brazzaville. Aspirant de marine en 1872, il a séjourné en même temps que Paul dans la station française du Gabon pour préparer son expédition.
A l'automne 1873, après avoir passé une année en Afrique, Paul rentrera à Brest où il restera à terre jusqu'au mois de novembre 1874. Il se rendra alors à Toulon et embarquera sur le Tarn, navire de transport à destination de Saïgon.
Division de l'Atlantique sud. — Dakar et Gabon
3 mars 73 remplacé par panon
Paul restera à Paris jusqu'au 2 mars 1871.
Il retrouve au collège son cousin issu de germain Henri de Mauduit, qui a son âge, d'abord en 7ème, venant de Saint-Thégonnec, puis en 4ème, venant de Lesneven. Son père décède alors qu'il n'a que 14 ans. C'est sans doute la raison pour laquelle il entre très vite dans la vie « active ». En effet, il n'a que 16 ans quand il s'engage dans la Marine, dont il gravit les échelons : aspirant volontaire de 2ème puis 1ère classe. C'est en cette qualité qu'il participe à l'expédition franco-anglaise contre la Chine de 1856 à 1860 et est décoré de la médaille militaire lors de la prise de Canton (1858). Il est alors novice volontaire sur la Capricieuse. Le 16 janvier 1856, La Capricieuse appareille de Toulon pour se rendre en Chine. Elle passe par Teneriffe, touche Rio de Janeiro le 6 mars et arrive le 22 avril à Sirnon's bay qu'elle quitte le 2 mai. Le 9 juin, elle franchit le détroit de la Sonde, le 12 celui de Banca et mouille le 15 à Singapour d'où elle appareille le 29 juin pour le golfe du Siam, près de Bangkok, qu'elle quitte le 21 septembre pour aller explorer les côtes du Cambodge jusqu'au 7 octobre. Elle remonte alors vers Tourane où l'attend la corvette à roues le Catinat et où elle mouille le 24 octobre après avoir essuyé un typhon près des Paracels. Elle appareille le 7 février 1857 pour se rendre à Macao et Hong-Kong, où elle reste 5 mois. Le 11 juin, La Capricieuse se rend dans le nord avec l'aviso Marceau, mouille à Ning-Po et prend quelques jonques de pirates qu'elle est obligée de couler ; elle ramène leurs équipages à Macao après avoir touché Chin-Ai et Amoy.
Le 2 septembre, notre corvette repart de Hong-Kong avec la Durance, un transport, pour aller à Shang-Hal où elle passe au bassin. Le 26 novembre, toujours avec la Durance, elle fait route de nouveau pour Hong-Kong. Le 11 décembre, remorquée par la corvette mixte Phlégéton, elle remonte jusqu'à Canton, prend part à la prise de cette ville et y reste en station jusqu'à son départ pour la France le 19 juin 1860.
Il poursuit sa progression en devenant successivement aspirant de 2ème et 1ère classe.
Il est enseigne de vaisseau à partir de 1865, et lieutenant à partir de 1869.
Le 28 octobre 1869, il est fait chevalier de l'ordre royal du Cambodge.
A cette époque, il participe à l'exploration du Mékong,avec Francis Garnier. En 1873, ce dernier et quelques autres hommes sont sauvagement assassinés par les Pavillons noirs.
Paul est fait chevalier de la LH en 1875, étant alors lieutenant à bord du Fleurus, et c'est un dénommé Testard du Cosquer (très probablement Eugène, son oncle à la mode de Bretagne), capitaine de vaisseau qui lui en remet le titre et les insignes le 7 avril à Saïgon.
Paul Testard est surnommé « Sao ne Peuz » (orthographe?) par les marins, qui n'appréciaient guère son caractère irascible, au moment des inspections, et « l'espion des grèves » par la famille.
Il revient en France en 1877 pour demeurer à Brest après avoir vécu plus de 20 ans en Asie. A peine arrivé à terre, il fait publier les bans de son mariage avec Marie Collin, qu'il avait promis d'épouser bien auparavant et qu'il avait laissé l'attendre.
Il démissionne au poste de lieutenant de vaisseau et prend sa retraite en 1879 dans sa maison de la rue Alsace-Lorraine, devenue ensuite la maison Abily.
Il habitait Lesneven, mais comme il était marin, il voulait voir la mer et fait construire en 1872 (date à vérifier) la maison de Ker Treaz « maison du sable » dans la baie de Pontusval (actuelle ville de Brignogan-Plages). A l'époque, Brignogan n'était qu'un hameau plus à l'intérieur des terres. Les paysans y ramassaient du goémon et de là en partaient des convois pour aller fertiliser les terres dans tout le pays. C'était aussi une baie de mouillage pour les navires, et on y trouvait souvent des marins anglais. C'est aussi le pays des naufrageurs, car selon la légende, certains brigands attiraient les bateaux sur les récifs avec des lumières qui imitaient celles du phare. Mais le littoral n'était pas du tout construit, et la maison de Ker Tréaz fut la première à jouxter la plage. Cette maison à été agrandie en 1948.
En 1901, il vit rue Tréchou à Lesneven avec sa femme Marie, ses belles sœurs Louise et Virginie ainsi qu'une domestique nommée Philomène Tanguy.
"Paul Testard (père de ma belle-mère) serait parait-il mort de colère (dixit l'oncle Pierre). Ayant des responsabilités communales, il a un matin une grosse discussion avec un administré mécontent. Puis, vers le soir, un incendie se déclare en ville - grosse colère du grand-père! - Les pompiers se déplacent et constatent une fois sur les lieux que les tuyaux de leur pompe fuient de toutes parts. Nouvelle colère de Monsieur Testard! Enfin, après une nuit passée à faire la chaîne avec des seaux d'eau avec toute la population, il rentre chez lui épuisé et trempé. Il avale une soupe froide et se couche crevé. Manque de chance, la bonne, bien intentionnée, avait glissé dans son lit une bonne bouillotte bien chaude... laquelle, mal fermée, coule et inonde le lit! C'en est trop! La quatrième colère de Paul lui est fatale, et ce sera la dernière."
en 1872 il réside à Brest place du château
Dossier individuel de personnel de TESTARD Paul Félix Mathurin Cote MV CC 7 ALPHA 2346 Vincennes
http://www.dossiersmarine.fr/can3.htm
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530205801/f1.item.r=Bomarsund.zoom#
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5806039n/f284.image.r=capricieuse
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58149454/f52.item.r=Canton
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54255832/f233.item.r=Capricieuse
https://souvenir-francais-asie.com/2011/02/04/ecumes-de-mer-de-chine-par-le-vice-amiral-nielly/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6372010v/f46.item
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64644525/f636.image.r=louis%20xiv
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k103544f/f105.item.r=testard
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k103544f/f105.item.r=testard
Nos troupes d'occupation se composent de la division navale et du corps d'infanterie de la marine. A la tête de la division se trouvele vaisseau amiral : c'est le Fleurus ; il commande le port de guerre et reste toujours mouillé à Saïgon ; le reste se compose de corvettes, avisos, croiseurs, qui font le service des côtes; au besoin, ils transportent à l'île de Poulo-Condor les individus condamnés à la déportation. Des canonnières, sous le commandement de lieutenants de vaisseau, ont la surveillance intérieure de la Cochinchine: elles parcourent les différents bras du Cambodge, le Vasco, le Donnai et les principaux arroyos.
L'infanterie de marine est nombreuse ; elle comprend quatre régiments. De là un état-major assez important. Les principaux points d'occupation, après Saïgon, sont Mytho, Vinh-long, Chaudoc, Baria. Dans les autres inspections, on n'entretient qu'une compa-gnie, souvent même un simple détachement. A présent que notre autorité est bien établie, que les révoltes deviennent de plus en plus rares, on pourrait diminuer sans inconvénient l'effectif des troupes. La Cochinchine est une des colonies les plus recherchées par les officiers, attendu que leur paie y est très-élevée; c'est da reste une
compensation bien légitime pour les dangers que fait toujours
courir un climat insalubre à 3,000 lieues de la patrie.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k208750g/f126.item#
musée du quai Branly - Jacques Chirac - Explorer les collections
- Lieutenant de vaisseau envoyé au fort de Bicêtre puis de Montrouge lors du siège de Paris de 1870, au Gabon en 1872, puis en Cochinchine en 1875 (1869 - 1877)
- Aspirant de marine envoyé dans l’Océan Indien en 1861, nommé enseigne de vaisseau puis envoyé en Nouvelle-Calédonie et Tahiti en 1865 et en Cochinchine en 1868 (1861 - 1869)
- Volontaire de la marine envoyé dans les mers de Chine, nommé aspirant suite à sa capture des pirates de Ningbo puis à sa conduite lors de la prise de Canton (1856 - 1861)
- Volontaire de la marine faisant office d’aspirant auxiliaire pour l’expédition diplomatique Belvèze au Canada (1855)
- Volontaire de la marine membre de l’escadre de la Baltique pendant la guerre de Crimée, participe à la prise du Fort de Bomarsund (1854)






